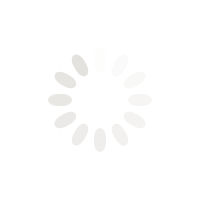J. M. Coetzee – Conférence Nobel
English
Swedish
French
German
Lui et son homme
Mais retournons à mon nouveau compagnon. J’étais enchanté de lui, et je m’appliquais à lui enseigner à faire tout ce qui était propre à le rendre utile, adroit, entendu, mais surtout à me parler et à me comprendre, et je le trouvai le meilleur écolier qui fût jamais.
— Daniel Defoe, Robinson Crusoe (traduction Pétrus Borel)
Boston, situé sur la côte du Lincolnshire, est une jolie petite ville, écrit son homme. On peut y voir le plus haut clocher de toute l’Angleterre; les pilotes le prennent comme amer pour guider les navires. Boston est entouré de marécages. Les butors, ou boeufs d’eau, y abondent ; ce sont de sinistres oiseaux dont le cri, un profond mugissement, est si sonore qu’il s’entend à deux miles de distance, comme l’écho d’un coup de fusil.
Ces marécages abritent de nombreuses autres espèces de volatiles, écrit son homme, canards, malards, sarcelles et macreuses, et pour les capturer les hommes des Fens, les hommes des palus, élèvent et domestiquent des canards qu’ils désignent sous le nom d’appeaux ou appelants.
Les Fens sont des étendues marécageuses. Il y a de tels marais dans toute l’Europe, dans le monde entier, mais ailleurs on ne les appelle pas des Fens. Fen est un mot anglais qui ne saurait migrer.
Ces appelants du Lincolnshire, écrit son homme, sont élevés dans des étangs à canards appelants et on les domestique en les nourrissant à la main. Puis, la saison venue, on les envoie à l’étranger, en Hollande et en Allemagne. En Hollande et en Allemagne, ils retrouvent des congénères, et voyant la vie misérable que connaissent ces canards hollandais et allemands, voyant que leurs rivières sont prises l’hiver par le gel et que leurs terres se couvrent de neige, ils ne manquent pas de leur faire savoir, dans un langage qu’ils savent leur faire comprendre, qu’en Angleterre d’où ils viennent, il en est tout autrement : les canards anglais connaissent des rivages où ils trouvent de quoi se nourrir en abondance, les marées remontent sans obstacle fort loin dans les cours d’eau; ils ont des lacs, des sources, des étangs à ciel ouvert et des étangs abrités; et aussi des terres où ils trouvent en abondance du blé laissé par les glaneurs; et point de gel ni de neige, ou fort peu.
En leur peignant un tel tableau, écrit-il, ce qu’ils font en langage de canard, les appeaux ou appelants, attirent et rassemblent des volatiles en grand nombre et, pour ainsi dire, les kidnappent. Par delà les mers, depuis l’Allemagne et la Hollande, ils les guident vers leur pays jusqu’à leurs étangs dans les Fens du Lincolnshire, ne cessant de nasiller et de cancaner pour leur dire dans leur langage que ce sont là les étangs dont ils leur ont parlé et où ils pourront désormais vivre sains et saufs.
Et tandis qu’ils s’emploient ainsi à installer leurs congénères, les sauvaginiers, les maîtres des canards appelants, se mettent à couvert dans des abris ou canardières qu’ils ont bâties avec des roseaux sur les fens, et, sans se faire voir, jettent des poignées de blé sur l’eau des marais; et les appeaux ou appelants les suivent amenant à leur suite leurs hôtes étrangers. Et ainsi, en deux ou trois jours, ils mènent leurs hôtes par des cours d’eau de plus en plus étroits, ne cessant de les inviter à voir comme on vit bien en Angleterre, vers un endroit où des filets ont été déployés.
Puis les maîtres des appelants envoient leur chien qui a été bien dressé à poursuivre les oiseaux à la nage, qui aboie tout en nageant. Effrayés au plus haut point par cette terrible créature, les canards prennent leur vol, mais ils sont rabattus dans l’eau par les filets tendus au dessus d’eux, et il leur faut nager ou périr, sous le filet. Mais le filet se fait de plus en plus étroit, comme une bourse qui se resserre, et au bout se tiennent les dresseurs d’appeaux, qui se saisissent de leurs captifs un par un. Et de caresser les appelants et de les féliciter. Quant à leurs hôtes, on les assomme sur place, on les plume et on les vend par centaines et par milliers.
Toute cette chronique du Lincolnshire son homme la rédige d’une écriture soignée et alerte, de ses plumes qu’il taille avec son petit canif chaque jour avant de se remettre à la tâche pour noircir une page de plus.
A Halifax, écrit son homme, se dressait, avant qu’on le supprime sous le règne du roi Jacques Premier, un instrument de supplice qui fonctionnait ainsi : la tête du condamné était placée sur la poutre de bois ou lunette à la base de l’échaffaud; puis le bourreau faisait sauter le goujon qui retenait le lourd couperet. Le couperet descendait entre les montants verticaux d’un cadre aussi haut qu’un porche d’église et décapitait l’homme aussi net qu’un couteau de boucher.
La coutume à Halifax disait cependant que, si, entre le moment où l’on faisait sauter le goujon et l’instant où le couperet tombait, le condamné parvenait à se remettre prestement sur pied, à dévaler la colline et traverser la rivière à la nage sans se faire reprendre par le bourreau, il aurait la vie sauve. Mais durant toutes les années où cette machine se dressa à Halifax, cela ne se produisit jamais.
Quant à lui (pas son homme cette fois, mais lui-même), il est assis dans sa chambre au bord de l’estuaire à Bristol et il lit ces lignes. Il se fait vieux, on pourrait presque dire de lui que c’est un vieillard maintenant. La peau de son visage que le soleil des tropiques avait quasiment noircie avant qu’il ne fabrique un parasol fait de palmes ou de feuilles de palmetto pour s’abriter, est plus pâle aujourd’hui, mais elle est restée tannée, parcheminée; le soleil lui a laissé sur le nez une plaie qui ne veut pas guérir.
Le parasol, il l’a encore avec lui, dans un coin de sa chambre, mais le perroquet qui était revenu avec lui n’est plus. Pauvre Robin! disait-il de sa voix rauque, perché sur son épaule, Pauvre Robin Crusoé! Qui sauvera le pauvre Robin? Sa femme ne pouvait souffrir les lamentations du perroquet, Pauvre Robin, du matin au soir. Je lui tordrai le cou, disait-elle, mais elle n’avait pas le courage de le faire.
Lorsqu’il revint en Angleterre de son île avec son perroquet et son parasol et son coffre plein de trésors, pendant un temps, il vécut passablement en paix avec sa vieille épouse sur les terres qu’il avait achetées à Huntingdon, car il était devenu un homme riche, plus riche encore lorsque l’on publia le livre narrant ses aventures. Mais les années dans l’île, et les années passées à courir le monde avec son serviteur Vendredi (pauvre Vendredi, se lamente-t-il, couac, couac, car le perroquet ne voulut jamais dire le nom de Vendredi, il ne disait que le sien) lui rendait la vie de propriétaire terrien bien morne. Et pour dire la vérité, la vie conjugale lui était une amère déception. De plus en plus, il se retirait à l’écurie, auprès de ses chevaux, qui, dieu merci, ne jacassaient pas, mais hennissaient doucement à son approche, pour montrer qu’ils le connaissaient, et puis se tenaient tranquilles.
Il lui semblait, venant de son île où, jusqu’à l’arrivée de Vendredi, il avait connu une vie de silence, qu’il il y avait trop de paroles prononcées en ce monde. Dans son lit, à côté de sa femme, il avait l’impression qu’un déluge de cailloux s’abattait sur sa tête, dans un bruissement, un crépitement sans fin, alors que son seul désir était de dormir.
Alors, lorsque sa vieille épouse rendit l’âme, il prit le deuil mais ne la pleura pas. Il la mit en terre et ayant laissé passer le temps qu’exigent les convenances, il prit une chambre à l’auberge du Brave Gabier sur les quais de Bristol, laissant l’administration de son domaine d’Huntingdon à son fils, et ne prenant avec lui que le parasol rapporté de l’île qui l’avait rendu célèbre, le perroquet défunt attaché à son perchoir et quelques objets de première nécessité. C’est là qu’il vit depuis, seul, allant faire dans la journée un tour sur les quais et les pontons, portant ses regards vers l’ouest sur la mer, car il a encore bonne vue, tirant sur sa pipe. Pour ses repas, il se les fait monter dans sa chambre; car il ne trouve nul plaisir à se trouver en compagnie, s’étant habitué à la solitude sur son île.
Il ne lit guère, il a perdu le goût de la lecture; mais à écrire ses aventures, il a pris l’habitude d’écrire; cela le distrait passablement. Le soir, à la chandelle, il sort ses papiers, taille ses plumes et écrit une page ou deux sur son homme, l’homme qui envoie ses chroniques sur les appelants du Lincolnshire et sur la machine de mort d’Halifax, à laquelle on peut échapper si, avant que ne s’abatte l’épouvantable couperet, on peut, d’un bond, se mettre sur pied et dévaler la colline, et sur bien d’autres choses encore. De partout où il se rend, il envoie ses rapports, c’est là l’affaire la plus pressée de son homme, un homme fort affairé.
Dans ses flâneries sur la digue, méditant sur l’engin qui se dressait à Halifax, lui, Robin que le perroquet appelait jadis le pauvre Robin, laisse tomber un galet et prête l’oreille. Il ne faut qu’une seconde, moins d’une seconde, pour que le galet arrive jusqu’à l’eau. La grâce de Dieu est preste, mais la grande lame d’acier trempé, bien plus lourde qu’un galet, et graissée au suif, ne serait-elle pas plus preste encore? Comment y échapperons-nous jamais? Et quelle espèce d’homme est-ce donc pour courir le royaume d’un bout à l’autre, pour aller d’un spectacle de mort à l’autre (de bastonnade en décapitation) et inlassablement dépêcher ses rapports?
Homme d’affaires, se dit-il. Qu’il soit homme d’affaires, négociant en grains ou en peausserie, par exemple; ou fabricant et fournisseur de tuiles, établi en un lieu où on se procure l’argile en abondance, disons à Wapping, et qui doit voyager beaucoup dans l’intérêt de son négoce. Qu’il soit prospère, pourvu d’une femme qui l’aime et ne jacasse pas trop et qui lui donne des enfants, des filles surtout; qu’il connaisse un bonheur raisonnable; puis que ce bonheur soudain arrive à son terme. La Tamise, un hiver, se gonfle, les fours où l’on cuit les tuiles, ou les magasins à grain, ou la tannerie, sont emportés par les flots : le voilà ruiné, son homme, ses créanciers s’abattent sur lui comme des mouches, lui fondent dessus comme des corbeaux, il doit fuir son foyer, sa femme, ses enfants et chercher refuge dans le plus misérable taudis de Beggars Lane, sous un faux nom et sous quelque déguisement. Et tout cela – la montée des eaux, la ruine, la fuite, la misère, les pauvres hardes, la solitude – que tout cela soit une figure du naufrage et de l’île où lui, pauvre Robin, se trouva coupé du monde pendant vingt-six ans, jusqu’à en devenir presque fou (et en vérité, qui pourrait dire qu’il ne devint pas bel et bien fou, dans une certaine mesure?).
Ou encore que cet homme soit bourrelier : il a un foyer, un magasin, un entrepôt à Whitechapel, et un grain de beauté sur le menton, et une femme qui l’aime, qui ne jacasse pas, qui lui donne des enfants, des filles surtout, et qui lui fait connaître un grand bonheur, jusqu’à ce que la peste s’abatte sur la ville, c’est l’année 1665, le grand incendie n’a pas encore dévasté Londres. La peste s’abat sur Londres : chaque jour, de paroisse en paroisse, le nombre des morts grossit, riches et pauvres, car la peste ne fait pas de distinction entre les conditions des uns et des autres, toute la richesse de ce bourrelier ne le sauvera pas. Il expédie sa femme et ses filles à la campagne, et envisage de fuir lui-même, mais en fin de compte n’en fait rien. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, lit-il, ouvrant la Bible au hasard, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l’ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. S’il en tombe mille à ton côté et dix-mille à ta droite, toi tu ne seras pas atteint.
Reprenant courage à ce signe, signe de passage à sauveté, il demeure à Londres frappée du fléau et se met à écrire des rapports. Je me trouvai par hasard dans la rue face à une foule, écrit-il, au milieu de laquelle une femme pointait le doigt vers les cieux. Voyez, crie-t-elle, un ange vêtu de blanc qui brandit une épée flamboyante! Et dans la foule chacun opine du chef, à l’adresse de son voisin, En vérité, c’est bien cela, dit-on : un ange et une épée! Mais lui, le bourrelier, ne voit ni l’ange ni l’épée. Tout ce qu’il voit, c’est un nuage de forme étrange, plus lumineux d’un côté que de l’autre, du côté qui reçoit l’éclat du soleil.
C’est une allégorie! s’écrie la femme dans la rue; mais il a beau regarder, il ne voit point d’allégorie. Et c’est ainsi dans son rapport.
Un autre jour, comme il se promenait sur les berges de la rivière à Wapping, son homme qui était naguère bourrelier, mais qui aujourd’hui se trouve privé de son métier, remarque une femme sur le pas de sa porte qui appelle un homme ramant dans un doris : Robert! Robert! crie-t-elle; et il voit l’homme ramer jusqu’à la berge et prendre dans son embarcation un sac qu’il dépose sur un rocher au bord de la rivière, et il repart à la rame; puis il voit la femme descendre jusqu’à la berge, ramasser le sac qu’elle emporte chez elle, la mine empreinte d’un profond chagrin.
Il accoste ce Robert et il lui parle. Robert l’informe que c’est là sa femme et que le sac contient une semaine de vivres pour elle et leurs enfants, de la viande, de la farine et du beurre; mais il n’ose s’approcher davantage, car tous, femme et enfants, sont frappés de la peste; et il en a le coeur brisé. Et tout cela – l’homme Robert et sa femme qui reste en communion en l’appelant par delà l’eau du fleuve, le sac laissé sur la berge – certainement se comprend littéralement, mais représente aussi une figure de sa solitude à lui, Robinson, sur son île, où, au plus noir de son désespoir, il appela par delà les flots les êtres chers en Angleterre pour qu’ils viennent le secourir, et où à d’autres moments, il nagea jusqu’à l’épave pour y chercher de l’avitaillement.
Autre relation de ces temps de malheur. Ne pouvant plus supporter la douleur des bubons dans l’aine et sous les aisselles qui sont le signe de la peste, un homme se précipite, nu comme un ver, dans la rue, dans Harrow Lane à Whitechapel, où son homme le bourrelier le voit faire des bonds et des sauts et gesticuler de la manière la plus étrange, tandis que sa femme et ses enfants lui courent après, l’appellent à cor et à cri pour lui dire de revenir. Et ces bonds et ces gesticulations sont une allégorie de ses propres bonds et gesticulations d’insensé, lorsque, après la calamité du naufrage, et après qu’il eut parcouru la grève en tous sens pour trouver quelque signe de ses compagnons, sans en trouver la moindre trace, si ce n’est une paire de souliers dépareillés, il comprit qu’il était jeté seul sur une île sauvage où il allait sans doute périr sans espoir de salut.
(Mais que chante-t-il d’autre en secret, se demande-t-il, ce pauvre malheureux dont il lit le sort, en plus de sa désolation? Qu’appelle-t-il par delà les eaux et par delà les années, depuis le feu qui brûle au fond de lui?)
Il y a un an, lui, Robinson, a acheté à un matelot pour deux guinées un perroquet que ce matelot avait, disait-il, rapporté du Brésil – un oiseau pas aussi somptueux que sa propre créature bien-aimée, mais splendide spécimen au demeurant, avec un plumage vert, une crête écarlate, et un grand bavard, à en croire le matelot. Et il est vrai que l’oiseau se tenait sur son perchoir dans sa chambre à l’auberge, une petite chaîne à la patte au cas où il chercherait à s’envoler, et il disait les mots Pauvre Jacquot! Pauvre Jacquot! qu’il répétait sans cesse, au point qu’il a dû lui couvrir la tête d’un chaperon; mais il n’a pu lui apprendre le moindre mot de plus. Pauvre Robin! par exemple, peut-être était-il trop vieux pour cela.
Pauvre Jacquot, qui, par l’étroite fenêtre, promène son regard sur les mâtures et, par delà les mâtures, sur la houle grise de l’Atlantique : Mais quelle île est-ce là, demande le Pauvre Jacquot, sur quelle île suis-je donc jeté, si froide, si lugubre? Où étais-tu, mon Sauveur, à l’heure où j’avais grand besoin de toi?
Un homme, ivre, à une heure avancée de la nuit (un rapport de plus de son homme), s’endort sous un porche à Cripplegate. La charrette des morts passe par là (nous sommes encore dans l’année de la peste) et les voisins, pensant que cet homme est mort, le mettent dans la charrette parmi les cadavres. La charrette finit par arriver à la fosse commune à Mountmill et le charretier, le visage emmitouflé pour se protéger des effluves, le soulève pour jeter à la fosse ; et il se réveille, se débat, abasourdi. Mais où suis-je? dit il. Tu es sur le point d’être mis en terre avec les morts, dit le charretier. Mais alors, c’est que je suis mort? dit l’homme. Et cela est aussi une figure de lui sur son île.
Certains parmi les bonnes gens de Londres continuent à vaquer à leurs affaires, pensant qu’ils sont sains de corps et qu’ils seront épargnés. Mais la peste en secret leur court dans le sang : quand l’infection gagne leur coeur, ils tombent morts sur place, ainsi le rapporte son homme, comme frappés par la foudre. Et c’est là une figure de la vie même, de la vie tout entière. Il convient de se bien préparer. Nous devrions nous bien préparer à la mort, sous peine d’être frappés sans préavis. Comme lui, Robinson, ne manqua pas de le voir, lorsque tout d’un coup, sur son île, il tomba sur la trace d’un pied humain dans le sable. C’était une empreinte, partant un signe : signe d’un pied, d’un homme. Mais c’était le signe de bien d’autres choses encore. Tu n’es pas seul, disait ce signe; et aussi, Aussi loin que tu ailles sur les mers, où que tu ailles te cacher, tu seras scruté.
Durant l’année de la peste, écrit son homme, d’autres, en proie à la terreur, abandonnaient tout, leurs foyers, leurs femmes, leurs enfants, et fuyaient, aussi loin de Londres qu’ils pouvaient. Une fois la peste passée, de toutes parts, leur fuite fut condamnée comme une lâcheté. Mais, écrit son homme, on oublie quelle sorte de courage il fallait pour faire face à la peste. Ce n’était pas le courage du simple soldat qui se saisit de son arme pour charger l’ennemi : cela n’était rien moins que charger la Mort sur son cheval blême.
Même quand il faisait de son mieux, son perroquet de l’île, celui des deux qu’il aima le plus, ne dit pas le moindre mot que ne lui avait pas enseigné son maître. Comment se fait-il alors que son homme à lui, qui est une sorte de perroquet, et plutôt mal aimé, écrive aussi bien ou mieux que son maître? Car il a une bonne plume, son homme, cela ne fait aucun doute. Rien moins que charger la Mort sur son cheval blême. Pour lui, son savoir-faire, acquis dans la salle des comptes, consistait à aligner des chiffres et à faire des factures, pas à filer des phrases. Rien moins que la Mort sur son cheval blême : ce sont là des mots auxquels il n’aurait pas pensé. Ce n’est que lorsqu’il se livre totalement à son homme, que de tels mots lui viennent.
Et pour ce qui est des appeaux à canards, des appelants : que savait-il, lui, Robinson, de tels appeaux? Rien du tout jusqu’à ce que son homme se mît à lui envoyer ses chroniques.
Les appelants des Fens du Lincolnshire, le grand instrument de supplice d’Halifax : relations d’un grand périple qui mène son homme d’un bout à l’autre de l’île de Grande Bretagne, ce qui est une figure du périple qu’il fit lui-même sur son île dans la pirogue qu’il s’était construite, le périple qui lui montra qu’il y avait un autre côté de l’île, escarpé, enténébré, inhospitalier, que par la suite il évita à tout prix, alors que, si dans l’avenir des colons viennent à toucher terre sur l’île, ils l’exploreront peut-être et s’y établiront; là encore une figure, du côté enténébré de l’âme et de la lumière.
Lorsque les premières bandes de plagiaires et autres imitateurs s’emparèrent de son histoire d’île, et infligèrent au public leurs propres fables de la vie d’un naufragé, ils n’étaient à ses yeux ni plus ni moins qu’une horde de cannibales qui en avaient à sa propre chair, c’est à dire à sa vie; et il ne se gêna pour le dire. Lorsque je me défendais contre les cannibales qui cherchaient à me jeter bas pour me faire rôtir et me dévorer, écrivit-il, je croyais me défendre contre leurs agissements mêmes. Il ne me vint guère à l’esprit, écrivit-il, que ces cannibales n’étaient rien d’autre que des figures d’une voracité plus diabolique, propre à ronger la substance même de la vérité.
Mais à présent, à y mieux réfléchir, il sent s’insinuer dans son coeur comme un grain de camaraderie pour ses imitateurs. Car il lui semble maintenant qu’il n’existe dans le monde qu’une poignée de récits; et si on interdit aux jeunes de pirater les anciens, il leur faut alors à jamais garder le silence.
Ainsi, dans le récit de ses aventures sur l’île, il raconte comment une nuit il se réveilla épouvanté, persuadé que le diable était couché sur lui dans son lit sous la forme d’un énorme chien. D’un bond, il se leva, se saisit d’un coutelas et se mit à pourfendre l’air de droite et de gauche, tandis que le pauvre perroquet qui dormait à son chevet jetait des cris de frayeur. Ce n’est que bien des jours plus tard qu’il comprit que ni chien ni diable n’avait été couché sur lui, mais qu’il avait plutôt été pris d’une attaque de paralysie passagère, et que, incapable de bouger sa jambe, il en avait conclu que quelque créature était couchée dessus. La leçon à tirer de cet événement semblerait être que toutes les afflictions, y compris la paralysie, sont le fait du diable, et sont en fait le diable même; que si l’on se trouve visité par la calamité d’une maladie, on peut se figurer être visité par le diable, ou par un chien qui figure le diable, et vice versa, une telle visitation sous figure de maladie, comme dans l’histoire de la peste que conte le bourrelier; il s’ensuit que personne qui écrit des histoires sur l’une ou l’autre ne devrait être traité à la légère de faussaire ou de voleur.
Lorsque, il y a des années, il résolut de coucher sur le papier l’histoire de son île, il découvrit que les mots ne lui venaient pas, la plume se refusait à courir sur la page, ses doigts mêmes étaient raides et rétifs. Mais de jour en jour, pas à pas, il acquit le métier d’écrire, et quand il en arriva à ses aventures avec Vendredi dans le nord pris par le gel il couvrait page sur page facilement, sans même réfléchir.
Cette facilité de jadis à composer l’a, hélas, quitté. Quand il s’installe à son petit bureau devant la fenêtre qui donne sur le port de Bristol, il se sent les doigts aussi gourds et la plume lui est un instrument aussi étranger que jamais.
Et l’autre, son homme, trouve-t-il cette affaire d’écrire plus facile? Les histoires qu’il écrit sur les canards, les engins de mort et Londres pendant la peste sont assez joliment tournées; mais il en était ainsi de ses propres histoires jadis. Peut-être le méjuge-t-il, ce petit homme pimpant qui marche d’un pas vif et qui a un grain de beauté sur le menton. Peut-être, à cet instant même est-il, assis tout seul dans une chambre louée quelquepart dans ce vaste royaume, trempant et retrempant sa plume, pris de doute, hésitant, se ravisant.
Comment faut-il se les figurer, cet homme et lui? Le maître et l’esclave? Des frères, des jumeaux? Des compagnons d’armes? Ou des ennemis, des adversaires? Quel nom donnera-t-il à ce compagnon anonyme avec qui il partage ses soirées et parfois ses nuits aussi, qui n’est absent que dans la journée, lorsque lui, Robin, parcourt les quais inspectant les arrivages et que son homme sillonne le royaume au galop pour faire ses inspections.
Cet homme, au cours de ses voyages, viendra-t-il jamais à Bristol? Il voudrait tant le rencontrer en chair et en os, lui serrer la main, faire un tour sur les quais avec lui et prêter l’oreille comme il raconte l’histoire de sa visite au nord enténébré de l’île, ou de ses aventures dans le métier d’écrire. Mais il craint bien que cette rencontre n’ait jamais lieu, pas dans cette vie. S’il faut décider de quelque ressemblance pour la paire qu’ils font, son homme et lui, il écrirait qu’ils sont comme deux navires faisant voile dans des directions contraires, l’un cinglant vers l’ouest, l’autre vers l’est. Ou mieux, qu’ils sont des matelots à la tâche dans la voilure, l’un sur un navire faisant route vers l’ouest, l’autre sur un navire voguant vers l’est. Leurs navires se croisent bord sur bord, ils passent assez près pour se héler. Mais la mer est forte, le temps à la tempête : les yeux fouettés par les embruns, les mains brûlées par les cordages, ils se croisent sans se reconnaître, trop occupés pour même se faire signe.
Traduction par Catherine Lauga du Plessis
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.