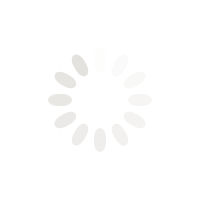Harold Pinter – Conférence Nobel
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Art, vérité & politique
En 1958 j’ai écrit la chose suivante :
« Il n’y a pas de distinctions tranchées entre ce qui est réel et ce qui est irréel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Une chose n’est pas nécessairement vraie ou fausse ; elle peut être tout à la fois vraie et fausse. »
Je crois que ces affirmations ont toujours un sens et s’appliquent toujours à l’exploration de la réalité à travers l’art. Donc, en tant qu’auteur, j’y souscris encore, mais en tant que citoyen je ne peux pas. En tant que citoyen, je dois demander : Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ?
La vérité au théâtre est à jamais insaisissable. Vous ne la trouvez jamais tout à fait, mais sa quête a quelque chose de compulsif.Cette quête est précisément ce qui commande votre effort. Cette quête est votre tâche. La plupart du temps vous tombez sur la vérité par hasard dans le noir, en entrant en collision avec elle, ou en entrevoyant simplement une image ou une forme qui semble correspondre à la vérité, souvent sans vous rendre compte que vous l’avez fait. Mais la réelle vérité, c’est qu’il n’y a jamais, en art dramatique, une et une seule vérité à découvrir. Il y en a beaucoup. Ces vérités se défient l’une l’autre, se dérobent l’une à l’autre, se reflètent, s’ignorent, se narguent, sont aveugles l’une à l’autre. Vous avez parfois le sentiment d’avoir trouvé dans votre main la vérité d’un moment, puis elle vous glisse entre les doigts et la voilà perdue.
On m’a souvent demandé comment mes pièces voyaient le jour. Je ne saurais le dire. Pas plus que je ne saurais résumer mes pièces, si ce n’est pour dire voilà ce qui s’est passé. Voilà ce qu’ils ont dit. Voilà ce qu’ils ont fait.
La plupart des pièces naissent d’une réplique, d’un mot ou d’une image. Le mot s’offre le premier, l’image le suivant souvent de près. Je vais vous donner deux exemples de répliques qui me sont venues à l’esprit de façon totalement inattendue, suivies par une image, que j’ai moi-même suivie.
Les pièces en question sont Le Retour et C’était hier. La première réplique du Retour est « Qu’est-ce que tu as fait des ciseaux ? » La première réplique de C’était hier est « Bruns ».
Dans un cas comme dans l’autre je n’avais pas d’autres indications.
Dans le premier cas, quelqu’un, à l’évidence, cherchait une paire de ciseaux et demandait où ils étaient passés à quelqu’un d’autre dont il soupçonnait qu’il les avait probablement volés. Mais d’une manière ou d’une autre je savais que la personne à qui on s’adressait se fichait éperdument des ciseaux, comme de celui qui posait la question, d’ailleurs.
« Bruns » : je présumais qu’il s’agissait de la description des cheveux de quelqu’un, les cheveux d’une femme, et que cela répondait à une question. Dans l’un et l’autre cas, je me suis trouvé contraint de poursuivre la chose. Tout se passait visuellement, un très lent fondu, passant de l’ombre à la lumière.
Je commence toujours une pièce en appelant les personnages A, B et C.
Dans la pièce qui est devenue Le Retour je voyais un homme entrer dans une pièce austère et poser sa question àun homme plus jeune, assis sur un affreux canapé, le nez dans un journal des courses. Je soupçonnais vaguement que A était un père et que B était son fils, mais je n’en avais aucune preuve. Cela s’est néanmoins confirmé un peu plus tard quand B (qui par la suite deviendrait Lenny) dit à A (qui par la suite deviendrait Max), « Papa, tu permets que je change de sujet ? Je voudrais te demander quelque chose. Ce qu’on a mangé au dîner tout à l’heure, ça s’appelait comment ? Tu appelles ça comment ? Pourquoi tu n’achètes pas un chien ? Tu es un cuisinier pour chiens. Franchement. Tu crois donc que tu fais la cuisine pour une bande de chiens. 1 » Donc, dès lors que B appelait A « Papa », il me semblait raisonnable d’admettre qu’ils étaient père et fils. A, manifestement, était aussi le cuisinier et sa cuisine ne semblait pas être tenue en bien haute estime. Cela voulait-il dire qu’il n’y avait pas de mère ? Je n’en savais rien. Mais, comme je me le répétais à l’époque, nos débuts ne savent jamais de quoi nos fins seront faites.
« Bruns. » Une grande fenêtre. Ciel du soir. Un homme, A (qui par la suite deviendrait Deeley), et une femme, B (qui par la suite deviendrait Kate), assis avec des verres. « Grosse ou mince ? » demande l’homme. De qui parlent-ils ? C’est alors que je vois, se tenant à la fenêtre, une femme, C (qui par la suite deviendrait Anna), dans une autre qualité de lumière, leur tournant le dos, les cheveux bruns.
C’est un étrange moment, le moment où l’on crée des personnages qui n’avaient jusque-là aucune existence. Ce qui suit est capricieux, incertain, voire hallucinatoire, même si cela peut parfois prendre la forme d’une avalanche que rien ne peut arrêter. La position de l’auteur est une position bizarre. En un sens, les personnages ne lui font pas bon accueil. Les personnages lui résistent, ils ne sont pas faciles à vivre, ils sont impossibles à définir. Vous ne pouvez certainement pas leur donner d’ordres. Dans une certaine mesure vous vous livrez avec eux à un jeu interminable, vous jouez au chat et à la souris, à colin-maillard, à cache-cache. Mais vous découvrez finalement que vous avez sur les bras des êtres de chair et de sang, des êtres possédant une volonté et une sensibilité individuelle bien à eux, faits de composantes que vous n’êtes pas en mesure de changer, manipuler ou dénaturer.
Le langage, en art, demeure donc une affaire extrêmement ambiguë, des sables mouvants, un trampoline, une mare gelée qui pourrait bien céder sous vos pieds, à vous l’auteur, d’un instant à l’autre.
Mais, comme je le disais, la quête de la vérité ne peut jamais s’arrêter. Elle ne saurait être ajournée, elle ne saurait être différée. Il faut l’affronter là, tout de suite.
Le théâtre politique présente un ensemble de problèmes totalement différents. Les sermons doivent être évités à tout prix. L’objectivité est essentielle. Il doit être permis aux personnages de respirer un air qui leur appartient. L’auteur ne peut les enfermer ni les entraver pour satisfaire le goût, l’inclination ou les préjugés qui sont les siens. Il doit être prêt à les aborder sous des angles variés, dans des perspectives très diverses, ne connaissant ni frein ni limite, les prendre par surprise, peut-être, de temps en temps, tout en leur laissant la liberté de suivre le chemin qui leur plaît. Ça ne fonctionne pas toujours. Et la satire politique, bien évidemment, n’obéit à aucun de ces préceptes, elle fait même précisément l’inverse, ce qui est d’ailleurs sa fonction première.
Dans ma pièce L’Anniversaire il me semble que je lance des pistes d’interprétation très diverses, les laissant opérer dans une épaisse forêt de possibles avant de me concentrer, au final, sur un acte de soumission.
Langue de la montagne ne prétend pas opérer de manière aussi ouverte. Tout y est brutal, bref et laid. Les soldats de la pièce trouvent pourtant le moyen de s’amuser de la situation. On oublie parfois que les tortionnaires s’ennuient très facilement. Ils ont besoin de rire un peu pour garder le moral. Comme l’ont bien évidemment confirmé les événements d’Abu Ghraib à Bagdad. Langue de la montagne ne dure que vingt minutes, mais elle pourrait se prolonger pendant des heures et des heures, inlassablement, répétant le même schéma encore et encore, pendant des heures et des heures.
Ashes to Ashes, pour sa part, me semble se dérouler sous l’eau. Une femme qui se noie, sa main se tendant vers la surface à travers les vagues, retombant hors de vue, se tendant vers d’autres mains, mais ne trouvant là personne, ni au-dessus ni au-dessous de l’eau, ne trouvant que des ombres, des reflets, flottant ; la femme, une silhouette perdue dans un paysage qui se noie, une femme incapable d’échapper au destin tragique qui semblait n’appartenir qu’aux autres.
Mais comme les autres sont morts, elle doit mourir aussi.
Le langage politique, tel que l’emploient les hommes politiques, ne s’aventure jamais sur ce genre de terrain, puisque la majorité des hommes politiques, à en croire les éléments dont nous disposons, ne s’intéressent pas à la vérité mais au pouvoir et au maintien de ce pouvoir. Pour maintenir ce pouvoir il est essentiel que les gens demeurent dans l’ignorance, qu’ils vivent dans l’ignorance de la vérité, jusqu’à la vérité de leur propre vie. Ce qui nous entoure est donc un vaste tissu de mensonges, dont nous nous nourrissons.
Comme le sait ici tout un chacun, l’argument avancé pour justifier l’invasion de l’Irak était que Saddam Hussein détenait un arsenal extrêmement dangereux d’armes de destruction massive, dont certaines pouvaient être déchargées en 45 minutes, provoquant un effroyable carnage. On nous assurait que c’était vrai. Ce n’était pas vrai. On nous disait que l’Irak entretenait des relations avec Al Qaïda et avait donc sa part de responsabilitédans l’atrocité du 11 septembre 2001 à New York. On nous assurait que c’était vrai. Ce n’était pas vrai. On nous disait que l’Irak menaçait la sécurité du monde. On nous assurait que c’était vrai. Ce n’était pas vrai.
La vérité est totalement différente. La vérité est liée à la façon dont les États-Unis comprennent leur rôle dans le monde et la façon dont ils choisissent de l’incarner.
Mais avant de revenirau temps présent, j’aimerais considérer l’histoire récente, j’entends par là la politique étrangère des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu’il est pour nous impératif de soumettre cette période à un examen rigoureux, quoique limité, forcément, par le temps dont nous disposons ici.
Tout le monde sait ce qui s’est passé en Union Soviétique et dans toute l’Europe de l’Est durant l’après-guerre : la brutalité systématique, les atrocités largement répandues,la répression impitoyable de toute pensée indépendante. Tout cela a été pleinement documenté et attesté.
Mais je soutiens que les crimes commis par les États-Unis durant cette même période n’ont été que superficiellement rapportés, encore moins documentés, encore moins reconnus, encore moins identifiés àdes crimes tout court. Je crois que la question doit être abordée et que la vérité a un rapport évident avec l’état actuel du monde. Bien que limitées, dans une certaine mesure, par l’existence de l’Union Soviétique, les actions menées dans le monde entier par les États-Unis donnaient clairement à entendre qu’ils avaient décrété avoir carte blanche pour faire ce qu’ils voulaient.
L’invasion directe d’un état souverain n’a jamais été, de fait, la méthode privilégiée de l’Amérique. Dans l’ensemble, elle préférait ce qu’elle a qualifié de « conflit de faible intensité ».« Conflit de faible intensité », cela veut dire que des milliers de gens meurent, mais plus lentement que si vous lâchiez une bombe sur eux d’un seul coup.Cela veut dire que vous contaminez le cœur du pays, que vous y implantez une tumeur maligne et que vous observez s’étendre la gangrène. Une fois que le peuple a été soumis – ou battu à mort – ça revient au même – et que vos amis, les militaires et les grandes sociétés commerciales, sont confortablement installés au pouvoir, vous allez devant les caméras et vous déclarez que la démocratie l’a emporté. C’était monnaie courante dans la politique étrangère américaine dans les années auxquelles je fais allusion.
La tragédie du Nicaragua s’est avérée être un cas extrêmement révélateur. Si je décide de l’évoquer ici, c’est qu’il illustre de façon convaincante la façon dont l’Amérique envisage son rôle dans le monde, aussi bien à l’époque qu’aujourd’hui.
J’ai assisté à une réunion qui s’est tenue à l’Ambassade des États-Unis à Londres à la fin des années 80.
Le Congrès américain était sur le point de décider s’il fallait ou non donner davantage d’argent aux Contras dans la campagne qu’ils menaient contre l’État du Nicaragua. J’étais là en tant que membre d’une délégation parlant au nom du Nicaragua, mais le membre le plus important de cette délégation était un certain Père John Metcalf. Le chef de file du camp américain était Raymond Seitz (alors bras droit de l’ambassadeur, lui-même nommé ambassadeur par la suite). Père Metcalf a dit : « Monsieur, j’ai la charge d’une paroisse au nord du Nicaragua. Mes paroissiens ont construit une école, un centre médico-social, un centre culturel. Nous avons vécu en paix. Il y a quelques mois une force de la Contra a attaqué la paroisse. Ils ont tout détruit : l’école, le centre médico-social, le centre culturel. Ils ont violé les infirmières et les institutrices, massacré les médecins, de la manière la plus brutale. Ils se sont comportés comme des sauvages. Je vous en supplie, exigez du gouvernement américain qu’il retire son soutien à cette odieuse activité terroriste. »
Raymond Seitz avait très bonne réputation, celle d’un homme rationnel, responsable et très bien informé. Il était grandement respecté dans les cercles diplomatiques. Il a écouté, marqué une pause, puis parlé avec une certaine gravité. « Père, dit-il, laissez-moi vous dire une chose. En temps de guerre, les innocents souffrent toujours. » Il y eut un silence glacial. Nous l’avons regardé d’un œil fixe. Il n’a pas bronché.
Les innocents, certes, souffrent toujours.
Finalement quelqu’un a dit : « Mais dans le cas qui nous occupe, des « innocents » ont été les victimes d’une atrocité innommable financée par votre gouvernement, une parmi tant d’autres. Si le Congrès accorde davantage d’argent aux Contras, d’autres atrocités de cette espèce seront perpétrées. N’est-ce pas le cas ? Votre gouvernement n’est-il pas par là même coupable de soutenir des actes meurtriers et destructeurs commis sur les citoyens d’un état souverain ? »
Seitz était imperturbable. « Je ne suis pas d’accord que les faits, tels qu’ils nous ont été exposés, appuient ce que vous affirmez là », dit-il.
Alors que nous quittions l’ambassade, un conseiller américain m’a dit qu’il aimait beaucoup mes pièces. Je n’ai pas répondu.
Je dois vous rappeler qu’à l’époque le Président Reagan avait fait la déclaration suivante : « Les Contras sont l’équivalent moral de nos Pères fondateurs. »
Les États-Unis ont pendant plus de quarante ans soutenu la dictature brutale de Somoza au Nicaragua. Le peuple nicaraguayen, sous la conduite des Sandinistes, a renversé ce régime en 1979, une révolution populaire et poignante.
Les Sandinistes n’étaient pas parfaits. Ils avaient leur part d’arrogance et leur philosophie politique comportait un certain nombre d’éléments contradictoires. Mais ils étaient intelligents, rationnels et civilisés. Leur but était d’instaurer une société stable, digne, et pluraliste. La peine de mort a été abolie. Des centaines de milliers de paysans frappés par la misère ont été ramenés d’entre les morts. Plus de 100 000 familles se sont vues attribuer un droit à la terre. Deux mille écoles ont été construites. Une campagne d’alphabétisation tout à fait remarquable a fait tomber le taux d’analphabétisme dans le pays sous la barre des 15%. L’éducation gratuite a été instaurée ainsi que la gratuité des services de santé. La mortalité infantile a diminué d’un tiers. La polio a été éradiquée.
Les États-Unis accusèrent ces franches réussites d’être de la subversion marxiste-léniniste. Aux yeux du gouvernement américain, le Nicaragua donnait là un dangereux exemple. Si on lui permettait d’établir les normes élémentaires de la justice économique et sociale, si on lui permettait d’élever le niveau des soins médicaux et de l’éducation et d’accéder à une unité sociale et une dignité nationale, les pays voisins se poseraient les mêmes questions et apporteraient les mêmes réponses. Il y avait bien sûr à l’époque, au Salvador, une résistance farouche au statu quo.
J’ai parlé tout à l’heure du « tissu de mensonges » qui nous entoure. Le Président Reagan qualifiait couramment le Nicaragua de « donjon totalitaire ». Ce que les médias, et assurément le gouvernement britannique, tenaient généralement pour une observation juste et méritée. Il n’y avait pourtant pas trace d’escadrons de la mort sous le gouvernement sandiniste. Il n’y avait pas trace de tortures. Il n’y avait pas trace de brutalité militaire, systématique ou officielle. Aucun prêtre n’a jamais été assassiné au Nicaragua. Il y avait même trois prêtres dans le gouvernement sandiniste, deux jésuites et un missionnaire de la Société de Maryknoll. Les « donjons totalitaires » se trouvaient en fait tout à côté, au Salvador et au Guatemala. Les États-Unis avaient, en 1954, fait tomber le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala et on estime que plus de 200 000 personnes avaient été victimes des dictatures militaires qui s’y étaient succédé.
En 1989, six des plus éminents jésuites du monde ont été violemment abattus à l’Université Centraméricaine de San Salvador par un bataillon du régiment Alcatl entraîné à Fort Benning, Géorgie, USA. L’archevêque Romero, cet homme au courage exemplaire, a été assassiné alors qu’il célébrait la messe. On estime que 75 000 personnes sont mortes. Pourquoi a-t-on tué ces gens-là ? On les a tués parce qu’ils étaient convaincus qu’une vie meilleure était possible et devait advenir. Cette conviction les a immédiatement catalogués comme communistes. Ils sont morts parce qu’ils osaient contester le statu quo, l’horizon infini de pauvreté, de maladies, d’humiliation et d’oppression, le seul droit qu’ils avaient acquis à la naissance.
Les États-Unis ont fini par faire tomber le gouvernement sandiniste. Cela leur prit plusieurs années et ils durent faire preuve d’une ténacité considérable,mais une persécution économique acharnée et 30 000 morts ont fini par ébranler le courage des Nicaraguayens. Ils étaient épuisés et de nouveau misérables. L’économie « casino » s’est réinstallée dans le pays. C’en était fini de la santé gratuite et de l’éducation gratuite. Les affaires ont fait un retour en force. La « Démocratie » l’avait emporté.
Mais cette « politique » ne se limitait en rien à l’Amérique Centrale. Elle était menée partout dans le monde. Elle était sans fin. Et c’est comme si ça n’était jamais arrivé.
Les États-Unis ont soutenu, et dans bien des cas engendré, toutes les dictatures militaires droitières apparues dans le monde à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Je veux parler de l’Indonésie, de la Grèce, de l’Uruguay, du Brésil, du Paraguay, d’Haïti, de la Turquie, des Philippines, du Guatemala, du Salvador, et, bien sûr, du Chili. L’horreur que les États-Unis ont infligée au Chili en 1973 ne pourra jamais être expiée et ne pourra jamais être oubliée.
Des centaines de milliers de morts ont eu lieu dans tous ces pays. Ont-elles eu lieu? Et sont-elles dans tous les cas imputables à la politique étrangère des États-Unis? La réponse est oui, elles ont eu lieu et elles sont imputables à la politique étrangère américaine. Mais vous n’en savez rien.
Ça ne s’est jamais passé. Rien ne s’est jamais passé. Même pendant que cela se passait, ça ne se passait pas. Ça n’avait aucune importance. Ça n’avait aucun intérêt. Les crimes commis par les États-Unis ont été systématiques, constants, violents, impitoyables, mais très peu de gens en ont réellement parlé. Rendons cette justice à l’Amérique : elle s’est livrée, partout dans le monde, à une manipulation tout à fait clinique du pouvoir tout en se faisant passer pour une force qui agissait dans l’intérêt du bien universel. Un cas d’hypnose génial, pour ne pas dire spirituel, et terriblement efficace.
Les États-Unis, je vous le dis, offrent sans aucun doute le plus grand spectacle du moment. Pays brutal, indifférent, méprisant et sans pitié, peut-être bien, mais c’est aussi un pays très malin. À l’image d’un commis voyageur, il œuvre tout seul et l’article qu’il vend le mieux est l’amour de soi. Succès garanti. Écoutez tous les présidents américains à la télévision prononcer les mots « peuple américain », comme dans la phrase : « Je dis au peuple américain qu’il est temps de prier et de défendre les droits du peuple américain et je demande au peuple américain de faire confiance à son Président pour les actions qu’il s’apprête à mener au nom du peuple américain. »
Le stratagème est brillant. Le langage est en fait employé pour tenir la pensée en échec. Les mots « peuple américain » fournissent un coussin franchement voluptueux destiné à vous rassurer. Vous n’avez pas besoin de penser. Vous n’avez qu’à vous allonger sur le coussin. Il se peut que ce coussin étouffe votre intelligence et votre sens critique mais il est très confortable. Ce qui bien sûr ne vaut pas pour les 40 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ni aux 2 millions d’hommes et de femmes incarcérés dans le vaste goulag de prisons qui s’étend d’un bout à l’autre des États-Unis.
Les États-Unis ne se préoccupent plus des conflits de faible intensité. Ils ne voient plus l’intérêt qu’il y aurait à faire preuve de réserve, ni même de sournoiserie. Ils jouent cartes sur table, sans distinction. C’est bien simple, ils se fichent éperdument des Nations Unies, du droit international ou des voix dissidentes, dont ils pensent qu’ils n’ont aucun pouvoir ni aucune pertinence. Et puis ils ont leur petit agneau bêlant qui les suit partout au bout d’une laisse, la Grande-Bretagne, pathétique et soumise.
Où est donc passée notre sensibilité morale ? En avons-nous jamais eu une ? Que signifient ces mots ? Renvoient-ils à un terme très rarement employé ces temps-ci – la conscience ? Une conscience qui soit non seulement liée à nos propres actes mais qui soit également liée à la part de responsabilité qui est la nôtre dans les actes d’autrui ? Tout cela est-il mort ? Regardez Guantanamo. Des centaines de gens détenus sans chef d’accusation depuis plus de trois ans, sans représentation légale ni procès équitable, théoriquement détenus pour toujours. Cette structure totalement illégitime est maintenue au mépris de la Convention de Genève. Non seulement on la tolère mais c’est à peine si la soi-disant « communauté internationale » en fait le moindre cas. Ce crime scandaleux est commis en ce moment même par un pays qui fait profession d’être « le leader du monde libre ». Est-ce que nous pensons aux locataires de Guantanamo ? Qu’en disent les médias ? Ils se réveillent de temps en temps pour nous pondre un petit article en page six. Ces hommes ont été relégués dans un no man’s land dont ils pourraient fort bien ne jamais revenir. À présent beaucoup d’entre euxfont la grève de la faim, ils sont nourris de force, y compris des résidents britanniques. Pas de raffinements dans ces méthodes d’alimentation forcée. Pas de sédatifs ni d’anesthésiques. Juste un tube qu’on vous enfonce dans le nez et qu’on vous fait descendre dans la gorge. Vous vomissez du sang. C’est de la torture. Qu’en a dit le ministre des Affaires étrangères britannique ? Rien. Qu’en a dit le Premier Ministre britannique ? Rien. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis ont déclaré : critiquer notre conduite à Guantanamo constitue un acte hostile. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Résultat, Blair se tait.
L’invasion de l’Irak était un acte de banditisme, un acte de terrorisme d’État patenté, témoignant d’un absolu mépris pour la notion de droit international. Cette invasion était un engagement militaire arbitraire inspiré par une série de mensonges répétés sans fin et une manipulation flagrante des médias et, partant, du public ; une intervention visant à renforcer le contrôle militaire et économique de l’Amérique sur le Moyen-Orient et se faisant passer – en dernier ressort – toutes les autres justifications n’ayant pas réussi à prouver leur bien-fondé – pour une libération. Une red outable affirmation de la force militaire responsable de la mort et de la mutilation de milliers et de milliers d’innocents.
Nous avons apporté au peuple irakien la torture, les bombes à fragmentation, l’uranium appauvri, d’innombrables tueries commises au hasard, la misère, l’humiliation et la mort et nous appelons cela « apporter la liberté et la démocratie au Moyen-Orient ».
Combien de gens vous faut-il tuer avant d’avoir droit au titre de meurtrier de masse et de criminel de guerre ? Cent mille ? Plus qu’assez, serais-je tenté de croire. Il serait donc juste que Bush et Blair soient appelés à comparaître devant la Cour internationale de justice. Mais Bush a été malin. Il n’a pas ratifié la Cour internationale de justice. Donc, si un soldat américain ou, à plus forte raison, un homme politique américain, devait se retrouver au banc des accusés, Bush a prévenu qu’il enverrait les marines. Mais Tony Blair, lui, a ratifié la Cour et peut donc faire l’objet de poursuites.Nous pouvons communiquer son adresse à la Cour si ça l’intéresse. Il habite au 10 Downing Street, Londres.
La mort dans ce contexte devient tout à fait accessoire. Bush et Blair prennent tous deux bien soin de la mettre de côté. Au moins 100 000 Irakiens ont péri sous les bombes et les missiles américains avant que ne commence l’insurrection irakienne. Ces gens-là sont quantité négligeable. Leur mort n’existe pas. Un néant. Ils ne sont même pas recensés comme étant morts. « Nous ne comptons pas les cadavres » a déclaré le général américain Tommy Franks.
Aux premiers jours de l’invasion une photo a été publiée à la une des journaux britanniques ; on y voit Tony Blair embrassant sur la joue un petit garçon irakien. « Un enfant reconnaissant » disait la légende. Quelques jours plus tard on pouvait trouver, en pages intérieures, l’histoire et la photo d’un autre petit garçon de quatre ans qui n’avait plus de bras. Sa famille avait été pulvérisée par un missile. C’était le seul survivant. « Quand est-ce que je retrouverai mes bras ? » demandait-il. L’histoire est passée à la trappe. Eh bien oui, Tony Blair ne le serrait pas contre lui, pas plus qu’il ne serrait dans ses bras le corps d’un autre enfant mutilé, ou le corps d’un cadavre ensanglanté. Le sang, c’est sale. Ça salit votre chemise et votre cravate quand vous parlez avec sincérité devant les caméras de télévision.
Les 2000 morts américains sont embarrassants. On les transporte vers leurs tombes dans le noir. Les funérailles se font discrètement, en lieu sûr. Les mutilés pourrissent dans leurs lits, certains pour le restant de leurs jours. Ainsi les morts et les mutilés pourrissent-ils, dans différentes catégories de tombes.
Voici un extrait de « J’explique certaines choses », un poème de Pablo Neruda :
Et un matin tout était en feu,
et un matin les bûchers
sortaient de la terre
dévorant les êtres vivants,
et dès lors ce fut le feu,
ce fut la poudre,
et ce fut le sang.
Des bandits avec des avions, avec des Maures,
des bandits avec des bagues et des duchesses,
des bandits avec des moines noirs pour bénir
tombaient du ciel pour tuer des enfants,
et à travers les rues le sang des enfants
coulait simplement, comme du sang d’enfants.Chacals que le chacal repousserait,
pierres que le dur chardon mordrait en crachant,
vipères que les vipères détesteraient !Face à vous j’ai vu le sang
de l’Espagne se lever
pour vous noyer dans une seule vague
d’orgueil et de couteaux !Généraux
de trahison :
regardez ma maison morte,
regardez l’Espagne brisée :mais de chaque maison morte surgit un métal ardent
au lieu de fleurs,
mais de chaque brèche d’Espagne
surgit l’Espagne,
mais de chaque enfant mort surgit un fusil avec des yeux,
mais de chaque crime naissent des balles
qui trouveront un jour l’endroit
de votre cœur.Vous allez demander pourquoi sa poésie
ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles,
des grands volcans de son pays natal ?Venez voir le sang dans les rues,
venez voir
le sang dans les rues,
venez voir
le sang dans les rues ! 2
Laissez-moi préciser qu’en citant ce poème de Neruda je ne suis en aucune façon en train de comparer l’Espagne républicaine à l’Irak de Saddam Hussein. Si je cite Neruda c’est parce que je n’ai jamais lu ailleurs dans la poésie contemporaine de description aussi puissante et viscérale d’un bombardement de civils.
J’ai dit tout à l’heure que les États-Unis étaient désormais d’une franchise totale et jouaient cartes sur table. C’est bien le cas. Leur politique officielle déclarée est désormais définie comme une « full spectrum dominance » (une domination totale sur tous les fronts). L’expression n’est pas de moi, elle est d’eux. « Full spectrum dominance », cela veut dire contrôle des terres, des mers, des airs et de l’espace et de toutes les ressources qui vont avec.
Les États-Unis occupent aujourd’hui 702 installations militaires dans 132 pays du monde entier, à l’honorable exception de la Suède, bien sûr. On ne sait pas trop comment ils en sont arrivés là, mais une chose est sûre, c’est qu’ils y sont.
Les États-Unis détiennent 8000 ogives nucléaires actives et opérationnelles. 2000 sont en état d’alerte maximale, prêtes à être lancées avec un délai d’avertissement de 15 minutes. Ils développent de nouveaux systèmes de force nucléaire, connus sous le nom de « bunker busters » (briseurs de blockhaus). Les Britanniques, toujours coopératifs, ont l’intention de remplacer leur missile nucléaire, le Trident. Qui, je me le demande, visent-ils ? Oussama Ben Laden ? Vous ? Moi ? Tartempion ? La Chine ? Paris ? Qui sait ? Ce que nous savons c’est que cette folie infantile – détenir des armes nucléaires et menacer de s’en servir – est au cœur de la philosophie politique américaine actuelle. Nous devons nous rappeler que les États-Unis sont en permanence sur le pied de guerre et ne laissent entrevoir en la matière aucun signe de détente.
Des milliers, sinon des millions, de gens aux États-Unis sont pleins de honte et de colère, visiblement écœurés par les actions de leur gouvernement, mais en l’état actuel des choses, ils ne constituent pas une force politique cohérente – pas encore. Cela dit, l’angoisse, l’incertitude et la peur que nous voyons grandir de jour en jour aux États-Unis ne sont pas près de s’atténuer.
Je sais que le Président Bush emploie déjà pour écrire ses discours de nombreuses personnes extrêmement compétentes, mais j’aimerais me porter volontaire pour le poste. Je propose la courte allocution suivante, qu’il pourrait faire à la télévision et adresser à la nation. Je l’imagine grave, les cheveux soigneusement peignés, sérieux, avenant, sincère, souvent enjôleur, y allant parfois d’un petit sourire forcé, curieusement séduisant, un homme plus à son aise avec les hommes.
« Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Le Dieu de Ben Laden est mauvais. Le sien est un mauvais Dieu. Le Dieu de Saddam était mauvais, sauf que Saddam n’en avait pas. C’était un barbare. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne tranchons pas la tête des gens. Nous croyons à la liberté. Dieu aussi. Je ne suis pas un barbare. Je suis le leader démocratiquement élu d’une démocratie éprise de liberté. Nous sommes une société pleine de compassion. Nous administrons des électrocutions pleines de compassion et des injections létales pleines de compassion. Nous sommes une grande nation. Je ne suis pas un dictateur. Lui, oui. Je ne suis pas un barbare. Lui, oui. Et lui aussi. Ils le sont tous. Moi, je détiens l’autorité morale. Vous voyez ce poing ? C’est ça, mon autorité morale. Tâchez de ne pas l’oublier. »
La vie d’un écrivain est une activité infiniment vulnérable, presque nue. Inutile de pleurer là-dessus. L’écrivain fait un choix, un choix qui lui colle à la peau. Mais il est juste de dire que vous êtes exposé à tous les vents, dont certains sont glacés bien sûr. Vous œuvrez tout seul, isolé de tout. Vous ne trouvez aucun refuge, aucune protection – sauf si vous mentez – auquel cas bien sûr vous avez construit et assuré vous-même votre protection et, on pourrait vous le rétorquer, vous êtes devenu un homme politique.
J’ai parlé de la mort pas mal de fois ce soir.Je vais maintenant vous lire un de mes poèmes, intitulé « Mort ».
Où a-t-on trouvé le cadavre ?
Qui a trouvé le cadavre ?
Le cadavre était-il mort quand on l’a trouvé ?
Comment a-t-on trouvé le cadavre ?Qui était le cadavre ?
Qui était le père ou la fille ou le frère
Ou l’oncle ou la sœur ou la mère ou le fils
Du cadavre abandonné ?Le corps était-il mort quand on l’a abandonné ?
Le corps était-il abandonné ?
Par qui avait-il été abandonné ?Le cadavre était-il nu ou en costume de voyage ?
Qu’est-ce qui a fait que ce cadavre, vous l’avez déclaré mort ?
Le cadavre, vous l’avez déclaré mort ?
Vous le connaissiez bien, le cadavre ?
Comment saviez-vous que le cadavre était mort ?Avez-vous lavé le cadavre
Avez-vous fermé ses deux yeux
Avez-vous enterré le corps
L’avez-vous laissé à l’abandon
Avez-vous embrassé le cadavre
Quand nous nous regardons dans un miroir nous pensons que l’image qui nous fait face est fidèle. Mais bougez d’un millimètre et l’image change. Nous sommes en fait en train de regarder une gamme infinie de reflets.Mais un écrivain doit parfois fracasser le miroir – car c’est de l’autre côté de ce miroir que la vérité nous fixe des yeux.
Je crois que malgré les énormes obstacles qui existent, être intellectuellement résolus, avec une détermination farouche, stoïque et inébranlable, à définir, en tant que citoyens, la réelle vérité de nos vies et de nos sociétés est une obligation cruciale qui nous incombe à tous. Elle est même impérative.
Si une telle détermination ne s’incarne pas dans notre vision politique, nous n’avons aucun espoir de restaurer ce que nous sommes si près de perdre – notre dignité d’homme.
1. Harold Pinter : Le Retour. Traduction Éric Kahane. Gallimard, 1969.
2. Pablo Neruda : « J’explique certaines choses », dans Résidence sur la terre, III. Traduction Guy Suarès. Gallimard, 1972.
Traduction Séverine Magois
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.