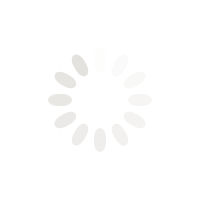Herta Müller – Conférence Nobel
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Spanish
Spanish [pdf]
Le 7 décembre 2009
Chaque mot en sait long sur le cercle vicieux
TU AS UN MOUCHOIR ? me demandait ma mère au portail tous les matins, avant que je ne parte dans la rue. Je n’en avais pas. Étant sans mouchoir, je retournais en prendre un dans ma chambre. Je n’en avais jamais, car tous les jours, j’attendais cette question. Le mouchoir était la preuve que ma mère me protégeait le matin. Le reste de la journée, pour les autres sujets, je me débrouillais seule. La question TU AS UN MOUCHOIR ? était un mot tendre détourné. Direct, il aurait été gênant, ça ne se faisait pas chez les paysans. L’amour était travesti en question. On ne pouvait l’exprimer que sèchement, d’un ton impérieux, comme les gestes du travail. C’était même la brusquerie de la voix qui soulignait la tendresse. Tous les matins, au portail, j’étais d’abord sans mouchoir, et j’attendais d’en avoir un pour m’en aller dans la rue ; c’était comme si, grâce au mouchoir, ma mère avait été présente.
Et vingt ans plus tard, à la ville, j’étais depuis longtemps seule, traductrice dans une usine de construction mécanique. Je me levais à cinq heures et prenais mon travail à six heures et demie. Le matin, diffusé par le haut-parleur, l’hymne national retentissait dans la cour de l’usine. À la pause de midi, c’étaient des chœurs d’ouvriers. Quant aux ouvriers attablés, ils avaient les yeux vides comme du fer-blanc, les mains barbouillées de graisse, et leur casse-croûte était emballé dans du papier journal. Avant de manger leur tranche de lard, ils grattaient l’encre d’imprimerie qui était dessus. Deux années de train-train quotidien s’écoulèrent.
La troisième année marqua la fin de l’égalité des jours. En l’espace d’une semaine, je vis arriver trois fois dans mon bureau, tôt le matin, un géant à la lourde ossature et au regard d’un bleu étincelant : un colosse des services secrets.
La première fois, il m’insulta en restant debout et s’en alla.
La deuxième fois, il enleva sa parka, l’accrocha à la clé du placard et s’assit. Ce matin-là, j’avais apporté des tulipes de chez moi, et je les arrangeais dans le vase. Tout en me regardant, il loua ma singulière expérience de la nature humaine. Il avait une voix onctueuse qui me sembla louche. Je refusai le compliment : je m’y connaissais en tulipes, pas en êtres humains. Il rétorqua d’un air narquois qu’il en savait plus long sur ma personne que moi sur les tulipes. Et il partit, sa parka sur le bras.
La troisième fois, il s’assit et je restai debout, car il avait posé sa serviette sur ma chaise. Je n’osai pas la mettre par terre. Il me traita d’idiote finie, de fainéante, de femme facile, aussi infecte qu’une chienne errante. Il repoussa le vase au bord du bureau et, au milieu, posa un crayon et une feuille de papier. Il hurla : écrivez ! Debout, j’écrivis sous sa dictée mon nom, ma date de naissance et mon adresse. Puis : quel que soit le degré de proximité ou de parenté, je ne dirai à personne que je … et voici l’affreux mot roumain : colaborez, que je collabore. Ce mot, je ne l’écrivis pas. Je posai le crayon, allai à la fenêtre et regardai, au dehors, la rue poussiéreuse. Elle n’était pas asphaltée, elle avait des nids-de-poule et des maisons bossues. Cette ruelle délabrée s’appelait toujours Strada Gloriei, rue de la Gloire. Un chat était juché sur un mûrier tout dépouillé, rue de la Gloire. C’était le chat de l’usine, celui à l’oreille déchirée. Au-dessus de lui, un soleil matinal, comme un tambour jaune. Je fis : n-am caracterul. Je n’ai pas ce caractère-là. Je le dis à la rue, dehors. Le mot “caractère” exaspéra l’homme des services secrets. Il déchira la feuille et jeta les bouts de papier par terre. Mais à l’idée qu’il devrait présenter à son chef cette tentative de recrutement, il se baissa et ramassa tous les morceaux qu’il flanqua dans sa serviette. Puis il poussa un gros soupir et, dans sa déconfiture, lança le vase de tulipes contre le mur : il s’y fracassa, et on entendit comme un grincement de dents en plein vol. La serviette sous le bras, il marmonna : tu le regretteras, on te noiera dans le fleuve. Je fis en aparté : si je signe ça, je ne pourrai plus vivre avec moi-même, donc j’en viendrai là. Autant que vous vous en chargiez. La porte du bureau étant déjà ouverte, il était parti. Dehors, dans la Strada Gloriei, le chat de l’usine avait sauté de l’arbre sur le toit de la maison. Une branche se balançait comme un trampoline.
Le lendemain, les tracasseries commencèrent. On voulait que je quitte définitivement l’usine. Tous les matins à six heures et demie, je devais me présenter chez le directeur. Et à chaque fois, il y avait dans son bureau le chef du syndicat et le secrétaire du Parti. Comme ma mère avec sa question d’autrefois tu as un mouchoir ?, le directeur me demandait tous les matins : tu as trouvé un nouveau travail ? Je répondais régulièrement : je n’en cherche pas, je me sens bien à l’usine, je voudrais y rester jusqu’à la retraite.
Un matin, à mon arrivée, je trouvai mes gros dictionnaires par terre dans le couloir, devant la porte de mon bureau. J’ouvris, c’était un ingénieur qui l’occupait. Il dit : ici, on frappe avant d’entrer. C’est moi qui suis là, tu n’as rien à y faire. Je ne pouvais pas rentrer à la maison : il ne fallait pas leur fournir ce prétexte, on m’aurait licenciée pour cause d’absence injustifiée. Je n’avais plus de bureau, mais il fallait à tout prix que je vienne travailler normalement tous les jours, il était hors de question de manquer.
Les premiers temps, mon amie me libéra un coin de son bureau – à chaque fois je lui racontais tout, en rentrant par la misérable Strada Gloriei. Jusqu’au matin où, postée à l’entrée de son bureau, elle déclara : je n’ai pas le droit de te laisser entrer. Tout le monde dit que tu es une balance. Désormais, les tracasseries venaient d’en bas, c’étaient des rumeurs qui circulaient parmi les collègues. Et ça, c’était le pire. On peut se défendre contre des attaques, mais face aux calomnies, on est impuissant. Jour après jour, dans mes calculs, je ne donnais pas cher de ma peau. Mais la perfidie, je n’en venais pas à bout. Mes calculs ne la rendaient pas supportable. La calomnie vous couvre de boue et on étouffe, faute de pouvoir se défendre. Dans l’esprit de mes collègues, j’étais précisément ce que j’avais refusé d’être. Si je les avais espionnés, ils auraient eu une confiance aveugle en moi. Au fond, ils me punissaient de les avoir épargnés.
Comme je ne devais surtout pas être absente, même si je n’avais plus de bureau et que mon amie ne me prêtait plus le sien, je traînais dans la cage d’escalier sans savoir que faire. Je montais et descendais les marches. Et tout à coup, je redevins l’enfant de ma mère, car J’AVAIS UN MOUCHOIR. Je le posai sur une marche entre le premier et le deuxième étage, le lissai bien comme il faut, et m’assis dessus. Mes gros dictionnaires sur les genoux, je me mis à traduire des descriptions de machines hydrauliques. J’avais l’esprit de l’escalier, et un mouchoir en guise de bureau. À l’heure du déjeuner, mon amie venait s’asseoir à côté de moi. Nous mangions ensemble, comme nous l’avions fait dans son bureau et, auparavant, dans le mien. Depuis le haut-parleur de la cour, les chœurs d’ouvriers chantaient comme toujours le bonheur du peuple. Tout en mangeant, mon amie se lamentait sur mon sort, à ma différence. Moi, je devais rester forte pendant longtemps. Quelques semaines interminables, jusqu’au licenciement.
Ayant l’esprit de l’ESCALIER, je cherchai ce mot dans le dictionnaire pour savoir de quoi il retournait : la marche du bas est dite de DÉPART, celle du haut est la marche PALIÈRE. La partie horizontale sur laquelle on pose le pied s’appelle le GIRON, et la partie en saillie sur le nu de la contremarche est le NEZ. Le COLLET, c’est le petit côté d’une marche. Grâce aux pièces des machines-outils hydrauliques et barbouillées de graisse, je connaissais déjà les jolis termes que sont QUEUE D’ARONDE, COL DE CYGNE ; sur un tour, c’était la VIS-MÈRE qui soutenait les vis. Et j’étais tout aussi fascinée par la beauté de la langue technique, par les noms poétiques désignant les parties de l’escalier. NEZ, COLLET : l’escalier avait par conséquent un visage. Qu’est-ce qui pousse donc l’être humain à intégrer son propre visage même aux objets les plus encombrants, qu’ils soient en bois, en pierre, en béton ou en fer, et à donner à un outillage inanimé le nom de sa propre chair, à le personnifier en y voyant des parties du corps ? Les spécialistes d’une technique ont-ils besoin de cette tendresse cachée pour rendre supportable un travail ardu ? Est-ce que chaque travail, dans n’importe quel métier, obéit au même principe que la question de ma mère sur le mouchoir ?
Quand j’étais petite, à la maison, il y avait un tiroir à mouchoirs avec deux rangées comportant chacune trois piles :
À gauche, les mouchoirs d’homme pour mon père et mon grand-père.
À droite, les mouchoirs de femme pour ma mère et ma grand-mère.
Au milieu, les mouchoirs d’enfant pour moi.
Ce tiroir était notre portrait de famille, en format mouchoir de poche. Les mouchoirs d’homme, les plus grands, avaient sur le pourtour des rayures foncées en marron, gris ou bordeaux. Ceux de femme étaient plus petits, avec un liseré bleu clair, rouge ou vert. Encore plus petits et sans liseré, ceux d’enfant formaient un carré blanc orné de fleurs ou d’animaux. Dans chaque catégorie de mouchoirs, il y avait ceux pour tous les jours, sur le devant, et ceux du dimanche, au fond. Le dimanche, le mouchoir devait être assorti aux vêtements, même si on ne le voyait pas.
À la maison, le mouchoir comptait plus que tout, et même plus que nous. Il était d’une utilité universelle en cas de rhume, saignement de nez, écorchure à la main, au coude ou au genou, il servait à essuyer les larmes ou, si on le mordait, à les retenir. Contre la migraine, on appliquait sur le front un mouchoir imbibé d’eau froide. Noué aux quatre coins, il protégeait la tête des insolations ou de la pluie. Pour ne pas oublier quelque chose, on y faisait un nœud en guise de pense-bête. Pour porter un sac lourd, on enroulait son mouchoir autour de sa main. On l’agitait en signe d’adieu, au départ du train. Et comme “train” se dit TREN en roumain et que le mot “larme” se dit TRÄN en dialecte du Banat, le grincement des roues sur les rails m’a toujours fait penser aux pleurs. Dans mon village, quand quelqu’un mourait chez soi, on lui nouait aussitôt un mouchoir autour du menton pour maintenir la bouche fermée jusqu’à la rigidité cadavérique. Et si quelqu’un, étant sorti, tombait à la renverse au bord du chemin, il y avait toujours un passant pour lui couvrir le visage de son mouchoir – là, le mouchoir était le premier repos du mort.
En été, les jours de canicule, les parents envoyaient leurs enfants au cimetière arroser les fleurs en fin de soirée. Par groupes de deux ou trois, nous allions de tombe en tombe, en arrosant vite. Puis, bien serrés contre les autres sur les marches de la chapelle, nous regardions les traînées de vapeur qui montaient de la plupart des tombes. Elles volaient quelque temps dans l’air noir et disparaissaient. Pour nous, c’étaient les âmes des morts : des silhouettes d’animaux, des lunettes, des fioles et des tasses, des gants et des chaussettes. Et, çà et là, un mouchoir blanc avec le noir liseré de la nuit.
Plus tard, j’eus des entretiens avec Oskar Pastior pour écrire mon livre sur sa déportation dans un camp de travail soviétique, et il me raconta qu’une vieille mère russe lui avait donné un mouchoir de batiste. Peut-être que vous aurez de la chance, mon fils et toi, et que vous pourrez bientôt rentrer chez vous, avait dit la Russe. Son fils avait l’âge d’Oskar Pastior et il était tout aussi éloigné de sa maison, mais dans une autre direction, selon elle, dans un bataillon pénitentiaire. Mendiant à demi mort de faim, Oskar Pastior avait frappé à sa porte ; il voulait échanger un boulet de charbon contre un peu de nourriture. Elle le laissa entrer, lui donna une soupe bien chaude, et comme il avait le nez qui coulait dans l’assiette, ce mouchoir blanc de batiste n’ayant jamais servi. Avec son bord ajouré, ses faisceaux et ses rosettes méticuleusement brodés au fil de soie, ce mouchoir était d’une beauté qui étreignit le mendiant tout en le blessant. Cet objet ambigu était, d’une part, un réconfort en batiste, et, d’autre part, un centimètre aux bâtonnets de soie, petits traits blancs sur la graduation de la déchéance. Pour cette femme, Pastior était lui-même un être ambigu, entre mendiant détaché du monde et enfant perdu dans le monde. Double personnage, il fut comblé et dépassé par le geste d’une femme qui, elle-même, était à ses yeux deux personnes : une étrangère et une mère aux petits soins demandant TU AS UN MOUCHOIR ?
Depuis que je connais cette histoire, j’ai moi aussi une question : la phrase TU AS UN MOUCHOIR est-elle universellement valable, s’étend-elle sur la moitié du monde, dans le scintillement de la neige, des frimas au dégel ? Franchit-elle toutes les frontières, entre les monts et les steppes, pour entrer dans un immense empire parsemé de camps pénitentiaires et de camps de travail ? Reste-t-elle increvable, cette question, malgré le marteau et la faucille, ou même tous les camps de rééducation sous Staline ?
J’ai beau parler roumain depuis des lustres, c’est en m’entretenant avec Oskar Pastior que j’ai pris conscience, pour la première fois, que “mouchoir” se dit en roumain BATISTÀ. Encore la sensualité de cette langue roumaine qui, avec une simplicité absolue, envoie ses mots au cœur des choses. La matière ne fait pas de détours, elle se désigne comme un mouchoir déjà confectionné, BATISTÀ, à croire que tous les mouchoirs du monde sont toujours en batiste …
Oskar Pastior a conservé dans son paquetage cette relique d’une double mère ayant un double fils, et il l’a rapportée chez lui au bout de cinq années passées au camp. Pourquoi ? Son mouchoir blanc était l’espoir et la peur. Abandonner l’espoir ou la peur, c’est mourir.
Après cette conversation sur le mouchoir de batiste, je fis pour Oskar Pastior un collage sur une carte blanche, jusque tard dans la nuit.
Ici dansent des points, dit Bea
tu entres dans un verre à pied de lait
linge blanc cuve en zinc vert-de-gris
contre remboursement s’accordent
presque toutes les matières
regarde par là
je suis le trajet en train et
la cerise dans le porte-savon
ne parle jamais aux étrangers ni
de la centrale
La semaine d’après, quand je suis venue le voir pour lui offrir le collage, il m’a dit : il faut que tu rajoutes : POUR OSKAR. J’ai répondu : ce que je te donne t’appartient, tu le sais bien. Et il a fait : il faut que tu le mettes dessus, la carte ne le sait peut-être pas. Je l’ai rapportée chez moi, et j’y ai ajouté : POUR OSKAR. Je la lui ai redonnée la semaine d’après, comme si, arrivée au portail sans mouchoir, j’étais retournée en chercher un.
C’est encore par un mouchoir que se termine une autre histoire.
Le fils de mes grands-parents s’appelait Matz. Dans les années trente, on l’envoya en apprentissage à Timisoara pour qu’il reprenne l’épicerie familiale où l’on vendait aussi des grains. À l’école, il y avait des professeurs venus du Reich allemand, de vrais nazis. Cet apprentissage a fait de Matz un vague commerçant et surtout un nazi, par un lavage de cerveau planifié. Nouvelle recrue, Matz était fanatique au terme de son apprentissage. Il aboyait des slogans antisémites, l’air absent, comme un débile mental. Mon grand-père lui a sonné les cloches plusieurs fois, en lui rappelant que toute sa fortune venait de prêts consentis par des amis juifs qui étaient dans les affaires. Il lui est même arrivé de gifler son petit-fils qui ne voulait rien entendre. Matz n’avait plus sa tête : il jouait à l’idéologue rural et martyrisait les tire-au-flanc de son âge qui refusaient de partir pour le front. Il avait un emploi de bureau dans l’armée roumaine. Mais, quittant la théorie pour passer à la pratique, il s’engagea comme volontaire dans la SS ; il voulait monter au front. Quelques mois plus tard, il revint chez lui pour se marier. Échaudé par les crimes vus au front, il se servit d’une formule magique qui fonctionnait, afin d’échapper à la guerre durant quelques jours. Cette formule était la permission pour mariage.
Tout au fond d’un tiroir, ma grand-mère avait deux photos de son fils Matz, une photo de mariage et une photo de décès. Sur la photo de mariage, une mariée en blanc, grave et fine, le dépasse d’un empan, une madone en plâtre portant sur la tête une couronne en fleurs de cire comme enneigées. À côté d’elle, Matz en uniforme nazi. Un soldat, et non un marié. L’hymen et l’hymne à la patrie d’un dernier soldat. À peine était-il reparti au front que sa photo de décès arriva, montrant un soldat, le dernier des derniers, déchiqueté par une mine. Cette photo a la taille d’une main : un champ noir avec, au beau milieu, un drap blanc, et dessus, un tas humain de couleur grise. Sur fond noir, ce drap blanc a la taille d’un mouchoir d’enfant avec, au milieu du carré blanc, un drôle de dessin. Pour ma grand-mère, cette photo était encore celle d’une dualité : sur le mouchoir blanc, il y avait un nazi mort, et dans sa mémoire, un fils vivant. Au fil des ans, elle a gardé ce double portrait dans son missel. Elle priait tous les jours, et ses prières devaient être ambiguës, elles aussi. Il faut croire que, suivant la faille d’un fils aimé devenu nazi forcené, elles demandaient au Seigneur d’exécuter le même grand écart, d’aimer ce fils et de pardonner au nazi.
Mon grand-père avait été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il savait de quoi il parlait, quand il répétait amèrement, au sujet de son fils Matz : hé oui, dès qu’on agite le drapeau, le bon sens dérape et file dans la trompette. Cette mise en garde visait aussi la dictature dans laquelle j’ai vécu ensuite. Des profiteurs, petits ou gros, on en voyait tous les jours avoir la raison qui filait dans la trompette. Quant à moi, je décidai de ne pas claironner.
On me força tout de même, quand j’étais petite, à jouer de l’accordéon, car à la maison, il y avait l’accordéon rouge de Matz, le soldat défunt. Comme les bretelles étaient trop longues pour moi, mon professeur d’accordéon me les attachait dans le dos avec un mouchoir pour les empêcher de glisser sur l’épaule.
Autant dire que les moindres objets, même une trompette, un accordéon ou un mouchoir, relient ce que la vie a de plus disparate : les objets décrivent des cercles et, jusque dans leurs écarts, ils ont tendance à se conformer à la répétition, au cercle vicieux. On peut le croire, mais pas le dire. Et ce qui est impossible à dire peut s’écrire, puisque l’écriture est un acte muet, un travail partant de la tête pour aller vers la main, en évitant la bouche. Sous la dictature, j’ai beaucoup parlé, surtout parce que j’avais décidé de ne pas claironner. Mes paroles ont presque toujours eu des conséquences insoutenables. Mais l’écriture a commencé par le silence, dans cet escalier d’usine où, livrée à moi-même, j’ai dû tirer de moi davantage que la parole ne le permettait. La parole ne pouvait plus exprimer ce qui se passait. Elle faisait à la rigueur des ajouts adventices, sans évoquer leur portée. Cette dernière, je n’avais d’autre ressource que de l’épeler en silence dans ma tête, dans le cercle vicieux des mots, lorsque j’écrivais. Face à la peur de la mort, ma réaction fut une soif de vie. Une soif de mots. Seul le tourbillon des mots parvenait à formuler mon état. Il épelait ce que la bouche n’aurait su dire. Dans le cercle vicieux des mots, je talonnais le vécu jusqu’à ce qu’apparaisse une chose que je n’avais pas connue sous cette forme. Parallèle à la réalité, la pantomime des mots entre en action. Loin de respecter les dimensions réelles, elle diminue l’essentiel et amplifie ce qui est accessoire. Le cercle vicieux des mots prend ses jambes à son cou, il enseigne au vécu une sorte de logique enchantée. Sa pantomime est à la fois furieuse et anxieuse, et tout aussi avide que blasée. Le thème de la dictature entre en jeu de son propre chef, car l’évidence ne reviendra plus jamais : chacun en a été entièrement spolié ou peu s’en faut. Cette thématique est présente de façon implicite, mais ce sont les mots qui prennent possession de moi. Et ils entraînent le thème où bon leur semble. Plus rien ne va comme de juste et tout est vrai.
Dans mon escalier, j’étais aussi seule qu’à l’époque où je gardais les vaches dans la vallée. Je mangeais des feuilles et des fleurs pour être des leurs, puisqu’elles savaient comment vivre et que je l’ignorais. Je les appelais par leur nom. Celui de chardon laiteux devait bien désigner cette plante épineuse aux tiges pleines de lait, sauf que la plante ne répondait pas au nom de chardon laiteux. Je tentai le coup avec des noms inventés, ÉPINECÔTE, COUDAIGUILLE, ne comportant ni lait, ni chardon. Dans cette supercherie de tous les faux noms de la vraie plante, la lacune débouchait sur un vide béant, la honte de parler toute seule et non avec la plante. Mais cette honte me faisait du bien. Gardée par la sonorité des mots, je gardais les vaches.
Chaque mot dans la figure
en sait long sur le cercle vicieux
et ne le dit pas
La sonorité des mots sait qu’elle doit tromper, puisque les objets trichent sur leur matière, les sentiments sur leurs gestes. À l’intersection où convergent la tromperie des matières et celle des gestes vient se nicher la sonorité avec sa vérité forgée de toutes pièces. Dans l’écriture, il ne saurait être question de confiance, mais plutôt d’une franche tromperie.
À l’usine, quand j’étais la mauvaise blague qu’on lâche dans l’escalier, avec un mouchoir pour tout bureau, j’ai aussi trouvé dans le dictionnaire le beau mot d’ÉCHELONNEMENT. Il signifie que les intérêts d’un prêt augmentent par paliers, en gravissant des échelons. Ces intérêts croissants sont pour l’un des débours, et pour l’autre des rentrées. Dans l’écriture, ce sont les deux, à mesure que je me plonge dans le texte. Plus l’écrit me dévalise, plus il montre au vécu ce qu’il n’y avait pas dans ce qu’on vivait. Seuls les mots le découvrent, vu qu’ils ne le savaient pas auparavant. C’est lorsqu’ils surprennent le vécu qu’ils le reflètent le mieux. Ils deviennent si concluants que le vécu doit s’agripper à eux pour ne pas se désintégrer.
À mon sens, les objets ne connaissent pas leur matière, et les gestes ignorent leurs sentiments, comme les mots ignorent la bouche qui les dit. Mais pour nous convaincre de notre propre existence, nous avons besoin d’objets, de gestes et de mots. Plus nous pouvons prendre de mots, plus nous sommes libres, tout de même. Quand notre bouche est mise à l’index, nous tentons de nous affirmer par des gestes, voire des objets. Plus malaisés à interpréter, ils n’ont rien de suspect, pendant un temps. Ils peuvent nous aider à convertir l’humiliation en une dignité qui, pendant un temps, n’a rien de suspect.
Peu avant que je n’émigre de Roumanie, le policier du village est venu arrêter ma mère, au petit matin. Arrivée au portail, la voilà qui se dit tout à coup : TU AS UN MOUCHOIR ? Elle n’en avait pas. L’agent avait beau être impatient, elle est retournée en chercher un. Une fois au poste, le policier a tempêté, mais ma mère ne savait pas assez le roumain pour comprendre ses vociférations. Il a quitté le bureau en verrouillant la porte de l’extérieur. Ma mère est restée enfermée toute la journée : les premières heures, elle a pleuré, assise à la place du policier, puis elle a fait les cent pas, et s’est mise à dépoussiérer les meubles avec son mouchoir mouillé de larmes. Ensuite, elle a pris un seau d’eau dans un coin, un essuie-mains accroché à un clou, et elle a lavé le sol. En l’entendant me le raconter, j’ai été horrifiée : comment ça, tu as nettoyé le bureau de ce type ? Elle a répondu, nullement gênée : je devais m’activer pour passer le temps. Et puis, c’était tellement crasseux … Heureusement que j’avais emporté un grand mouchoir d’homme !
À ce moment-là, j’ai compris que cette humiliation supplémentaire, mais délibérée, lui avait permis de garder sa dignité lors de son arrestation. Dans un de mes collages, j’ai cherché des mots pour rendre cela :
Je pensais à la vigoureuse rose du cœur
à l’âme infructueuse comme une passoire
mais le propriétaire demanda :
qui prend le dessus
je dis : sauver sa peau
il cria : la peau n’est
qu’une tache une batiste offensée
dénuée de bon sens
Pour ceux que la dictature prive de leur dignité tous les jours, jusqu’à aujourd’hui, je voudrais pouvoir dire ne serait-ce qu’une phrase comportant le mot “mouchoir”. Leur demander simplement : AVEZ-VOUS UN MOUCHOIR ?
Se peut-il que cette question, de tout temps, ne porte nullement sur le mouchoir, mais sur la solitude aiguë de l’être humain …
Traduction par Claire de Oliveira

Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.