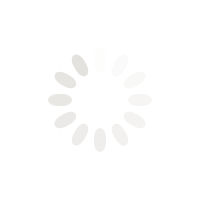Mo Yan – Conférence Nobel
English
Swedish
French
German
Spanish
Chinese (pdf)
Le 7 décembre 2012
Ceux qui content des histoires
Mesdames et Messieurs les membres de cette honorable Académie, Mesdames, Messieurs :
Je me dis que, grâce à la télévision et à la toile, vous tous ici présents avez désormais une petite idée de ce à quoi peut bien ressembler le canton de Dongbei à Gaomi. Peut-être avez-vous aperçu sur toutes ces images mon vieux père, âgé de quantre-vingt dix ans, mes frères et ma sœur, mon épouse, ma fille et ma petite fille de quatorze mois. Mais il est quelqu’un, en cet instant, vers qui vont toutes mes pensées, c’est ma mère, que vous ne verrez jamais. Beaucoup de personnes ont partagé avec moi l’honneur de ce prix, mais pour ma mère c’est chose impossible.
Née en 1922, elle est décédée en 1994. Ses cendres ont été enterrées dans le verger de pêchers à l’est du village. L’an dernier, une voie ferrée devait passer par là, nous avons été contraints de transporter sa tombe en un lieu encore plus éloigné du village. Quand nous avons ouvert la sépulture, nous avons constaté que le cercueil avait pourri, que les cendres s’étaient déjà mêlées à la glèbe. Nous n’avons pu que, de façon toute symbolique, prélever un peu de cette glèbe afin de la placer dans la nouvelle tombe. J’ai compris alors que ma mère faisait désormais partie de la matière même de la terre aussi, quand dressé sur cette terre, je raconte une histoire, c’est à ma mère que je m’adresse.
Je suis le petit dernier de ma mère.
Mon premier souvenir : je tiens à la main l’unique thermos de la maison, je me rends à la cantine commune pour le remplir d’eau bouillante. Je suis affaibli par la faim, le thermos m’échappe et se brise à terre. Mort de peur, je me faufile dans une meule de foin. Je n’oserai en sortir de toute la journée. À la tombée du jour, j’entends ma mère m’appeler par mon petit nom. Je me glisse hors de la meule, je m’attends à des réprimandes et à des coups, il n’en est rien, ma mère me caresse la tête en soupirant longuement.
Mon souvenir le plus pénible : je vais avec ma mère glaner les épis de blé sur les terres collectives, arrive le préposé à la surveillance des champs, les glaneurs s’égaillent de tous côtés, ma mère a eu les pieds bandés, elle ne peut courir vite, elle est rattrapée, le surveillant, un homme de haute stature, lui donne une gifle. Elle vacille, tombe à terre. L’homme s’en va, la tête haute en sifflotant, après avoir confisqué les épis que nous avons ramassés. Du sang coule des coins de la bouche de ma mère, elle est assise sur le sol, je ne pourrai jamais plus oublier l’expression de désespoir inscrite sur son visage. Bien des années après, alors que l’homme était devenu un vieillard aux cheveux blancs, nous nous sommes rencontrés au marché, je me suis rué sur lui dans l’intention de me venger, ma mère m’a retenu, elle m’a dit d’une voix calme :
« Mon fils, celui qui m’a frappé et ce vieil homme ne sont pas une même personne. »
Le souvenir qui est resté le plus ancré dans ma mémoire : un midi de la fête de la mi-automne, fait exceptionnel, nous avons pu confectionner des raviolis, un bol chacun, pas plus. Comme nous sommes en train de les manger, un vieux mendiant passe devant notre porte. Je lui donne un demi-bol de patates douces séchées, mais lui de me dire, indigné : « Je suis un vieillard et vous me donnez des patates douces alors que vous, vous mangez des raviolis, c’est ça votre charité ? » Très énervé, je lui réponds : « Nous n’avons droit à des raviolis que de rares fois dans l’année, et encore un petit bol par personne, pas de quoi tromper sa faim ! On te donne des patates douces séchées, c’est déjà pas mal, si t’en veux pas, fiche le camp ! » Ma mère me réprimande puis, tenant à deux mains son bol qui n’était rempli qu’à moité, elle verse les raviolis dans celui du vieillard.
Ce que je regrette le plus : Je vais avec ma mère vendre des choux au marché, intentionnellement ou non, je fais payer un centime de trop à un vieil homme venu nous en acheter. Une fois les comptes faits, je me rends à l’école. De retour à la maison après les classes, je vois que ma mère, qui pleure rarement, a le visage inondé de larmes. Elle ne me gronde pas, elle me dit doucement : « Mon fils tu m’as fait honte. »
Alors que j’avais une dizaine d’années, ma mère contracta une sévère tuberculose, la faim, la maladie, le dur travail physique plongèrent notre famille dans une situation difficile, nulle lumière, nul espoir à l’horizon. J’éprouvais une sinistre appréhension, craignant que ma mère, à n’importe quel moment, ne décide de mettre fin à ses jours. Chaque fois que je revenais du travail, en franchissant le portail, j’appelais ma mère, quand elle me répondait, j’avais l’impression que la pierre qui pesait sur mon cœur tombait à terre mais si, sur le moment, elle ne me répondait pas, je grelottais de froid intérieurement, je courais à sa recherche dans l’aile latérale, dans la pièce à moudre. Un jour, je parcourus ainsi toutes les pièces sans apercevoir l’ombre de ma mère, alors je m’assis au beau milieu de la cour et me mis à pleurer, à ce moment-là, mère rentra, portant sur le dos un fagot de bois. Mes pleurs la contrarièrent, mais je ne pouvais pas lui avouer les raisons de mon inquiétude. Devinant ce que je pensais, elle me dit : « Mon enfant, rassure-toi, bien que la vie ne soit pas pour moi une partie de plaisir, loin s’en faut, je ne partirai que lorsque le Roi des enfers m’appellera. »
Je suis né laid, de nombreuses personnes au village se moquaient ouvertement de moi. À l’école, quelques camarades, jouant les tyrans, m’ont frappé pour cela. Rentré à la maison, j’ai pleuré, ma mère m’a dit : « Mon fils tu n’es pas laid. Tu as un nez, des yeux, tous tes membres, en quoi serais-tu laid ? Et puis, du moment que ton cœur reste bon, que tu fais de bonnes actions, même si tu étais laid, tu pourrais devenir beau. » Plus tard, en ville, alors que des gens très cultivés, à leur tour, se sont moqués derrière mon dos, voire ouvertement, de mon physique, j’ai repensé à ce que m’avait dit ma mère et je me suis excusé auprès d’eux en toute sérénité.
Ma mère était illettrée, mais elle tenait en grande estime ceux qui avaient de l’instruction. La vie était difficile pour nous, souvent, quand un repas était assuré, le suivant restait hypothétique, cependant, chaque fois que je parlais d’acheter des livres ou de la papeterie, elle acquiesçait à ma demande. C’était une personne diligente, elle détestait les enfants paresseux, mais jamais elle ne m’a critiqué s’il m’arrivait de prendre du retard dans mon travail à cause de mes lectures.
Pendant un certain temps vint au marché un conteur. J’allais l’écouter en cachette, oubliant le travail qu’elle m’avait demandé de faire. À cette occasion, oui, elle m’adressait des critiques. Quand, le soir, à la lueur d’une petite lampe à huile elle s’affairait à confectionner des vêtements ouatinés pour la maisonnée, c’était plus fort que moi, il fallait que je lui raconte l’histoire que j’avais entendue de la bouche du conteur. Au début, cela l’agaçait car, dans son esprit, les conteurs étaient tous des beaux parleurs qui n’avaient pas un emploi convenable, rien de bon ne pouvait sortir de ces bouches-là. Mais, peu à peu, ces récits que je lui répétais l’enchantèrent. Par la suite, les jours de marché, elle ne me donna plus de travail à faire, c’était un consentement tacite à ce que j’aille écouter le conteur. Pour lui rendre sa bonté, et pour faire étalage de l’excellence de ma mémoire, je lui racontais, de façon haute en couleur, les histoires que j’avais entendues dans la journée.
Très vite, je ne me suis plus contenté du simple processus de répétition, je ne cessais d’enjoliver mon récit, ajoutant des choses qui pouvaient lui plaire, innovant sur le plan de l’intrigue, allant même parfois jusqu’à changer le dénouement. Mon auditoire ne se limitait pas à ma seule mère, en effet, ma sœur aînée, ainsi que ma tante et ma grand-mère paternelles s’étaient jointes à elle. Après la séance, ma mère, préoccupée disait parfois, comme si elle s’adressait à moi, ou bien se parlait à elle-même : « Ah, mon fils, quel genre d’homme seras-tu plus tard ? Est-ce que par hasard tu aurais l’idée de gagner ta croûte grâce à ton bagou? »
Je comprenais son inquiétude car, dans un village, un enfant bavard se rend souvent odieux et il peut même s’attirer des ennuis et en occasionner à sa famille. Dans ma nouvelle Le veau, derrière le personnage de l’enfant qui agace tout le monde, se profile l’ombre du gamin que j’ai été. Ma mère me rappelait souvent que je devais moins parler, elle attendait de moi que je fusse un enfant taciturne, réservé, généreux. Mais voilà, il se trouvait que j’étais doté d’une grande propension à la parole ce qui, sans aucun doute, était extrêmement dangereux. D’un autre côté, mes talents de conteur lui procuraient du plaisir, elle se trouvait donc en proie à de grandes contradictions.
Comme le dit le proverbe, « Il est plus facile de remodeler fleuves et montagnes que de changer la nature d’un homme. » Mes parents avaient beau me faire maintes recommandations, je n’ai pas modifié pour autant mon naturel, celui d’un incorrigible bavard, si bien que mon nom Mo Yan, celui qui ne parle pas, sonne vraiment comme de l’autodérision.
Alors que je n’étais pas encore diplômé du primaire, je dus interrompre ma scolarité. Vu mon jeune âge, et comme j’étais malingre, je ne pouvais accomplir de durs travaux, il ne me restait plus qu’à aller faire paître vaches et moutons sur la friche de la grève. Quand je passais devant la porte de l’école, tirant mes bêtes, je voyais mes camarades d’autrefois chahuter dans la cour, j’étais triste, je ressentais toute la souffrance qu’éprouve l’être humain, – fût-il un enfant – une fois séparé de son groupe.
Arrivé sur la friche, je laissais les bêtes paître en toute liberté. Le ciel était bleu comme la mer, la steppe s’étendait à perte de vue, alentour, il n’y avait pas l’ombre d’un humain, nul bruit de voix, seuls les oiseaux chantaient dans le ciel. Je me sentais bien solitaire, si solitaire que j’en avais l’esprit vide. Parfois, allongé dans l’herbe, je regardais les nuages blancs passer paresseusement et alors se présentaient à moi de mystérieuses visions. Chez nous circulent maintes histoires sur des renardes qui se transforment en belles femmes. Je m’imaginais que l’une d’entre elles viendrait me tenir compagnie tandis que je faisais paître les bêtes, mais cela ne s’est jamais produit. Une fois cependant, un renard couleur de feu est sorti d’un fourré devant moi, j’ai eu si peur que je me suis retrouvé d’un coup accroupi sur le sol ; alors qu’il avait déjà filé sans laisser de trace, j’étais encore là tout tremblant. Parfois je me mettais à la hauteur d’une vache qui broutait, je regardais ses yeux d’un bleu intense, ainsi que mon reflet tout au fond. Parfois j’imitais les cris des oiseaux, dans l’espoir d’engager un dialogue avec eux, à d’autres moments, je confiais à un arbre ce que j’avais sur le cœur, mais ni l’oiseau, ni l’arbre ne prêtaient attention à moi. Bien des années plus tard, une fois devenu écrivain, ces rêveries que j’avais eues en ce temps-là devinrent matériaux pour mes romans. Je reçois beaucoup d’éloges pour mon imagination débordante, certains amoureux de la littérature me demandent mon secret pour développer cet imaginaire, sur ce point, je ne peux leur répondre que par un sourire forcé.
Comme le dit Laozi, cet ancien sage chinois : « Le malheur s’appuie sur le bonheur et dans le bonheur couve le malheur », si mon enfance a été cruellement marquée par l’abandon de la scolarité, la faim, la solitude et l’absence de livres toutefois, comme Shen Congwen, écrivain de la génération précédente, très tôt je me suis frotté au grand livre de la vie en société et l’épisode relaté ci-dessus au sujet du conteur au marché n’en constitue qu’une simple page.
Après l’arrêt de ma scolarité, je me suis retrouvé mêlé au monde des adultes, alors a commencé ce long parcours de « lecture auditive ». Il y a deux cents ans notre contrée avait vu naître Pu Songling, conteur talentueux s’il en fut, or nous sommes nombreux au pays, moi y compris, à avoir repris le flambeau. En ai-je entendu, dans les champs travaillés collectivement, dans les étables et les écuries de l’équipe de production, sur le kang bien chauffé de mes grands-parents, et même sur les chars à bœuf brinquebalants, de ces histoires d’esprits et de démons, de ces légendes historiques et autres anecdotes captivantes ! Toutes étaient liées intimement à l’environnement naturel local, à l’histoire du clan, cela m’a donné un sens aiguisé du réel.
Jamais, même en rêve, je n’aurais pu penser que tout cela, un jour, servirait de matériau à mon écriture. À l’époque, je n’étais qu’un gamin fasciné par les histoires, j’écoutais avec ivresse les récits des autres. À l’époque, j’étais convaincu, absolument, de l’existence des esprits, je pensais que tous les êtres de l’univers, sans exception, étaient dotés d’intelligence aussi, à la vue d’un grand arbre, étais-je rempli de vénération. Si j’apercevais un oiseau, il me semblait qu’il pourrait à tout moment se transformer en être humain et, à l’inverse, si je rencontrais un inconnu, je me prenais à douter qu’il ne s’agisse peut-être d’un animal changé en humain. Chaque soir, quand je quittais la salle de décompte des points de travail pour rentrer chez moi, une crainte infinie m’encerclait ; pour me donner du courage, je courais comme un fou tout en chantant à tue-tête. Ma voix qui muait était éraillée, désagréable à l’oreille, ces chants étaient un supplice pour mes compatriotes.
J’ai passé vingt-et un ans au pays, pendant cette période, la fois où je m’en suis le plus éloigné, ce fut pour aller à Qingdao en train, j’ai même bien failli me perdre parmi les énormes bois de construction d’une scierie, si bien que, lorsque ma mère m’a demandé comment était le paysage à Qingdao, je lui ai répondu, très déprimé : « Je n’ai rien vu, sauf des tas de bois, et encore des tas de bois ! » C’est pourtant ce voyage qui a fait se lever en moi l’ardent désir de quitter le pays pour voir le monde.
En février 1976, j’ai été enrôlé comme conscrit, j’ai quitté le canton de Dongbei à Gaomi, ce lieu aimé et abhorré tout à la fois. Je portais sur le dos Compendium de l’histoire de Chine en quatre volumes que ma mère m’avait acheté avec l’argent de la vente de ses bijoux de noce. Une période importante de ma vie commençait. Je dois reconnaître que sans les changements et les progrès gigantesques qu’a connus la Chine ces trente dernières années, sans la politique d’ouverture et de réforme, il n’y aurait pas l’écrivain que je suis.
Pris dans la monotonie de la vie à la caserne, j’ai salué la libéralisation de la pensée et l’essor de la littérature qui ont marqué les années quatre-vingt. L’enfant qui écoutait les histoires de toutes ses oreilles, celui qui en racontait à son tour, s’est essayé à le faire, non plus avec sa bouche, mais avec un stylo. Au début, le chemin s’est révélé plutôt raboteux, à cette époque, je n’avais pas encore pris conscience que ces vingt années d’expérimentation de la vie que j’avais passées au village étaient un riche filon pour la création littéraire. Je croyais que la littérature était faite de personnages de haute moralité ainsi que de leurs actions méritantes, c’est-à-dire de héros exemplaires ; certes, j’avais réussi à publier certaines choses, mais leur valeur littéraire était faible.
À l’automne 1984, j’ai réussi l’examen d’entrée dans la section « Littérature » de l’Institut des Arts de l’APL. Sous la direction inspirée et bienveillante de l’illustre professeur et écrivain Xu Huaizhong, j’ai écrit une première fournée de petits romans et de nouvelles : Crue d’automne, La rivière tarie, Le radis de cristal, Le clan du sorgho. Dans Crue d’automne apparaît pour la première fois la mention « canton de Dongbei à Gaomi », alors, tel un paysan qui, après une longue errance, trouve un coin de terre, moi, ce vagabond de la littérature, j’ai trouvé le lieu où me fixer. Je dois reconnaître que, lors du processus de fondation de ce territoire des Lettres, « canton de Dongbei à Gaomi», j’ai été grandement inspiré par l’écrivain américain William Faulkner et par l’écrivain colombien Gabriel García Márquez. Non que je les eusse lus d’une lecture diligente, mais leur esprit libre et inventif m’a stimulé, m’a fait comprendre qu’un écrivain se devait d’avoir un lieu qui lui était propre. Si dans la vie courante il convient de se montrer humble et de faire des concessions, dans le domaine de la création littéraire, il faut savoir se montrer arrogant et autoritaire. Après deux années où j’ai marché dans les pas de ces deux grands maîtres, j’ai pris conscience que je devais au plus vite prendre mes distances avec eux ; en effet, j’ai écrit dans un article : « Ils sont comme deux fourneaux brûlants et moi, comme ferait un bloc de glace, si je m’approche trop près d’eux, je vais m’évaporer ». Selon mon expérience, la raison fondamentale qui fait qu’un écrivain est influencé par un autre écrivain, est qu’il existe au fond de l’âme des deux protagonistes dans ce type de relation quelque chose d’analogue. Et c’est justement cela que désigne l’expression : « Être en communion d’idées ». Aussi, même si je n’avais pas lu assidûment leurs œuvres, au bout de quelques pages, j’avais compris comment ils fonctionnaient et, du même coup, ce que je devais faire et comment m’y prendre.
Ce que je devais faire était d’ailleurs très simple, il me fallait avancer, raconter mes histoires à moi, et le faire à ma manière. Cette manière était celle, si familière pour moi, des conteurs sur le marché, celle de mes grands-parents, celle des anciens du village. À dire vrai, quand je raconte une histoire, je ne réfléchis pas à un auditeur, ce pourrait être quelqu’un comme ma mère, ou bien moi-même. Les histoires que je racontais au début étaient basées sur mon vécu, c’est vrai pour le personnage de l’enfant roué de coups dans La rivière tarie, pour celui qui ne dit pas un mot de tout le récit dans Le radis de cristal. J’ai effectivement été rossé sévèrement par mon père pour une faute que j’avais commise, tout comme j’ai actionné moi aussi le soufflet pour un maître forgeron sur le chantier d’un pont. Mais, bien sûr, une expérience personnelle, aussi singulière soit-elle, ne saurait s’inscrire telle quelle dans une œuvre romanesque, laquelle doit relever de la fiction, de l’imaginaire. Ils ont été nombreux parmi mes amis à me dire que Le radis de cristal était le meilleur de mes romans, je n’irai pas leur opposer un démenti, comme je me garderai d’abonder dans leur sens, toutefois, je considère que c’est là la plus symbolique de mes œuvres, la plus lourde de sens. Cet enfant, à la peau toute noire, qui possède une résistance surhumaine à la douleur, ainsi que des facultés sensorielles hors norme, est l’âme de ma création romanesque tout entière. Bien que, dans mes œuvres postérieures, j’aie dépeint de nombreux personnages, aucun n’est si proche que lui de mon âme. Ou, pour le dire autrement, parmi les personnages que modèle un écrivain, il y a toujours une figure motrice, et c’est ce rôle que joue cet enfant qui garde le silence. Il ne parle pas, mais il dirige avec force toutes sortes de personnages, il déploie tout son jeu sur cette scène qu’est le canton de Dongbei à Gaomi.
L’histoire d’un individu est limitée, quand on a fini de se raconter, il faut raconter l’histoire des autres. C’est ainsi que celle de ma parenté, des gens de mon village, et même celle des ancêtres, recueillie de la bouche des anciens, toutes ces histoires dis-je, pareilles à des soldats obéissant à un ordre de rassemblement, jaillissent du plus profond de ma mémoire. Elles m’observent avec des regards pleins d’espoir dans l’attente que je les couche sur le papier. Si mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles et mes tantes, ma femme et ma fille ont fait leur apparition dans mes œuvres, c’est vrai aussi pour maints de mes compatriotes du canton de Dongbei. Tout naturellement, j’ai procédé, en ce qui les concerne, à des remaniements à caractère littéraire, si bien qu’ils s’en sont trouvés transcendés, devenant des personnages de roman.
Dans Grenouilles, mon dernier roman, est apparue la figure de ma tante. Comme je venais d’avoir le prix Nobel, de nombreux journalistes se sont rendus chez elle pour l’interviewer ; au début, elle répondait aux questions avec patience mais, très vite, elle en a eu assez et est partie se réfugier chez son fils, au chef-lieu du district. Ma tante a été effectivement le modèle dont je me suis servi lors de l’écriture de ce roman, mais la tante qui apparaît dans le roman est aux antipodes de la tante en chair et en os. La première est brutale et autoritaire, parfois, elle ressemble carrément à un brigand au féminin, alors que la vraie tante est bienveillante et a l’esprit ouvert, c’est la bonne épouse et la bonne mère par excellence. Dans son grand âge elle a connu une vie heureuse et accomplie, tandis que celle du roman est sujette à l’insomnie car c’est une âme qui souffre ; elle va, vêtue de noir, telle une âme errante, elle rôde dans la nuit. Je tiens à remercier ma tante pour sa mansuétude, elle ne s’est pas fâchée à propos de la description que j’ai faite d’elle dans le roman ; j’admire également sa sagesse, elle a saisi avec justesse la complexité des liens tissés entre le personnage fictionnel et la personne réelle.
Après la disparition de ma mère, j’ai éprouvé un immense chagrin et j’ai décidé de lui consacrer un livre. Il s’agit de Beaux seins, belles fesses, comme le projet mûrissait depuis longtemps et que j’étais submergé par l’émotion, j’ai écrit le premier jet de ce roman de cinq cent mille caractères en seulement quatre-vingt-trois jours.
Dans ce livre, je me suis servi, sans aucune retenue, de matériaux ayant trait à la vie de ma mère, mais le vécu émotionnel de la mère dans le roman est fictionnel, quand il ne puise pas dans celui de nombreuses mères du canton de Dongbei. L’exergue en tête de ce livre, « À l’âme de ma mère dans l’au-delà », est en fait dédié à toutes les mères sous le ciel, avec la même ambition, quelque peu prétentieuse, qui me pousse à faire de ce minuscule lieu qu’est « le canton de Dongbei à Gaomi » une Chine, voire une humanité en réduction.
Le processus de création est particulier à chaque écrivain, c’est vrai aussi pour chacun de mes livres, l’inspiration de départ et son mûrissement dans mon esprit ne sont pas les mêmes à chaque fois. Certains d’entre eux partent d’un rêve, c’est le cas pour Le radis de cristal, d’autres encore d’un événement qui s’est réellement produit, comme dans La mélopée de l’ail paradisiaque Mais quel que soit le point de départ, au final, il faut que l’œuvre se conjugue avec le vécu personnel ; c’est pour elle le garant d’un caractère bien marqué, celui de pouvoir camper un grand nombre de personnages types, faits d’une foule de détails vivants, de mettre en œuvre une langue riche et colorée et, en ce qui concerne la structure, des trésors d’invention. Une chose mérite d’être mentionnée : dans La mélopée de l’ail paradisiaque j’ai fait entrer en scène un authentique conteur et lui ai distribué un rôle des plus importants. Je m’excuse sincèrement d’avoir utilisé le vrai nom de ce conteur, mais il est évident que tous les actes de ce personnage dans le livre restent fictionnels. Dans le processus d’écriture qui est le mien, un phénomène est récurrent : au début, j’emploie le vrai nom du personnage, et je le fais dans l’espoir de me sentir plus proche de lui, une fois l’œuvre achevée, quand je me dis que je devrais changer son nom, je sens que ce n’est déjà plus possible. Et voilà pourquoi des gens, éponymes de tel personnage d’un roman, sont venus trouver mon père pour lui exprimer leur mécontentement, il s’en est excusé auprès d’eux en mon nom, tout en leur faisant comprendre qu’ils ne devaient pas prendre tout cela pour argent comptant. Il leur a dit : « La première phrase du roman Le clan de sorgho est la suivante : ‘Mon père cette graine de brigand’. Or si cela ne me dérange pas plus que ça, vous, qu’est-ce qui vous gêne à la fin ? ».
Lors de l’écriture de romans comme La mélopée de l’ail paradisiaque romans qui collent de près à la réalité sociale, la question la plus grave qui s’est posée à moi n’a pas été de savoir si oui ou non j’avais le courage de mener une critique contre les aspects sombres de la société, mais si cette ferveur et cette colère dévorantes que je ressentais n’allaient pas laisser le politique l’emporter sur le littéraire, faire de ce roman la chronique d’un fait de société. L’écrivain fait partie de la société, il prend tout naturellement position et a son propre point de vue, mais lorsqu’il passe à l’acte d’écrire, il doit se placer sur le plan de l’humain, et décrire tous les hommes à partir de ce point de vue. C’est ainsi seulement que la littérature, tout en initiant l’événement, le transcende, qu’elle s’intéresse au politique tout en se plaçant sur un plan supérieur.
Peut-être la vie difficile que j’ai menée pendant si longtemps m’a-t-elle donné une compréhension assez profonde de la nature humaine. Je sais ce qu’est le vrai courage et aussi ce qu’est la vraie compassion. Je sais que dans le cœur de chaque homme il y a une zone d’ombre que l’on peut difficilement cerner à l’aulne du vrai et du faux, du bien et du mal, or cette zone offre à l’écrivain un vaste champ où déployer son talent. Toute œuvre qui dépeint de façon juste et vivante cette zone d’ombre faite de contradictions, nécessairement, transcendera le politique et présentera les qualités que l’on attend de l’excellence en littérature.
Parler en abondance de ses propres œuvres est ennuyeux pour les autres, mais ma vie et mes œuvres sont si intimement liées que, si je n’avais pas parlé de ces dernières, j’aurais eu le sentiment de ne pas savoir par où commencer. Aussi je prie chacun de vous de bien vouloir m’en excuser.
Dans mes premières œuvres, en tant que conteur moderne, je me suis tenu caché derrière le texte, mais avec Le supplice du santal, j’ai fini par sauter des coulisses jusqu’à l’avant-scène. Si l’on peut dire que mes œuvres de jeunesse relevaient du soliloque, sans souci d’un quelconque lecteur, avec ce livre, j’ai eu le sentiment de me tenir debout sur une place, face à un auditoire fourni, tandis que je faisais une relation haute en couleur. Telle a été la tradition romanesque de par le monde et, encore plus, celle de la Chine. Je me suis essayé, autrefois, au roman moderne occidental, j’ai aussi joué avec toutes sortes de modes de narration pourtant, au final, je suis revenu à la tradition. Bien sûr, ce retour ne s’est pas effectué d’une façon conservatoire. Le supplice du santal et les romans qui ont suivi sont un mixte sur le plan stylistique, ils perpétuent la tradition du roman classique chinois tout en empruntant à la technique du roman occidental. Ce qu’on entend par « innovation » dans le domaine romanesque est fondamentalement le produit de ce type de mixte, lequel mêle aussi à l’œuvre des apports d’autres disciplines artistiques. Ainsi, dans Le supplice du santal, l’apport d’éléments venus de l’opéra populaire ou, dans des œuvres du début, celui des Beaux-arts, de la musique, voire des acrobaties.
Enfin, permettez-moi de parler un peu de La dure loi du karma. Ce titre vient des canons bouddhiques, d’après ce que j’en sais, le traduire a été un casse-tête pour les traducteurs dans les différents pays. Je n’ai pas étudié en profondeur les textes bouddhiques, ma compréhension du bouddhisme est donc très superficielle, si j’ai retenu ce titre, c’est que, selon moi, maintes pensées fondamentales du bouddhisme montrent une connaissance authentique de l’univers. Pour les bouddhistes, les nombreux litiges qui ont cours en ce bas monde sont sans intérêt. Ce monde aperçu de ce point de vue le plus élevé semble tellement affligeant ! Bien évidemment, je n’ai pas écrit ce livre en forme de sermon, j’ai parlé de destinées humaines, de sentiments, des limites de l’être humain, de sa tolérance, des efforts et des sacrifices qu’il fait pour chercher le bonheur et persévérer dans ses convictions. Le personnage de Lan Lian dans ce roman, se confrontant seul à la tendance générale de l’époque, est à mes yeux un héros authentique. Le prototype de ce personnage est un paysan d’un village voisin du mien ; dans mon enfance, je l’ai souvent vu passer dans la rue devant notre porte, avec sa carriole à roues de bois qui grinçait et qui était tirée par un âne à la patte gangrenée. Lui poussait derrière, sa femme aux petits pieds allait devant, menant la bête. Dans la société collectivisée de l’époque, une telle association dans le travail semblait si étrange, si déphasée ; à nos yeux d’enfants, ils passaient pour de petits clowns qui avançaient à contre-courant de l’Histoire, nous allions même, quand ils marchaient dans la rue, jusqu’à leur lancer des pierres, sous l’effet d’une juste indignation. Les années ont passé, quand j’ai pris ma plume, ce personnage, cette scène se sont présentés à mon esprit. J’ai toujours su qu’un jour ou l’autre je finirais par écrire un livre sur lui, par raconter son histoire au monde entier, mais ce n’est qu’en 2005, alors que j’étais dans un temple et que je regardais une fresque murale sur le samsara, ou la transmigration par les six voies, que j’ai pris conscience de la juste méthode pour raconter cette histoire.
L’attribution du Prix Nobel de littérature qui m’a été faite a soulevé des polémiques. Au début, j’ai pensé qu’elles me concernaient directement mais, peu à peu, j’ai eu le sentiment que la personne visée n’avait rien à voir avec moi. J’étais comme le spectateur d’une pièce de théâtre qui regarde une représentation donnée par la multitude. J’ai vu les fleurs tomber à profusion sur celui qui avait été primé, et aussi les pierres qu’on lui lançait, l’eau sale qu’on déversait sur lui. J’ai eu peur qu’il ne fût mis à bas, mais il s’est glissé en souriant d’entre les fleurs et les pierres, a essuyé l’eau sale qu’il avait sur lui, très calme, il s’est tenu sur un côté et a déclaré :
Pour un écrivain, la meilleure façon de parler c’est l’écriture. Tout ce que j’ai à dire, je l’écris dans mes œuvres. Les paroles qui sortent de la bouche se dispersent au vent, celles qui naissent sous la plume jamais ne s’effacent. J’espère que vous aurez la patience de lire un peu mes livres. Je n’ai bien sûr pas qualité pour vous imposer cette lecture. Et, en admettant que vous les lisiez, je n’attends pas de vous que vous puissiez changer d’avis sur moi, aucun auteur de par le monde n’a réussi à se faire apprécier de la totalité des lecteurs. Et c’est encore plus vrai à notre époque.
J’aimerais me taire mais, en une telle occasion, je me dois de parler, je vais donc ajouter quelques phrases, en toute simplicité.
Je suis un homme qui conte des histoires, c’est donc des histoires que je vais vous conter.
Dans les années soixante du siècle dernier, alors que j’étais en troisième année de primaire, l’école a organisé pour nous la visite d’une exposition sur les souffrances passées. Là, sous la conduite de notre maître, nous avons éclaté en sanglots. Pour que ce dernier puisse lire l’expression attendue sur mon visage, je ne voulais pas essuyer mes larmes. J’ai vu quelques camarades se mettre, en guise de larmes, de la salive sur les joues. J’ai repéré aussi, dans la masse des élèves qui pleuraient plus ou moins sincèrement, un camarade dont le visage ne portait aucune trace de larmes et dont la bouche ne proférait aucun son, il ne cachait même pas son visage dans ses mains. Il nous regardait, les yeux ronds, avec une expression de surprise ou de perplexité. Après coup, j’ai informé le maître de la conduite de cet élève. La conséquence fut qu’il reçut un avertissement de l’école. Plusieurs années plus tard, comme j’exprimais à cet instituteur à quel point j’étais désolé pour cette dénonciation, le maître me dit que, ce jour-là, une dizaine d’élèves étaient venus le trouver pour la même raison. Le camarade en question était mort dix ans plus tôt, chaque fois que je pense à lui, j’éprouve de profonds regrets. Cet incident m’a permis de comprendre la vérité suivante : quand tout le monde pleure, il faut tolérer que certains ne pleurent pas. Et c’est encore plus vrai lorsque les pleurs sont ainsi mis en scène.
Une autre histoire : il y a trente ans, je travaillais encore à l’armée. Un soir, alors que je lisais dans le bureau, un chef âgé poussa la porte, il regarda la place vacante en face de moi et se dit à lui-même : « Tiens, il n’y a personne ? » Je me levai sur le champ et demandai haut et fort : « Et moi alors, je compte pour personne ? ». Le vieil homme rougit jusqu’aux oreilles à ma réplique et se retira tout embarrassé. Je devais m’enorgueillir longtemps de cet incident, je me considérais alors comme un lutteur courageux, mais bien des années plus tard, j’en ai éprouvé de profonds remords.
Permettez-moi une dernière histoire que j’ai entendue, il y a fort longtemps, de la bouche de mon grand-père. Il s’agissait de huit maçons, partis travailler dans une autre région. Pour se protéger d’une tempête, ils s’étaient réfugiés dans un temple délabré. Le tonnerre ne cessait de gronder par coups répétés, des boules de feu roulaient à l’extérieur de la porte, il leur semblait entendre des cris de dragon éclater dans les airs. Ils étaient tous livides, saisis d’épouvante. L’un d’eux dit : « Il y a forcément quelqu’un parmi nous qui a commis un forfait provoquant ainsi la colère du Ciel, or donc, que celui-là sorte du temple pour recevoir le châtiment qu’il mérite et afin de ne pas impliquer dans cette affaire des hommes de bien. » Évidemment, personne ne voulut sortir. Quelqu’un d’autre proposa : « Puisque personne ne veut sortir, lançons chacun notre propre chapeau hors du temple, le chapeau qui sera emporté à l’extérieur désignera le coupable et celui-ci devra s’exécuter. » Et tous d’obtempérer. Sept chapeaux furent rejetés à l’intérieur du temple, un seul fut emporté au loin. Les autres pressèrent l’homme en question de sortir recevoir le châtiment, mais ce dernier, bien sûr, ne voulut rien entendre. Les autres le portèrent et le jetèrent à l’extérieur. Quant au dénouement de cette histoire, je suppose que vous l’avez tous deviné… À peine l’homme avait-il été jeté à l’extérieur que le temple délabré s’écroulait dans un fracas de tonnerre.
Je suis un homme qui conte des histoires.
C’est pour cette raison que j’ai obtenu le prix Nobel de littérature.
Après cette attribution, il s’est produit des tas d’histoires merveilleuses, elles m’ont convaincu que la vérité et la justice existent bel et bien.
Dans les années à venir, je vais continuer de conter mes histoires.
Je vous remercie.
Traduction par Chantal Chen-Andron
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 12 laureates' work and discoveries range from proteins' structures and machine learning to fighting for a world free of nuclear weapons.
See them all presented here.