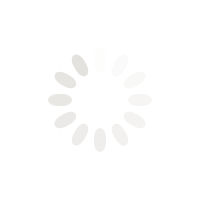Léon Jouhaux – Conférence Nobel
Conférence Nobel, prononcé à Oslo le 11 décembre 1951
Cinquante ans d’action syndicale en faveur de la paix
Mesdames, Messieurs,
Je ne vous surprendrai certainement point en vous assurant qu’une des plus profondes émotions de ma vie, une des plus heureuses aussi, me fut causée le lundi soir 5 novembre 1951 par ce journaliste dont j’ai déjà évoqué l’initiative à la Radiodiffusion française et qui empressé, pour satisfaire sa conscience professionnelle, à m’arracher une sensationnelle déclaration, vint m’annoncer à une heure déjà tardive que le Comité du Storting Norvégien pour le Prix Nobel de la Paix venait de me décerner l’une des plus honorables et des plus flatteuses distinctions mondiales.
Je ne sais s’il a été déçu par mon accueil et par le rapport que je fis spontanément de ma personne à la classe ouvrière organisée dans les syndicats, quant à l’attribution de ce prix qui honore à la fois son fondateur, ceux qui ont la haute mission de le décerner, et celui qui le reçoit, mais je puis vous affirmer que pas un instant, aussi bref fut-il, je n’ai cru que c’était moi seul qui étais l’objet de cette haute récompense.
Je n’ai jamais cessé de m’efforcer d’être l’interprète fidèle et le serviteur dévoué de l’idéal de paix et de justice de nos organisations syndicales et en cet instant solennel, il était naturel que je m’estime toujours leur simple représentant. Comme je le serai lorsque j’évoquerai tout à l’heure devant vous la permanence de leur action pour l’avènement tant désiré par tous les peuples d’une ère pacifique au cours de laquelle, pour reprendre l’expression de Jean Jaurès, «l’humanité enfin réconciliée avec elle-même», poursuivra son destin dans la concorde et dans la joie.
Mon émotion n’en fut pas moins fort vive. Ni mes amis, ni ma famille mieux renseignée encore, n’ont jamais mis en doute la robustesse de mes nerfs. On m’aurait plutôt volontiers reproché – et parfois avec une certaine truculence pas toujours bienveillante–un calme que certains appelaient placidité. Et il est vrai que la nature m’a suffisamment doté de patience et de sangfroid. Mais je mentirais en vous déclarant que, la porte fermée sur le journaliste courant à son marbre, je me suis fort tranquillement endormi. Ce soir-là, cette nuit-là, j’ai vainement cherché un sommeil décidé à me fuir.
Et durant ces longues heures, des souvenirs en foule m’ont assailli.
Je revoyais ma maison natale disparue en 1898 avec l’abattoir de Grenelle. Je n’avais pas tout à fait deux ans lorsque mes parents la quittèrent pour s’installer, après un bref séjour en province, à Aubervilliers. Cette ville si proche de Paris où je passai ma jeunesse était l’Aubervilliers de la fin du dernier siècle. Encore plus qu’à moitié agricole, il ne ressemblait guère à la cité industrielle d’aujourd’hui. Il nous offrait, à nous autres enfants, de grands espaces libres couverts de blé en été, et la claire rivière de la Courneuve qui coulait à proximité nous donnait les plaisirs de la baignade et de la natation.
Cette vie quasi campagnarde fit de moi un homme robuste et équilibré et, malgré la modestie de notre vie de famille et ses aléas, je garde de cette période de ma vie une image assez agréable.
Cependant, c’est à Aubervilliers que je sentis pour la première fois peser sur moi les dures conséquences de la lutte des travailleurs pour l’amélioration de leurs conditions d’existence. Elles eurent même sur ma destinée une influence considérable.
Mon père, ancien combattant de la Commune, mais dont la défaite ouvrière de 1871 n’avait abattu ni les convictions ni l’ardeur combative, participa avec persévérance et énergie aux grèves qui dressèrent les ouvriers de la Manufacture d’allumettes où il travaillait contre la Compagnie fermière qui précéda la mise en régie. La vaillance de ma mère qui avait repris son métier de cuisinière ne pouvait pas compenser la suppression du salaire paternel et, à l’occasion d’une de ces grèves, je dus quitter l’école primaire avant ma douzième année pour entrer au Fondoir Central d’Aubervilliers.
Mes parents, et tout spécialement ma mère inspirée par le directeur de l’école communale que je fréquentais, voulaient néanmoins faire de moi un élève d’une Ecole Nationale des Arts et Métiers et plus tard un ingénieur. J’avais le goût de l’étude et des dispositions naturelles pour la mécanique et j’entrai à l’école primaire supérieure Colbert. Des revers familiaux m’obligèrent à la quitter moins d’un an après et j’allai travailler à la Savonnerie Michaux. Malgré une autre tentative scolaire qui me fit passer encore un an à l’Ecole professionnelle Diderot, c’est bien de cette époque, c’est bien à partir de ma quatorzième année que j’ai été mêlé intimement à la dure vie des travailleurs de l’industrie.
A seize ans, j’adhérai au Syndicat de la Manufacture d’allumettes où je venais d’entrer rejoindre mon père. Cette adhésion ne me coûta aucun débat de conscience. L’exemple viril de mon père et ma propre expérience me portaient tout naturellement à participer à l’action ouvrière. J’avais souffert personnellement de l’ordre social. Mon travail scolaire, mes dispositions intellectuelles, mon goût de l’étude n’avaient servi à rien; j’avais brutalement été rejeté de l’Ecole primaire supérieure, de l’Ecole professionnelle même et j’avais été contraint à n’être qu’un salarié d’une des plus humbles catégories.
En ce jour consacré à célébrer dans tous les pays l’anniversaire de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, je veux, avec une passion qu’avivent ces souvenirs de mon adolescence privée du droit d’atteindre son plein épanouissement intellectuel, exprimer ma certitude que grâce à l’action des véritables syndicalistes et des démocrates sincères, tous les droits inaliénables et sacrés de l’homme lui seront dorénavant reconnus sans nulle restriction et qu’il pourra les exercer sans entrave.
Le sentiment de l’épreuve injustement subie m’avait porté à fréquenter la bibliothèque du groupe libertaire d’Aubervilliers, un des rares endroits où je pouvais intellectuellement m’évader de ma condition et j’avais renforcé par la lecture des auteurs que j’y trouvais mes sentiments de révolte contre l’ordre établi et l’injustice sociale.
Mon propos est de retracer les progrès de l’action ouvrière syndicale pour la Paix internationale; je négligerai donc tous ses autres aspects, mais afin de souligner par un exemple personnel ses résultats positifs dans le domaine de la protection sanitaire des travailleurs, je donnerai les motifs de la première grève à laquelle j’ai participe, à laquelle j’ai participé d’ailleurs non seulement comme adhérent du syndicat, mais encore en qualité de Secrétaire administratif, c’est-à-dire pour donner de cette fonction et des responsabilités qui m’incombaient une idée exacte et somme toute assez humble, de rédacteur de procès-verbaux des réunions du conseil syndical, des Assemblées générales et parfois des délégations. Je ne crois pas que je devais cette marque de confiance à ma valeur syndicale, je la devais plus vraisemblablement à mon instruction un peu moins sommaire que celle de mes camarades: les grandes lois scolaires de la jème République n’avaient pas encore dix ans.
Décidée par la Fédération Nationale des Ouvriers et Ouvrières des Manufactures d’allumettes, adhérente elle-même à la C.G.T. qui venait de se constituer en 1895, cette grève intéressa l’ensemble de la corporation et elle avait pour objectif principal l’interdiction dans la fabrication, du phosphore blanc dont l’emploi était loin d’être sans danger particulièrement pour la dentition du personnel. Elle dura plus d’un mois, mais eut pour conséquence directe la réunion de la Conférence de Berne qui interdit l’emploi de la matière nocive. Ce premier succès ne pouvait évidemment que m’encourager à persévérer dans l’action syndicale qui répondait en même temps à mon désir de travailler contre l’iniquité et à mon besoin juvénile de réalisations tangibles.
Une autre conséquence de cette grève fut l’emploi de la machine dite «continue» qui accroissait la production tout en diminuant la peine des travailleurs. Elle me fit comprendre que le syndicalisme, instrument de libération ouvrière et de transformation sociale pouvait être et même devait être un facteur de progrès industriel. Je ne tardai pas à voir également en lui un des moyens les plus efficaces pour éloigner du monde le spectre toujours menaçant de la guerre.
Pourquoi cacherais-je, pourquoi tairais-je, Mesdames et Messieurs, que le premier aspect du combat syndical en faveur de la Paix, du combat syndical français tout particulièrement auquel je fus mêlé avec toute l’ardeur de ma jeunesse, fut l’antimilitarisme en paroles et quelquefois aussi en actes. Un des plus grands péchés contre l’esprit ne consiste-t-il point à cacher sciemment la vérité? Et ne serait-il pas ridicule de reprocher au Mouvement syndical d’avoir confondu la cause et l’effet? Les sociologues dignes de ce nom ne commettent jamais l’erreur de reprocher aux peuplades primitives leur croyance en un mouvement du soleil autour de la terre. Nous avons, nous aussi, faute de réflexions assez profondes et de connaissances assez étendues, pris l’aspect extérieur et apparent du phénomène pour le phénomène lui-même. Je me permettrai d’ajouter que je garde de cette époque peut-être à cause du mirage que la fuite des ans provoque le souvenir d’un grand enthousiasme fait de plus d’espérance irrationnelle que de volonté constructive sans doute, mais qui me fait trouver plus amère l’atmosphère d’indifférence, de fatalisme et de résignation qui s’étend à l’heure actuelle sur notre continent que deux guerres semblent avoir ravagé aussi moralement que matériellement. Un orateur s’est un jour écrié: «Quand la guerre passe, le peuple est toujours sa principale victime.» Il avait raison plus encore qu’il ne pensait. Non seulement la guerre tue des travailleurs par milliers, que dis-je, par millions, détruit leur logis, bouleverse les champs fécondés par leurs efforts séculaires, écrase des usines élevées de leurs mains et réduit pour des années le standard de vie des masses ouvrières, mais en donnant aux hommes un sentiment plus aigu de leur impuissance devant les forces de violence, elle retarde considérablement la marche de l’humanité vers l’âge de la justice, du bien-être et de la paix.
Oh oui! nous en avions de l’enthousiasme vers 1900. Rien ne nous semblait impossible dans aucun domaine. Et nous avions quelque raison de le croire. Nous sentions déjà que Wilbur Wright, après Victor Adler, allait nous donner des ailes.
A mon retour du service militaire, j’avais repris ma place à la Manufacture et au syndicat, mais je vais dorénavant m’effacer totalement derrière l’histoire du mouvement, non qu’elle soit différente de celle de ma vie – elles se confondent au contraire depuis 1909 – mais parce que le syndicalisme, malgré les rapports étroits qu’il eut à ses débuts avec l’individualisme libertaire est essentiellement et par définition même une ouvre collective.
J’ai évoqué tout à l’heure incidemment la création de la Confédération Générale du Travail en 1895. Elle remplaçait la Fédération Nationale des Syndicats qui s’était constitutée en 1886. En fait, l’unité ouvrière au sein de la C.G.T. ne fut vraiment réalisée qu’en 1902 lorsque la Fédération des Bourses du Travail en devint, au Congrès de Montpellier, la section des Bourses, mais durant cette période de gestation de l’union totale des travailleurs, la C.G.T., dans ses Congrès annuels, s’était déjà haussée au-dessus des questions d’organisation et des revendications corporatives. Elle s’était ainsi prononcée dès 1898 en faveur du désarmement général.
«Le Congrès, déclarait la motion en un style peut-être un peu vieilli,
«Considérant que les peuples sont frères et que la guerre est la plus grande calamité de l’humanité,
«Constatant que la paix année mène tous les peuples à la ruine par le surcroît d’impôts créés pour faire face aux énormes dépenses des armées permanentes;
«Affirme que l’argent dépensé pour des actes dignes des barbares et entretenir des hommes jeunes, forts, et vigoureux, pendant plusieurs années serait mieux employé à de grands travaux pouvant servir l’humanité;
«Forme le vou qu’un désarmement général ait lieu le plus vite possible.»
En 1900 et en 1901, elle passe de l’affirmation théorique aux considérations pratiques; elle décide que «les jeunes travailleurs qui ont à subir l’encasernement devront être mis en relation avec les secrétaires de Bourses du travail où ils seront en garnison» et vote le principe de la création d’une Caisse du Sou du Soldat.
Ces déclarations et ces décisions paraissent aujourd’hui fort anodines. Il faut se garder d’oublier qu’elles étaient accompagnées d’une agitation antimilitariste assez sérieuse qui avait trouvé un solide appui dans la propagande passionnée en faveur de la révision du procès Dreyfus à laquelle s’opposaient non moins passionnément les milieux militaires dont la solidarité avec un Conseil de guerre abusé rendait injustement, mais fatalement l’armée, particulièrement ses cadres, suspects à toute l’opinion démocratique.
Les Congrès Confédéraux qui ne sont plus que bisannuels à partir de 1902 s’intéressent tous à l’action en faveur de la Paix. Celui de 1904 tenu à Bourges au moment de la guerre russo-japonaise déclare:
«Au moment où pour le plus grand bien des dirigeants et des exploiteurs qui asservissent le prolétariat du monde entier, deux Nations s’entr’égorgent et rééditent avec plus d’ampleur les hécatombes des temps passés, le Congrès … flétrit l’attitude ignoble des gouvernements des deux nations intéressées, qui, dans le but de trouver un dérivatif aux réclamations ascendantes du prolétariat, font appel aux passions chauvines et ne craignent pas d’organiser le meurtre et l’assassinat de milliers de travailleurs pour conserver leur situation privilégiée.»
Le ciel international s’obscurcit de plus en plus et l’attitude des syndicats se raidit. Le Congrès de 1900 approuve «toute action de propagande antimilitariste» et celui de 1908 envisage de répondre à la «déclaration de guerre par une déclaration de grève générale révolutionnaire». Ceux de 1910 et de 1912 confirment les résolutions antérieures et s’élèvent surtout contre la répression, mais 1912 est l’année de la guerre des Balkans et devant les compétitions qui commençaient à se manifester et risquaient de généraliser le conflit, une Conférence extraordinaire tenue le 1er octobre décide un Congrès dont le seul objectif devait être la lutte contre la guerre menaçante. La motion votée témoigne bien de la confiance qu’avaient les organisations syndicales en leur force grandissante. Pour arrêter les Gouvernements sur la pente qui les entraîne au gouffre de flammes et de sang, le Congrès agite devant eux avec plus de violence le drapeau de l’action révolutionnaire substitué à la mobilisation.
On aurait d’ailleurs une idée fausse de l’importance et de l’efficacité de l’action ouvrière si l’on s’en tenait à ces motions de Congrès. Les organisations syndicales, loin de se contenter de ces déclarations, établissaient des liaisons internationales et appuyaient toute politique d’apaisement et d’accord. Entre 1900 et 1901, la C.G.T. et la classe ouvrière anglaise contribuent l’une et l’autre à l’établissement de l’entente cordiale et pour se rendre exactement compte de la valeur de cette contribution, il suffit de songer à la tension consécutive à l’incident de Fachoda et de feuilleter les collections de publications satiriques.
Au moment des incidents d’Agadir, le 22 juillet 1911, une délégation confédérale se rendait à Berlin et au mois d’août suivant, une délégation syndicale allemande venait à Paris. Le prolétariat français et le prolétariat allemand unissaient leurs efforts pour essayer de faire reculer la guerre.
Ces contacts internationaux circonstanciels n’étaient au demeurant pas les seuls établis entre les organisations syndicales nationales. Plusieurs Congrès ouvriers internationaux avaient eu lieu après la disparition de l’Internationale ouvrière. Ils s’étaient réunis à Zurich en 1895 et à Londres en 1896 et groupaient des représentants de partis politiques de tendance socialiste et des délégués des Syndicats. A Londres en particulier, la délégation française comprenait entre autres syndicalistes: Fernand Pelloutier, les frères Guérard et Keufer. Les résultats de cette coopération – les historiens plus sévères diront peut-être de cette confusion – ne furent pas des meilleurs et l’idée d’une organisation internationale purement syndicale vit jour au Congrès des Syndicats Scandinaves à Copenhague en 1901, grâce au contact direct des délégations fraternelles. La proposition émana de Legien, représentant de la Commission Générale des syndicats allemands. Il fut alors décidé de convoquer au Congrès des syndicats allemands de Stuttgart en 1902 les différents centres nationaux. Les organisations d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, de Belgique, de Bohême, du Danemark, d’Espagne, de France, de Hollande, d’Italie, de Norvège, de Suède et de Suisse répondirent à l’appel et approuvèrent l’organisation de Conférences syndicales internationales plus ou moins périodiques. Leur mandat restait limité, il ne s’agissait encore que d’établissement de statistiques communes, d’échanges de renseignements sur les législations du travail et éventuellement de solidarité en cas de grèves importantes. C’était néanmoins le premier lien international et il se renforça à Dublin en 1903 par la création du Secrétariat Syndical international.
Notre Confédération Générale du Travail française, sans se retirer formellement du Secrétariat, suspendit, dès 1904, le paiement de ses cotisations: le secrétariat ayant refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence d’Amsterdam la question de l’antimilitarisme. Je n’irai pas jusqu’à dire que les syndicats français donnaient à la lutte pour la Paix plus d’importance que les autres; toutefois, ils y apportaient une passion plus apparente.
Les rapports furent repris à la suite du Congrès de la C.G.T. à Marseille en 1908 et d’un acquiescement du Secrétariat Syndical international à la demande de porter à l’ordre du jour de la prochaine conférence la réunion de véritables congrès internationaux.
Cette cinquième Conférence eut lieu à Paris. Elle vécut des débats animés, très animés même. Devenu Secrétaire de la C.G.T., je fue son porte-parole. J’ai récemment évoqué cette réunion dans un article et je crois ne pouvoir faire mieux que d’en citer le début, car non seulement, il situe notre position, mais encore celle du représentant de l’American Fédération of Labour.
«Je revois encore Gompers, écrivais-je, le soir du 1er septembre 1909. C’était le deuxième jour de la Conférence Internationale des Secrétariats syndicaux.
Toute la journée, j’avais demandé la réunion d’un véritable Congrès international et j’avais dû la demander avec une certains véhémence. En fin d’après-midi alors que nous avions moralement rallié la majorité à la thèse de la C.G.T. française, Gompers qui représentait les syndicats américains groupés dans l’A.F.L. vint me témoigner chaleureusement sa satisfaction!»
Il y eut encore deux Conférences, la première à Budapest en 1911, à laquelle participèrent officiellement cette fois l’A.F.L. et officieusement les Industrial Workers of the world, la seconde à Zurich en 1913. Un essai de conférence élargie, acheminement vers les Congrès internationaux que nous préconisions y fut tenté par l’appel aux Secrétariats professionnels internationaux. La résolution qui fut adoptée à Zurich recommandait aux centres syndicaux de tous les pays l’étude de la création d’une Fédération Internationale du Travail dont le but «serait la protection et l’extension des droits et intérêts des salariés de tous les pays et – j’insiste sur ce dernier membre de phrase – la réalisation de la fraternité et de la solidarité internationales».
Le mouvement syndical sortait de sa période infantile, il prenait conscience de l’ampleur de son destin. Il ne se considère plus à Zurich comme l’expression d’une seule classe la solidarité internationale qu’il veut réaliser est déjà toute autre chose que la solidarité ouvrière en cas de grève envisagée jusqu’alors. Les dramatiques événement dont la gestation se précipitait allait en accélérer la maturité.
Les hommes de ma génération n’oublieront jamais les journées de la fin de juillet 1914, ceux qui ont essayé de dresser une digue contre la marée de sang moins que les autres. A partir du 27 juillet, notre C.G.T. ne cessa de tenter l’impossible. Aux gouvernants qui gardaient encore au cour la vieille devise que les rois gravaient sur leurs canons: «ultime raison», elle opposa le bon sens populaire. «La guerre, cria-t-elle, n’est en aucune façon une solution aux problèmes posés, elle est et reste la plus effoyable des calamités humaines. Faisons tout pour l’éviter.» Le vendredi 30, elle envoya par télégramme le suprême appel au Secrétariat International, le conjurant d’intervenir par «pression sur gouvernements».
Hélas! Vous savez comme nous tous que ces efforts désespérés furent vains!
Ce désastre n’entraîna pas le renoncement à notre idéal: il nous fit préciser, dès les premiers mois du conflit les conditions de sa réalisation.
En effet, dès la fin de 1914, l’A.F.L. prit l’initiative de proposer la tenue «aux même lieu et jours où se tiendrait le Congrès pour la Paix d’une Conférence Internationale des Centrales syndicales nationales pour aider au rétablissement de bons rapports entre les prolétariats organisés et faire participer ceux-ci à rétablissement des bases d’une paix durable et définitive». Le Comité Confédéral de la C.G.T. accepta cette proposition et adressa lui-même un manifeste à toutes les Centrales syndicales. Je crois que la majeure partie de ce texte a bien moins vieilli que tous ceux qui l’ont précédé. Il conclut en demandant la suppression du régime des traites secrets, le respect absolu des nationalités, la limitation immédiate et internationale des armements, mesure qui doit précipiter leur suppression totale et enfin le recours à l’arbitrage obligatoire pour tous les conflits entre nations.
Ces idées vont faire leur chemin. Les étapes seront les Conférences de Leeds en 1916 et de Londres en septembre 1917, celles de Stockholm en juillet et de Berne en octobre de la même année.
A Leeds apparaît dans un texte syndical, avec la notion du danger couru par la classe ouvrière du fait de la concurrence capitaliste internationale l’idée d’une organisation internationale du travail. Dans le rapport établi au nom de la C.G.T., nous affirmions que le Traité de Paix devait, dans l’esprit des organisations ouvrières, poser les premières fondations des Etats-Unis d’Europe. A Londres, c’est l’idée même de la Société des Nations qui s’impose avec tous ses corollaires: le désarmement général précédé par la limitation des armements et l’arbitrage obligatoire que la C.G.T. avait lancée trois ans auparavant.
Réunis à Stockholm en juin 1917, les représentants des syndicats des pays centraux et Scandinaves se déclarent absolument d’accord avec les décisions prises à Leeds et adressent même des félicitations aux organisations syndicales des pays alliés et tout particulièrement à la C.G.T. Une autre Conférence syndicale internationale est convoquée à Berne pour le début d’octobre 1917 par l’Union Syndicale Suisse. Les Centrales nationales d’Allemagne, d’Autriche, de Bohême, de Bulgarie, du Danemark, de la Hongrie, de la Hollande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse y sont représentées et elles confirment les résolutions de Leeds et de Londres.
La Conférence Interalliée socialiste et syndicaliste de Londres en février 1918 eut peut-être plus d’importance encore. Notre organisation française y présenta un mémorandum où étaient, certes, reprises les idées émises antérieurement, mais dans lequel nous demandions la création d’une autorité supranationale, la «formation d’une Assemblée législative internationale» et «le développement graduai d’une législation internationale acceptée, par tous et les liant d’une manière précise». Nous étions en avance, très en avance même, puisque trente-trois ans plus tard ces propositions n’ont pas encore été suivies de réalisations. Une demande de la Conférence tendant à ce «qu’au moins un représentant du travail et du socialisme siège parmi les représentants officiels à cette Conférence officielle de la paix», demande reprise par la C.G.T. le 15 décembre 1918 dans des termes à peu près identiques, fut exaucée par deux gouvernements: Gompers et moi-même fûmes attachés aux délégations des U.S.A. et de la France au titre d’experts techniques. Nous avons l’un et l’autre, au nom du mouvement syndical, apporté à l’élaboration du Traité et particulièrement à l’élaboration de la Partie XIII une collaboration incessante. La classe ouvrière prenait de plus en plus une connaissance exacte des causes profondes des malaises internationaux.
Je citerai deux attendue de cette partie d’où est née l’Organisation Internationale du Travail et son organisme permanent, le B.I.T. dont je n’ai besoin de rappeler ici ni l’activité, ni les résultats tangibles qu’il a obtenus.
«Attendu, était-il écrit dans le Traité, que la Société des Nations a pour but d’établir la paix universelle et qu’une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale.
«Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelle sont mises en danger et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions.»
A partir de 1918, les syndicalistes vont exprimer à la tribune de leurs Congrès la volonté de paix des travailleurs par l’organisation rationnelle du monde. Les réunions du B.I.T. et même les Assemblées générales de la S.D.N. où plusieurs d’entre eux siégeront à maintes reprises donneront à leurs propositions un énorme retentissement. Les organisations syndicales gardent pourtant leur activité autonome. Une véritable Fédération Syndicale Internationale avait remplacé, après la Conférence Internationale de Berne de février 1919 et le Congrès d’Amsterdam de juillet 1919 le Secrétariat Syndical international. Elle avait groupé immédiatement plus de 20 millions d’adhérents. Un de ses premiers gestes fut de faire appel à la solidarité internationale pour remédier à la misère atroce qui sévissait en Autriche et les ouvriers autrichiens échappèrent à la famine grâce à de nombreux trains de ravitaillement dont les chargements furent répartis par les syndicats et les coopératives. La deuxième intervention de la F.S.I. assura le respect de la liberté syndicale en Hongrie.
Certains ont oublié – il est vrai que l’oubli comme l’ignorance est un mol oreiller – que la F.S.I. intervint avec vigueur en faveur également des ouvriers russes: ses représentants O’Grady, Wauters, puis Thomson résidèrent même en Russie jusqu’en 1923 pour y contrôler la répartition des denrées et des médicaments qu’elle envoyait. Ce n’est au surplus en rien déformer l’histoire qu’affirmer que c’est en grande partie grâce aux efforts et à la propagande de notre Fédération Internationale que le Gouvernement de l’U.R.S.S. fut reconnu par la plupart des grandes Nations.
Les syndicalistes ne limitaient d’ailleurs pas leur effort à l’atténuation des cruelles séquelles de la guerre. Ils recherchaient les moyens d’établir une paix stable et ils affirmaient avec force qu’elle devait atteindre pour base un équilibre mondial économique et social. La plupart des propositions faites ultérieurement à la S.D.N. ont leur véritable origine dans les Congrès internationaux de la F.S.I. et dans le Congrès mondial de la Paix qu’elle réunit en 1922 à La Haye. Nous demandions l’organisation des échanges, de la circulation de la main-d’ouvre, la répartition des matières premières, l’interdiction de la fabrication privée du trafic international des armes.
C’est vers cette époque que fut institutée à la S.D.N. une Commission temporaire mixte chargée d’étudier les modalités du contrôle du commerce international des armes, des munitions et du matériel de guerre. L’opinion ouvrière avait pris une telle importance que cette Commission comprit trois représentants ouvriers pris dans le Conseil d’Administration du B.I.T. Une Convention fut établie le 17 Juin 1925. Le principe du contrôle et non d’une simple publicité fut admis grâce aux efforts des membres ouvriers dont j’étais. Nous ne fûmes pas suivis jusqu’au bout, car nous avions demandé: l’internationalisation du contrôle, le contrôle de la comptabilité des entreprises, des mesures propres à empêcher l’influence sur la presse et la création de cartels internationaux ainsi que l’uniformisation des inspections nationales.
Il est curieux de constater, avec une certaine amertume, que le principe de l’internationalisation du contrôle rencontre toujours de fortes oppositions. Hier, c’était celui de la fabrication privée des armes, aujour-d’hui, c’est celui des armements eux-mêmes. Je reste convaincu, avec mes camarades de la C.I.S.L. qu’on ne peut sérieusement parler de désarmement général ou plus modestement de limitation des armements sans admettre un efficace contrôle international.
Je fus encore le porte-parole des syndicats à la Conférence économique de 1927. Je rappellerai les principales parties de mon intervention du 5 Mai:
«Au nom de mes camarades, représentants ouvriers, je veux saluer dans la Conférence économique internationale, la reconnaissance de la valeur des idées que le mouvement ouvrier a toujours défendues.
«C’est la conception des organisations de travailleurs que la collaboration économique des peuples est une nécessité. Au lendemain même de la guerre, durant la période de l’armistice – c’était en février 1919 – examinant les conditions nécessaires de la paix et les bases à donner à la Société des Nations encore en projet, les conférences syndicales et socialistes, réunies simultanément à Berne, insistaient sur la nécessité de donner à la Société des Nations ce substratum économique que souhaitait hier son président M. Theunis.
… en 1924, nous déclarions que l’organisation de la paix définitive exige non seulement l’institution d’un droit de la paix, mais aussi d’une économie de la paix … pas de paix véritable … si l’on pratique des méthodes de combat dans les rapports économiques. Il faudra créer une Commission de collaboration économique.»
Le 23 mai, ultime jour de la Conférence, je traduisis le sentiment de mes amis en disant: »Nous avons été audacieux dans la critique, trop timides dans la construction.»
Trois ans plus tard, la Conférence en vue d’une action économique concertée envoya un questionnaire aux Etats membres de la S.D.N. Le Gouvernement français chargea le Conseil National Economique de fournir les éléments de la réponse. J’y représentais la C.G.T. depuis sa création en 1925 et j’étudiai les moyens pratiques d’assurer dans des conditions plus satisfaisantes la circulation des matières premières d’origine européenne entre les divers Etats et leur meilleure utilisation. Je suggérai, exprimant la pensée de mes camarades, entre autres moyens, l’organisation d’un service international d’information sur les stocks, la production et les besoins de matières premières des différents pays.
Nous participions activement également au Comité du Chômage de la Commission d’étude pour l’Union Européenne, en 1931, à la Conférence économique et monétaire de Londres, en 1933 au Comité des grands travaux internationaux par lesquels le B.I.T. et la S.D.N., reprenant les propositions syndicales, tentaient d’établir une véritable collaboration entre les peuples dans la lutte contre le sous-emploi et pour la création de nouvelles richesses, mais toutes ces Conférences, toutes ces réunions ne parvinrent pas à guérir le monde de la crise économique: la volonté d’organiser le monde rationnellement ou tout au moins de pallier ses incohérences les plus apparentes avaient été moins fortes que l’inertie alliée à l’égoïsme et à l’incompréhension.
Et les efforts pour arracher les armes aux Nations pliant sous le poids des instruments de mort se sont révélés également inutiles. Je ne peux cependant pas oublier les premières séances de la Conférence pour la limitation et la réduction des armements. Ces jours du début de février 1932 furent des jours d’espérance pour l’humanité. Des millions d’hommes attendaient avec confiance le résultat des travaux de cette Conférence présidée par le vieux militant travailliste Henderson et nous pouvons prétendre à juste titre que nous avons été pour beaucoup dans la naissance de cet enthousiasme. L’Internationale Ouvrière Socialiste et la F.S.l. rivalisant d’ardeur avaient, chacune de leur côté, provoqué des milliers de pétitions que des délégations vinrent déposer sur le bureau de la Conférence. Le 6 février, après Vandervelde parlant au nom des Membres de l’O.I.O.S. j’apportai l’adhésion sans réserve des millions de syndiqués.
Ce jour reste une des journées illuminées de ma vie: je sentais intensément que j’exprimais l’espoir unanime des travailleurs du monde entier encore meurtri par la précédente hécatombe en même temps que leur connaissance lucide des véritables conditions du désarmement. En leur nom, j’assurai les Nombres de la Conférence de la collaboration totale des organisations ouvrières pour rendre efficaces et sincères les procédures de contrôle national et international, sans lesquelles les réductions d’armement seraient ou illusoires ou inopérantes.
Comme les efforts dans le domaine économique, la tentative de désarmement échoua et quelques années plus tard, battant la charge des ventres creux, le fascisme italien se lança alors sur l’Abyssinie. Nous, syndicalistes, nous savions bien que la l’aix était indivisible, nous ne pouvions douter que la faiblesse de la S.D.N. la conduirait à l’impuissance et ouvrirait une nouvelle période de massacres et de destructions. Nous demandâmes avec insistance et même avec violence l’application du Covenant et la mise: en ouvre de sanctions. Nous avons clamé dans le désert, les sanctions n’ont pas été appliquées; la guerre d’Ethiopie eut lieu et elle fut suivie fatalement, logiquement, inexorablement par l’intervention en Espagne, la remilitarisation de la rive gauche du Rhin, l’Anschluss, les accords de Munich et la 2 ème guerre mondiale.
Je ne veux pas m’étendre sur notre opposition à cette politique de faiblesse et d’abandon du principe de la sécurité collective. Nous ne savons que trop ce que la pusillanimité des démocraties leur a coûté.
Encore une fois la guerre a ravagé la terre. Pourtant, nous ne croyons pas que l’action pour l’établissement de la Paix soit un travail de Sisyphe et qu’éternellement le bloc meurtrier retombera sur les hommes pour les écraser. Nous finirons bien par le fixer solidement au sommet de la pente.
Aussitôt que les armes eurent échappé, des mains des fascistes et des nazis, les syndicalistes regardèrent devant eux et repensèrent les problèmes de la Paix.
La C.G.T.-F.O., à la fin de 1947, ressuscita les traditions et l’esprit de notre vieille C.G.T. et dans des discours, des articles, des rapports, nous avons repris et précisé les solutions qu’elle avait, avec la F.S.I., offertes au monde pour le sauver.
Nous avons approuvé le Plan Marshall parce qu’il était une manifestation de solidarité internationale, qu’il s’offrait à toutes les Nations éprouvées sans aucune discrimination et que nous ne pouvions voir en lui, puisqu’il remettait aux Etats bénéficiaires le pouvoir de décider eux-mêmes de l’utilisation des crédits, l’expression d’une politique d’armement et de prestige.
Nous avons approuvé la propagande en faveur de l’unité de l’Europe, en soulignant que nous considérions cette unité comme un premier pas fait sur le chemin de l’unité du Monde. Elu Président du Mouvement Européen en tant que syndicaliste au mois de février 1949, j’ouvris au printemps suivant la Conférence Economique de Westminster en précisant notre sentiment:
«Il est normal, il est logique, il est conforme à l’esprit même de l’histoire que la classe ouvrière organisée participe activement à la construction de l’Europe. Elle a toujours proclamé qu’elle ne séparait pas, qu’elle ne pouvait pas séparer parce que c’eut été établir des barrières que les événements internationaux eussent balayé comme des fétus de paille, qu’elle ne voulait pas séparer la lutte pour son émancipation du combat constant pour le maintien de la paix.»
Il s’agit pour l’Europe de se construire et non de s’enfermer. Cette masse humaine qui dispose d’immenses ressources naturelles, dont les possibilités intellectuelles sont les plus grandes du globe, cette masse humaine ne veut pas s’isoler du reste du monde. Elle est prête à tendre une main fraternelle à tous ceux qui voudront s’associer à ses efforts: «l’Europe que nous bâtirons aura plus de portes et de fenêtres que de murs.»
En juillet 1950, dans une introduction aux rapports établis sur la Conférence sociale du Mouvement Européen, j’insistai encore sur son objectif de paix internationale et de justice sociale.
«Nous voulons faire de l’Europe une petite presqu’ile du vaste continent Eurasiatique ou depuis des millénaires, la guerre a été le seul moyen de résoudre les oppositions des peuples, une communauté pacifique, unie malgré et dans sa diversité pour une lutte ardente et constante contre la misère et toutes les souffrances et menaces qu’elle engendre. Nous ne voulons pas faire de l’Europe un camp plus retranché, plus étendu et mieux armé.»
Nous avons approuvé le Plan Schuman pour une Communauté Européenne de l’acier et du charbon. Peu de jours après la déclaration du 9 mai 1950, le 31 mai très exactement, traitant dans un journal de la Conférence de la C.I.S.L. sur le Statut de la Ruhr, j’était conduit à écrire: «les promoteurs du Combinat ne peuvent avoir pour objectif … qu’une unification progressive de l’Europe. Or, cette unification ne peut pas être une fin en elle-même.
Le but final, le but essentiel à atteindre, le seul valable est d’accroître le bien-être des travailleurs, de les faire participer plus équitablement à la répartition des produits du travail collectif, de faire de l’Europe une démocratie sociale et d’assurer la paix que veulent tous les hommes de toutes les races et de toutes les langues en prouvant que les démocraties sont capables de réaliser la justice sociale dans l’organisation rationnelle de la production sans sacrifier la liberté et la dignité des individus.
… Le pool ne doit être qu’une étape dans une création continue. La C.I.S.L. a décidé d’en suivre le développement avec la plus grande vigilance afin d’être à même d’apporter sa collaboration efficace.»
Nous avons préconisé l’organisation mondiale du marché des matières premières et rappelé à ce propos que nous entendons défendre en défendant la démocratie: «Que voulons-nous tous sauver? Que voulons-nous sauve-garder? Les libertés publiques, c’est-à-dire en particulier le droit pour tous les citoyens d’avoir une opinion et de l’exprimer sans entraves, sur les grandes questions philosophiques, morales, politiques et économiques, et le droit de constituer des associations. Mais la Démocratie n’est pas, ne peut pas être seulement le respect théorique de ces droits. Elle doit donner à tous les hommes la possibilité effective d’en jouir et elle doit le mettre dans des conditions matérielles et morales telles qu’ils aient le goût de les exercer.
Celui pour qui sa propre subsistance est un problème de tous les instants ne peut être un citoyen conscient.
J’ai dit récemment dans une brève allocution au Conseil Economique que la justice économique est un des facteurs de la santé morale des Nations. Il n’y a pas d’ordre économique dans la course inflationniste et dans le sous-emploi.»
La C.I.S.L. me charges de déposer à l’assemblé de l’O.N.U. de Lake Success un projet de résolution dont le paragraphe principal était ainsi rédigé: «L’Assemblée générale … recommande aux états participants de rechercher avant tout les moyens d’établir un contrôle international de la circulation et des prix des matières premières, et, dans ce but, de contribuer à la création d’un fonds commun de stabilisation.»
Nous avons constamment défendu les deux principes inséparables de la sécurité collective et du désarmement général préparé par le recensement et le contrôle internationaux des effectifs militaires et des engins de guerre de toutes catégories.
Une synthèse de notre doctrine a été tentée à l’occasion du Congrès de la C.I.S.L. à Milan en juillet 1951, dans le rapport sur le rôle du mouvement syndical dans la crise internationale.
Nous y avons fixé nos objectifs: d’abord et avant tout, épargner à l’humanité la grande épreuve d’une troisième guerre mondiale.
Nous y avons posé nos principes: agir dans le cadre et sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, développer l’esprit de communauté et l’esprit social, revenir aux disciplines économiques collectives. Nous y avons exposé des formes d’action et elles étaient avec l’organisation de la répartition des matières premières et la fixation du prix des produits de base, la résolution du problème du logement, la lutte contre les méthodes restrictives de production pratiquées par les cartels nationaux et internationaux et surtout la participation effective des travailleurs organisés à la direction des affaires économiques et sociales de chaque pays et du monde.
Comme ce Congrès est la plus récente des grandes manifestations de la volonté de paix des syndicats libres, je crois que je ne saurais donner une meilleure conclusion à cet historique de 50 ans d’action syndicale en faveur de l’organisation rationnelle du monde et de la paix qui sont absolument inséparables, que les dernières lignes de ce rapport à peine modifiées.
Le mouvement syndical libre est appelé à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la crise internationale et pour l’avènement de la vraie paix. Le champ de la tâche est immense et son urgence égale son ampleur. Notre mouvement entend y vouer ses efforts sans compter. J’ajoute qu’il puisera des encouragements de grande valeur dans des interventions récentes de délégués gouvernementaux à la 3ème Commission de l’Assemblée Générale actuelle des Nations Unies. Le délégué de Cuba, M. Ichaso entre autres, a montré que certains milieux officiels étaient acquis à la notion que nous défendons depuis des années et que nous avons déjà réussi à faire inscrire dans la Traité de Versailles: le désordre économique et la misère sont parmi les causes déterminantes des guerres.
La décision du Comité du Storting qui, en m’attribuant le Prix Nobel de la Paix 1951 a reconnu et proclamé la valeur et la constance des efforts pacifistes des syndicalistes ne peut que faciliter encore plus la diffusion de ces idées et étendre considérablement leur champ d’action. Il renforce maintenant la volonté commune de ceux qui les ont conçues et proposées à la méditation des hommes et de ceux qu’elles ont conquis, de travailler sans relâche à l’édification d’une Société libérée de l’injustice et de la violence.
Nous savons bien, hélas! que les hommes et les civilisations sont mortels. Nous voulons laisser à la nature insensible la responsabilité de leur disparition et libérer enfin l’humanité du remords d’avoir engendré Caïn.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.