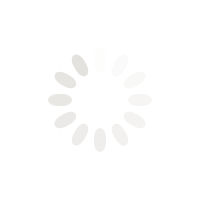Albert Schweitzer – Conférence Nobel
English
French
Conférence Nobel, le 4 novembre, 1954
Le Problème de la Paix
Pour sujet de la conférence que l’attribution du prix Nobel de la Paix m’impose comme un honneur redoutable, j’ai choisi le problème de la paix, tel qu’il se pose aujourd’hui. Je crois agir ainsi dans l’intention du fondateur de ce prix, qui s’était préoccupé de ce problème, tel qu’il se posait à son époque, et qui attendait de sa fondation qu’elle entretienne la réflexion et la recherche sur les possibilités de servir la cause de la paix.
Le point de départ pour mes réflexions me sera fourni par un exposé de la situation, telle qu’elle se présente à l’issue des deux guerres que nous venons de traverser.
Les hommes d’Etat qui ont façonné le monde actuel au cours des négociations consécutives à chacune de ces guerres n’ont pas eu la main heureuse. Leur but n’était pas de créer des situations qui auraient pu être des points de départ d’un développement quelque peu prospère; ils étaient préoccupés surtout de tirer de la victoire ses conséquences et de les rendre durables. Même si leur clairvoyance avait été sans défaut, ils n’auraient pas pu la prendre pour guide. Ils étaient obligés de se considérer comme les exécuteurs de la volonté des peuples vainqueurs. Ils ne pouvaient pas songer à organiser les relations entre peuples sur des bases justes et convenables; tous leurs efforts étaient absorbés par la nécessité d’empêcher que les pires exigences de cette volonté populaire des vainqueurs ne devinssent réalité; devaient veiller en outre à ce que les vainqueurs se fassent les uns aux autres les concessions réciproques indispensables dans les questions sur lesquelles leurs vues et leurs intérêts divergeaient.
Ce qu’il y a d’intenable dans la situation actuelle — et les vainqueurs commencent à en pâtir aussi bien que les vaincus — a son origine véritable dans le fait qu’on n’a tenu compte suffisamment de la réalité telle qu’elle résulte du donné historique et, par suite, de ce qui est juste et utile.
Le problème historique de l’Europe est conditionné par le fait qu’au cours des siècles passés, surtout à l’époque dite des grandes invasions, des peuples venus de l’Est ont pénétré de plus en plus vers l’Ouest et le Sud-Ouest et ont pris possession de la terre. Ainsi il arriva que des immigrés de fraiche date cohabitaient avec des peuples plus anciennement immigrés.
Une fusion partielle de ces peuples se produisit au cours des siècles. De nouvelles organisations étatiques, relativement homogènes, se formèrent à l’intérieur de nouvelles limites. En Europe occidentale et centrale, cette évolution aboutit à une situation qu’on peut considérer comme définitive dans ses grands traits et dont le processus se termina au cours du 19e siècle.
Dans l’Est et le Sud-Est cependant, l’évolution n’a pas progressé jusqu’à ce résultat. Elle en est restée à une cohabitation de nationalités qui ne fusionnent pas entre elles. Le droit à la terre, chacune peut y prétendre dans une certaine mesure. L’une peut faire valoir qu’elle est l’occupante la plus ancienne ou la plus nombreuse, l’autre mettre en avant ses mérites pour la mise en valeur du pays. La seule solution pratique eût été que les deux éléments s’accordassent pour vivre ensemble, sur le même territoire, dans une organisation étatique commune, selon un compromis acceptable pour les deux parties. Cependant il eût fallu que cet état de choses fût atteint avant le deuxième tiers du 19e siècle. A partir de cette époque, en effet, la conscience nationale se développa de plus en plus fortement, ce qui entraîna de graves conséquences. Ce développement ne permit plus aux peuples de se laisser guider par les réalités historiques et la raison.
Ainsi la première guerre mondiale trouve ses origines dans les conditions qui régnaient dans l’Europe orientale et sud-orientale. La nouvelle organisation, créée après les deux guerres, contient à son tour des germes d’une guerre future.
Des germes de conflits sont contenus dans toute nouvelle organisation consécutive à une guerre qui ne tient pas compte du donné historique et qui ne tend pas vers une solution juste et objective des problèmes dans le sens de ce donné. Seule une telle solution peut constituer une garantie de durée.
La réalité historique est foulée aux pieds si, dans le cas où deux peuples ont des droits historiques concurrants sur un même pays, on ne reconnaît que ceux de l’un d’eux. Les titres que deux peuples peuvent faire valoir dans les parties contestées de l’Europe pour la possession d’un même territoire, n’ont toujours qu’une valeur relative. Tous deux, en effet, sont des immigrés de l’époque historique.
On se rend également coupable d’un mépris du donné historique si, au cours de l’organisation du nouvel état de choses, on ne tient pas compte, en fixant les frontières, des réalités économiques. Une faute de ce genre est commise, si l’on trace une frontière de telle façon qu’un port perde son arrière-pays naturel ou qu’une muraille s’élève entre une région productrice de matières premières et une autre spécialement apte et équipée pour leur transformation. Par ces procédés, on donne naissance à des Etats qui ne sont pas viables économiquement.
La violation la plus flagrante du droit du donné historique, et du droit humain tout court, consiste à enlever à certains peuples, leur droit sur la terre qu’ils habitent, si bien qu’ils sont forcés de changer de lieu. Les puissances victorieuses, à la fin de la deuxième guerre mondiale, ont pris la décision d’imposer ce sort à des centaines de milliers d’hommes, et cela sous les conditions les plus dures; ce fait nous permet de mesurer combien peu elles avaient pris conscience de leur tâche de procéder à une réorganisation qui fût à peu près équitable et qui garantît un devenir prospère.
La situation dans laquelle nous nous trouvons après la deuxième guerre mondiale est caractérisée essentiellement par le fait qu’elle n’a été suivie d’aucun traité de paix. C’est uniquement par des accords ayant un caractère de trêves qu’elle a pris fin, et c’est bien parce que nous ne sommes pas capables d’une réorganisation tant soit peu satisfaisante que nous sommes obligés de nous contenter de ces trêves, conclues selon les besoins du moment, et dont personne ne peut prévoir l’avenir.
* * *
Voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et maintenant, dans quels termes se pose à nous le problème de la paix?
D’une façon toute nouvelle, dans la mesure même où la guerre d’aujourd’hui est différente de celle d’autrefois. Elle met en oeuvre des moyens de mort et de destruction incomparablement plus efficaces que par le passé, elle est donc un mal pire qu’elle n’a jamais été. On pouvait la considérer autrefois comme un mal auquel il fallait se résigner, parce qu’elle servait le progrès, qu’elle lui était même nécessaire. On pouvait soutenir l’opinion que grâce à la guerre, les peuples aux vertus les plus fortes l’emportaient sur les autres et déterminaient ainsi la marche de l’histoire.
On peut alléguer comme exemple que la victoire de Cyrus sur les Babyloniens a créé dans le Proche Orient un empire avec une civilisation supérieure à la précédente, et que la victoire d’Alexandre le Grand à son tour a ouvert la voie du Nil jusqu’à l’Indus à la civilisation grecque. Mais il arriva aussi qu’en sens inverse une guerre eût pour conséquence le remplacement d’une haute civilisation par une autre qui lui était inférieure, par exemple lorsque les Arabes, au septième et début du huitième siècle se rendirent maîtres de la Perse, de l’Asie Mineure, de la Palestine, de l’Afrique du Nord et de l’Espagne, pays où régnait auparavant la civilisation gréco-romaine.
Il paraît donc que dans le passé la guerre pouvait oeuvrer aussi bien pour le progrès que contre lui. De la guerre moderne, c’est avec une conviction bien moins assurée qu’on peut prétendre qu’elle est génératrice de progrès. Le mal qu’elle constitue pèse d’un poids bien plus lourd qu’autrefois.
Cela vaut la peine de rappeler que la génération d’avant 1914 croyait pouvoir tenir pour un facteur favorable l’énorme accroissement des moyens de guerre. On en déduisait que la décision serait acquise bien plus rapidement qu’autrefois et qu’on pourrait s’attendre à des guerres très brèves. Cette opinion était admise sans contradiction.
On croyait aussi que les maux causés par une guerre future seraient relativement peu importants, parce qu’on escomptait une humanisation progressive de ses méthodes. Le point de départ de cette supposition furent les obligations assumées par les peuples dans la Convention de Genève de 1864, à la suite des efforts de la Croix Rouge. Ils se garantissaient mutuellement les soins aux blessés et un traitement humain des prisonniers de guerre, de même que des égards très larges envers la population civile. Cette convention a en effet obtenu des résultats considérables, dont des centaines de milliers de combattants et de civils devaient profiter dans les guerres à venir. Mais comparés aux malheurs de la guerre accrus au-delà de toute mesure par les moyens modernes de mort et de destruction, ils sont bien minces. Vraiment, il ne peut être question d’une humanisation de la guerre.
La théorie de la guerre courte, combinée avec celle de l’humanisation de ses méthodes, fit qu’au moment où la guerre devint réalité en 1914, on ne la prit pas autant au tragique qu’elle le méritait. On la considéra comme un orage qui allait purifier l’atmosphère politique et comme un événement qui allait mettre fin à la course aux armements qui ruinait les peuples.
Si certains, d’un coeur léger, approuvaient la guerre à cause du profit qu’ils en attendaient, d’autres exprimaient un avis plus sérieux et plus noble: cette guerre devait être la dernière et le serait effectivement. Maint brave est parti persuadé qu’il allait combattre pour l’avènement d’une ère sans guerres.
Dans ce conflit comme dans celui de 1939, ces deux théories se révélèrent complètement erronées. Luttes et destructions durèrent des années et furent menées de la façon la plus inhumaine. A la différence de la guerre de 1870, le duel ne fut pas entre deux peuples isolés, mais entre deux grands groupes de peuples, et ainsi une grande partie de l’humanité en fut victime et mal en empira d’autant.
Puisque nous savons maintenant quel horrible mal est la guerre, nous ne devons négliger aucun effort pour en empêcher le retour. Une raison d’ordre éthique s’y ajoute. Au cours des deux dernières guerres, nous nous sommes rendus coupables d’actes inhumains qui font frémir, et dans une guerre future, nous renchéririons. Cela ne doit pas être!
Osons faire face à la situation. L’homme est devenu un surhomme. Il est un surhomme parce qu’il ne dispose pas seulement des forces physiques innées, mais parce qu’il commande, grâce aux conquêtes de la science et de la technique, aux forces latentes dans la nature et qu’il peut les mettre à son service. Pour tuer à distance, l’homme réduit à lui-même ne disposait que de sa force physique, grâce à laquelle il tendait l’arc; il la faisait agir sur la flèche par la brusque détente de l’arc. Le surhomme en est arrivé à utiliser, grâce à un engin inventé à cet effet, l’énergie dégagée par la déflagration d’un mélange déterminé de produits chimiques. Ceci lui permet d’employer un projectile beaucoup plus efficace et de l’envoyer à une distance beaucoup plus grande.
Mais le surhomme souffre d’une imperfection funeste de son esprit. Il ne s’est pas élevé au niveau de la raison surhumaine qui devrait correspondre à la possession d’une force surhumaine. Il en aurait besoin pour mettre en oeuvre cette énorme puissance uniquement à des fins raisonnables et utiles, et non destructrices et meurtrières. Pour cette raison, les conquêtes de la science et de la technique devinrent funestes plutôt que profitables pour lui.
A cet égard ne faut-il pas considérer comme un fait significatif que la première grande découverte, celle d’utiliser la force résultant de la déflagration de la poudre, s’est d’abord offerte uniquement comme un moyen de tuer à distance?
La conquête de l’air, grâce aux engins à combustion interne, marque un progrès décisif pour l’humanité. Les hommes ont aussitôt profité de l’occasion qu’elle offrait pour tuer et détruire du haut des airs. Cette invention a rendu évidente une conséquence qu’auparavant on refusait de s’avouer: le surhomme, à mesure que sa puissance s’accroît, devient de plus en plus un pauvre homme. Pour ne pas s’exposer complètement à la destruction qui déferle d’en haut, il est obligé de s’enfouir sous terre, comme les bêtes des champs. En même temps il doit se résigner à assister à une destruction sans précédent de valeurs culturelles.
Une nouvelle étape fut constituée par la découverte des forces énormes libérées par la désintégration de l’atome et de leur utilisation. Au bout d’un certain temps il fallut constater que la capacité de destruction d’une bombe chargée d’une force de ce genre devenait incalculable, et que déjà des expériences sur une grande échelle pouvaient provoquer des catastrophes menaçant l’existence même de l’humanité. C’est maintenant seulement que toute l’horreur de notre existence se révèle à nous. Nous ne pouvons plus éluder la question de l’avenir de l’humanité.
Mais le fait essentiel que nous devons ressentir dans notre conscience, et que nous aurions dû ressentir depuis longtemps, est que nous devenions inhumains à mesure que nous devenions des surhommes. Nous avons toléré qu’au cours des guerres les hommes aient été tués en masses — environ vingt millions dans la seconde guerre mondiale — que des villes entières avec leurs habitants aient été réduites à néant par la bombe atomique, que des hommes aient été transformés en torches vivantes par les bombes incendiaires. Nous prenions connaissance de ces faits par la radio ou par les journaux, et nous les jugions selon qu’ils signifiaient un succès pour le groupe de peuples auquel nous appartenions, ou pour nos adversaires. Quand nous nous avouâmes que ces faits étaient les résultats d’une action inhumaine, cet aveu s’accompagnait de la réflexion que le fait de guerre nous condamnait à les accepter. En nous résignant sans résistance à notre sort, nous nous rendons coupables d’inhumanité.
Ce qui importe, c’est reconnaître, tous ensemble, que nous sommes coupables d’inhumanité. L’horreur de cette expérience doit nous arracher à notre torpeur, pour que nous tendions nos volontés et nos espoirs vers l’avènement d’une ère dans laquelle la guerre ne sera plus.
Cette volonté et cet espoir ne peuvent avoir qu’un seul but: atteindre, par un nouvel esprit, cette raison supérieure qui nous détournera de faire de la puissance qui est à notre disposition un usage funeste.
Le premier qui ait eu le courage de mettre en avant des arguments purement éthiques pour combattre la guerre et d’exiger une raison supérieure déterminée par un vouloir éthique, fut le grand humaniste Erasme de Rotterdam dans sa «Querela Pacis» (La lamentation de la Paix) parue en 1517. Il y met en scène la Paix à la recherche d’une audience.
Erasme trouva peu de successeurs dans cette voie. On considérait comme une utopie d’attendre de l’affirmation d’une nécessité éthique un avantage pour la paix. Kant aussi partage cette opinion. Dans son écrit: «De la paix perpétuelle», paru en 1795, et dans d’autres publications, dans lesquelles il touche au problème de la paix, il croit que sa réalisation viendra uniquement de l’autorité croissante d’un droit international selon lequel une cour d’arbitrage internationale réglerait les conflits entre peuples. Cette autorité, d’après lui, doit se fonder uniquement sur le respect croissant qu’avec le temps les hommes, pour de motifs purement pratiques, témoigneraient au droit en tant que tel. Kant insiste sans cesse sur l’idée qu’il ne faut pas mettre en avant des raisons éthiques en faveur de l’idée d’une société des nations, mais qu’il faut la considérer comme l’aboutissement d’un droit qui va se perfectionnant. Il pense que ce perfectionnement se produira au cours d’un progrès qui se réalisera de lui-même. A son avis, «la nature, cette grande artiste», amènera les hommes, très progressivement, il est vrai, et au terme d’un temps très long, par la marche des événements historiques et par la misère des guerres, à se mettre d’accord sur un droit international garantissant la paix perpétuelle.
Le plan d’une Société des nations avec pouvoirs d’arbitrage a été formulé pour la première fois avec quelques précisions par Sully, l’ami et le ministre d’Henri IV. Il a été traité de façon détaillée par l’abbé Castel de Saint-Pierre, dans trois écrits, dont le plus important est intitulé: «Projet de paix perpétuelle entre les souverains chrétiens.» Kant tient sa connaissance des opinions qu’il y développe, probablement d’un extrait que Rousseau publia en 1761.
* * *
Aujourd’hui nous disposons de l’expérience de la Société des Nations de Genève et de l’Organisation des Nations Unies pour juger de l’efficacité d’institutions internationales. Celles-ci pourront rendre des services considérables, en proposant leur médiation dans les conflits à leur naissance, en prenant l’initiative de créer des entreprises communes aux nations et par d’autres actes de cette nature, selon les circonstances. Une des réalisations des plus importantes de la Société des Nations fut la création, en 1922, d’un passeport à validité internationale en faveur des personnes devenues apatrides par le fait de guerre. Quelle aurait été la situation de ces hommes si, sur l’initiative de Nansen, elle n’avait pas créé ce passeport de remplacement! Quel aurait été, après 1945, le sort des personnes déplacées, si l’Organisation des Nations Unies n’avait pas existé !
Ces deux institutions pourtant n’ont pas été capables d’amener un état de paix. Leurs efforts étaient condamnés à l’échec, parce qu’elles étaient obligées de les tenter dans un monde où ne régnait nullement un esprit dirigé vers la réalisation de la paix. N’étant que des institutions juridiques, elles étaient incapables de le créer. L’esprit éthique seul a ce pouvoir. Kant s’est trompé quand il croyait pouvoir s’en passer pour son entreprise de paix. Nous devons suivre le chemin sur lequel il n’a pas voulu s’engager.
Et qui plus est, le temps extrêmement long, sur lequel il comptait pour ce mouvement vers la paix, nous n’en disposons plus. Les guerres d’aujourd’hui
sont des guerres d’anéantissement, celles qu’il supposait ne l’étaient pas. Des mesures décisives pour la cause de la paix doivent être entreprises et des résultats décisifs acquis, et cela à bref délai. De cela aussi, l’esprit seul est capable.
* * *
L’esprit peut-il réaliser effectivement ce que dans notre détresse nous sommes obligés d’attendre de lui?
Il ne faut pas sousestimer sa force. Car c’est lui qui se manifeste à travers l’histoire de l’humanité. C’est lui qui a créé cet humanitarisme qui est à l’origine de tout progrès vers une forme d’existence supérieure. Animés par l’humanitarisme, nous sommes fidèles à nous-mêmes et capables de création. Animés par l’esprit contraire, nous sommes infidèles à nous-mêmes et en proie à toutes les erreurs.
La puissance jusqu’à laquelle l’esprit peut s’élever a été révélée aux dix-septième et dix-huitième siècles. Il a fait sortir hors du Moyen-Age les peuples d’Europe parmi lesquels il se manifesta, en mettant fin à la superstition, aux procès de sorcellerie, à la torture et à mainte autre cruautés ou folise traditionnelles. A la place du vieux il a crée du neuf, qui provoque sans cesse l’étonnement de celui qui observe cette évolution. Tout ce que nous avons jamais possédé de civilisation vraie et personnelle et ce que nous en possédons encore, remonte à cette manifestation de l’esprit.
Par la suite, il a perdu de sa force, surtout parce qu’il n’arrivait pas à trouver, dans la connaissance du monde résultant de la recherche scientifique un fondement pour son caractère éthique. Il a été remplacé par un esprit qui ne voyait pas clairement la voie, sur laquelle l’humanité devait progresser, et qui disposait d’un idéal moins élevé. A présent, c’est à lui que nous devons nous abandonner à nouveau, si nous ne voulons pas aller à notre perte. Il doit accomplir un nouveau miracle, comme au temps où il conduisit les peuples d’Europe hors du Moyen-Age, un miracle plus grand que le premier.
L’esprit n’est pas mort, il vit dans la solitude. Il a surmonté sa difficile obligation de vivre sans une connaissance du monde correspondant à son caractère éthique. Il a compris qu’il ne doit se fonder sur rien d’autre que sur la nature essentielle de l’homme. L’indépendance ainsi acquise par rapport à la connaissance se révèle comme un gain.
Il est convaincu que la compassion, dans laquelle l’éthique prend sa racine, ne gagne sa véritable étendue et profondeur que si elle ne se limite pas aux hommes, mais s’étend à tous les êtres vivants. A côté de l’ancienne éthique, manquant de cette profondeur et de la force de conviction est venue se placer l’éthique du respect de la vie et elle se fait de plus en plus reconnaître comme valable.
Nous osons de nouveau nous adresser au tout de l’homme, à sa faculté de penser et de sentir, l’exhorter à se connaître lui-même et à être fidèle à lui-même. A nouveau, nous voulons placer notre confiance dans les qualités profondes de sa nature. Les expériences que nous vivons nous confirment dans cette entreprise.
En 1950 parut un livre sous le titre: «Témoignages d’humanité», édité par des professeurs de l’Université de Goettingen, qui avaient été englobés dans l’horrible expulsion en masse des Allemands de l’Est en 1945. Des réfugiés y racontent, en paroles très simples, quelle aide ils ont reçue dans leur détresse d’hommes appartenant aux peuples ennemis et qui, par conséquent, auraient dû être mus par la haine. Rarement j’ai été empoigné par un livre comme je l’ai été par celui-ci. Il est capable de rendre la foi en l’humanité à ceux qui l’ont perdue.
Que la paix vienne ou ne vienne pas, cet événement dépend de la direction dans laquelle se développera la mentalité des individus et par voie de conséquence, celle des peuples. Pour notre époque, cette vérité vaut encore plus que par le passé. Erasme, Sully, l’abbé Castel de Saint-Pierre et les autres, qui en leur temps se préoccupaient de l’avènement de la paix, n’avaient pas affaire aux peuples, mais aux princes. Leurs efforts tendaient à les induire à créer une autorité supranationale dotée d’un pouvoir d’arbitrage pour aplanir les difficultés qui pouvaient naître entre eux. Kant, dans son écrit «De la paix perpétuelle», est le premier à envisager une époque où les peuples se gouverneraient eux-mêmes et devraient, en tant que souverains, s’occuper du problème de la paix. Il considère cette évolution comme un progrès. A son avis, les peuples seraient plus enclins que les princes à maintenir la paix, parce que ce sont eux qui supportent tous les malheurs de la guerre.
Le temps est venu où les gouvernants sont tenus de se considérer comme les exécuteurs de la volonté populaire. Mais l’opinion de Kant sur l’amour inné du peuple pour la paix ne s’est pas vérifié. En tant qu’elle est la volonté d’une multitude, la volonté populaire n’a pas échappé au danger d’instabilité et au risque d’être détournée par les passions de la voie de la vraie raison et de manquer du sentiment nécessaire de responsabilité! Un nationalisme de la pire espèce s’est manifesté au cours des deux guerres, et il peut être considéré en ce moment comme le plus grand obstacle à l’entente qui s’ébauche entre les peuples.
Ce nationalisme ne peut être repoussé que par la renaissance d’un idéal humanitaire parmi les hommes qui fera que leur appartenance à leur patrie sera naturelle et inspirée par un idéal de bon aloi.
Le nationalisme de mauvais aloi, lui, sévit aussi dans les pays d’outre-mer, surtout parmi les peuples qui vivaient autrefois sous la tutelle des blancs, et qui ont acquis récemment leur indépendance. Ils courent le danger que le nationalisme soit leur unique idéal. De ce fait, dans plusieurs régions, la paix, qui y régnait jusqu’à présent, est mise en danger.
Ces peuples aussi ne pourront surmonter leur nationalisme naïf que par un idéal humanitaire. Mais comment ce changement s’opérera-t-il? C’est quand l’esprit deviendra puissant en nous et nous ramènera à la civilisation basée sur l’idéal humanitaire, alors il agira, par notre intermédiaire, sur ces peuples. Tous les hommes, même les demi-civilisés et les primitifs, sont capables, en tant qu’êtres doués de la faculté de compassion, de développer un esprit humanitaire. Il est en eux comme une matière inflammable qui attend pour s’embraser, l’arrivée d’une étincelle.
Dans nombre de peuples, ayant atteint un certain niveau de civilisation, l’idée que le règne de la paix doit venir un jour, a trouvé son expression. En Palestine, elle se manifesta pour la première fois chez le prophète Amos, au huitième siècle avant J. C. et elle continue à vivre dans les religions juive et chrétienne comme l’espérance en le royaume de Dieu. Elle est un élément de la doctrine enseignée par les grands penseurs de la Chine: Confucius et Lao-tseu au sixième siècle avant J. C., Mi-tseu, au cinquième et Meng-tseu au quatrième. Elle se retrouve chez Tolstoï et chez d’autres penseurs européens contemporains. On s’est plu à la considérer comme une utopie. Mais aujourd’hui la situation est telle qu’elle doit devenir réalité d’une manière ou d’une autre; sinon l’humanité périra.
Je sais bien que ce que je viens de dire sur le problème de la paix n’a apporté rien d’essentiellement neuf. Ma conviction profonde est que la solution consiste à ce que nous en arrivions à rejeter la guerre pour une raison éthique, parce qu’elle nous rend coupables du crime d’inhumanité. Erasme de Rotterdam déjà, et quelques autres après lui, l’ont annoncé comme la vérité à laquelle il faut se rallier.
La seule originalité que je réclame pour moi, c’est qu’en moi cette vérité s’accompagne de la certitude, née de la pensée, que l’esprit est capable, à notre époque, de créer une nouvelle mentalité, une mentalité éthique. Animé par cette certitude, j’annonce cette vérité, dans l’espoir que mon témoignage pourra contribuer à ce qu’elle ne soit pas mise de côté comme bonne seulement en paroles, mais inapplicable dans la réalité. Plus d’une vérité est restée longtemps ou totalement sans effet, simplement parce que personne n’a envisagé qu’elle pût devenir réalité.
C’est seulement dans la mesure où un idéal de paix prendra naissance parmi les peuples que les institutions créées pour maintenir cette paix pourront remplir leur mission comme nous l’attendons et espérons d’elles.
Aujourd’hui encore, nous vivons à une époque marquée par l’absence de paix, aujourd’hui encore, des peuples peuvent se sentir menacés par d’autres; aujourd’hui encore, il faut concéder à chacun le droit de se tenir prêt à se défendre avec les armes terribles dont nous disposons.
C’est dans une telle conjoncture que nous guettons un premier signe de la manifestation de l’esprit auquel nous devons nous confier. Ce signe ne peut être autre chose qu’un commencement d’effort de la part des peuples pour réparer, dans la mesure du possible, les torts qu’ils se sont infligés mutuellement au cours de la dernière guerre. Des centaines de milliers de prisonniers et de déportés attendent de pouvoir enfin retourner dans leurs foyers, d’autres, condamnés injustement par une puissance étrangère, attendent leur acquittement, pour ne pas parler des nombreuses autres injustices, qui attendent encore réparation.
Au nom de tous ceux qui peinent en faveur de la paix, j’ose prier les peuples de faire le premier pas sur cette voie nouvelle. Aucun d’eux n’y perdra une parcelle de la puissance nécessaire pour sa propre défense.
Si de cette façon on entreprend la liquidation de la guerre dont nous sortons, alors un peu de confiance pourra naître entre les peuples. La confiance est pour toutes les entreprises le grand capital, dont aucune oeuvre utile ne saurait se passer. Elle crée dans tous les domaines les conditions pour un épanouissement fructueux. Dans l’atmosphère de confiance ainsi créée, on pourra entreprendre un règlement équitable des problèmes créés par les deux guerres.
Je crois avoir exprimé ici les pensées et les espoirs de millions d’hommes qui, dans nos régions, vivent dans la peur de la guerre à venir. Puissent mes paroles être comprises dans le sens qu’elles veulent avoir, si elles pénètrent de l’autre côté du fossé auprès de ceux qui y vivent dans cette même peur.
Puissent les hommes qui tiennent entre leurs mains le sort des peuples, éviter avec un soin anxieux tout ce qui pourrait empirer la situation dans laquelle nous nous trouvons et la rendre encore plus dangereuse. Et puissent-ils prendre à coeur la parole de l’apôtre Paul: «S’il est possible, autant qu’il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.» Cette parole ne vaut pas seulement pour les individus, mais aussi pour les peuples. Puissent-ils, dans leurs efforts pour le- maintien de la paix, aller jusqu’à l’extrême limite du possible, pour donner à l’esprit le temps de croître et d’agir.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.