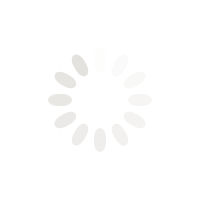V. S. Naipaul – Conférence Nobel
English
Swedish
French
German
Deux mondes
Il s’agit pour moi d’une situation inhabituelle. S’il m’arrive de donner des lectures, je ne fais ni causeries ni discours. Je réponds toujours cela aux gens qui me demandent une conférence. Et c’est la pure vérité. Il peut paraître étrange qu’un homme qui depuis près de cinquante ans fait profession de manier les mots, les émotions et les idées n’ait rien à proposer, en quelque sorte. Mais tout ce que j’ai à dire de valable se trouve dans mes livres. Ou alors n’est pas encore entièrement formé. J’en suis d’ailleurs à peine conscient. Cela attend le prochain livre et, avec un peu de chance, me viendra en écrivant – par surprise. C’est cet élément de surprise que je cherche quand j’écris, et qui me permet – entreprise toujours délicate – de juger mon travail.
Dans Contre Sainte-Beuve, Proust parle avec une grande pénétration de la différence entre l’écrivain et son être social. Sainte-Beuve croyait que pour comprendre un auteur il fallait en savoir le plus possible sur l’homme extérieur et sur les détails de sa vie. Éclairer l’œuvre par l’homme est une démarche séduisante et qui peut paraître inattaquable. Proust la démolit néanmoins de manière très convaincante. “Cette méthode”, dit-il, “méconnaît ce qu’une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend : qu’un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c’est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir.”
Nous devrions avoir ces mots de Proust à l’esprit chaque fois que nous lisons la biographie d’un écrivain, ou de quiconque dépend de ce qu’on peut appeler l’inspiration. On aura beau nous exposer tous les détails de sa vie, ses bizarreries et ses amitiés, le mystère de l’écriture subsistera. Aucune quantité d’information, si passionnante soit-elle, ne saurait nous y conduire. La biographie d’un écrivain – ou même l’autobiographie – présentera toujours cette lacune.
Proust est un maître de l’amplification heureuse, et j’aimerais revenir brièvement à Contre Sainte-Beuve. “En réalité”, poursuit-il, “ce qu’on donne au public, c’est ce qu’on a écrit seul, pour soi-même, c’est bien l’œuvre de soi. Ce qu’on donne à l’intimité, c’est-à-dire à la conversation […] et ces productions destinées à l’intimité, c’est-à-dire rapetissées au goût de quelques personnes et qui ne sont guère que de la conversation écrite, c’est l’œuvre d’un soi bien plus extérieur, non pas du moi profond qu’on ne retrouve qu’en faisant abstraction des autres et du moi qui connaît les autres […].”
Lorsqu’il écrivait ces mots, Proust n’avait pas encore trouvé le sujet qui allait le conduire au bonheur de son grand travail littéraire. Et vous pouvez conclure de ce que je viens de citer que c’était un homme qui se fiait à son intuition et guettait sa chance. J’ai déjà cité ces phrases en d’autres circonstances. Parce qu’elles définissent la manière dont je procède. Je m’en remets à l’intuition. Je le faisais au début. Je le fais encore aujourd’hui. Je ne sais absolument pas comment les choses vont tourner, où l’écriture va me mener ensuite. Je m’abandonne à l’intuition pour trouver mes sujets et j’écris intuitivement. Sans doute ai-je une idée, une forme, en commençant, mais il me faudra attendre des années avant de comprendre pleinement ce que j’ai écrit.
J’ai dit tout à l’heure que tout ce qu’il y a de valable en moi est dans mes livres. Je vais aller plus loin : je suis la somme de mes livres. Chacun d’eux, intuitivement senti et, dans le cas de la fiction, intuitivement élaboré, couronne les précédents et en procède. Il me semble qu’à n’importe quelle étape de ma carrière littéraire on aurait pu dire que le dernier ouvrage contenait tous les autres.
Cela s’explique par les circonstances, à la fois extrêmement simples et extrêmement compliquées, dans lesquelles j’ai grandi. Je suis né à Trinidad, petite île à l’embouchure de l’Orénoque, le grand fleuve vénézuélien. Trinidad n’appartient donc, à proprement parler, ni à l’Amérique du Sud ni aux Antilles. Cette colonie de plantation du Nouveau Monde comptait en 1932, année de ma naissance, quelque 400 000 habitants, dont environ 150 000 Indiens, hindous et musulmans, presque tous de souche paysanne et, dans leur immense majorité, originaires de la plaine du Gange.
Telle était ma minuscule communauté natale. L’essentiel de son immigration s’était déroulée après 1880. Aux conditions suivantes : les gens s’engageaient à travailler cinq ans dans les plantations et à la fin de cette période ils recevaient un lopin de terre, peut-être deux hectares, ou un billet de retour pour l’Inde. En 1917, à la suite de l’agitation de Gandhi et d’autres, ce système de contrat fut aboli. Et peut-être à cause de cela, ou pour d’autres raisons, nombre des derniers arrivés n’obtinrent pas les terres ou le rapatriement promis. Ces gens étaient totalement démunis. Ils dormaient dans les rues de Port of Spain, la capitale. Je les y ai vus, enfant. J’imagine qu’alors je ne les savais pas dans la misère – j’ai dû le comprendre beaucoup plus tard –, et ils ne m’ont pas laissé une impression particulière. Cela faisait partie de la cruauté de la colonie de plantation.
Je suis né à Chaguanas, une bourgade de l’intérieur, à quatre ou cinq kilomètres du golfe de Paria. Chaguanas était un nom étrange, par l’orthographe et la prononciation, et beaucoup d’Indiens – ils étaient majoritaires dans la région – préféraient lui donner le nom de caste indienne de Chauhan.
J’avais trente-quatre ans lorsque j’ai découvert d’où venait le nom du lieu de ma naissance. J’habitais à Londres et cela faisait seize ans que je vivais en Angleterre. J’étais en train d’écrire mon neuvième livre, une histoire de Trinidad qui s’efforçait de faire revivre les gens et leurs histoires. J’allais souvent au British Museum lire les documents espagnols sur la région. Ces documents avaient été recopiés dans les archives espagnoles pour le gouvernement britannique dans les années 1890, au moment d’une acerbe querelle frontalière avec le Venezuela. Ils commencent en 1530 et s’achèvent avec la disparition de l’Empire espagnol.
J’enquêtais sur l’absurde recherche de l’Eldorado et sur l’intrusion meurtrière du héros anglais, Sir Walter Raleigh. En 1595, il assaillit Trinidad, massacra tous les Espagnols qu’il attrapa et remonta l’Orénoque en quête de l’Eldorado. Il ne trouva rien, mais prétendit le contraire en regagnant l’Angleterre. Il avait à montrer une pépite d’or, extraite, assurait-il, d’une falaise sur les berges de l’Orénoque, et un peu de sable. La Monnaie royale dit que le sable qu’il lui demandait d’analyser ne valait rien, et d’autres insinuèrent qu’il avait acheté l’or auparavant en Afrique du Nord. Raleigh écrivit alors un livre pour prouver ses dires, et depuis quatre siècle on croit qu’il avait trouvé quelque chose. La magie du livre de Raleigh, d’une lecture vraiment ardue, repose dans son très long titre : La Découverte du grand, riche et bel Empire de Guyane, avec une relation de la grande cité dorée de Manoa (que les Espagnols appellent El Dorado) et des provinces d’Emeria, d’Aromaia, d’Amapaia et d’autres contrées, ainsi que des rivières avoisinantes. Que cela semble réel ! Alors qu’il s’était à peine aventuré sur le cours principal de l’Orénoque.
Puis, comme il arrive parfois aux escrocs, Raleigh fut rattrapé par sa propre affabulation. Vingt et un ans plus tard, vieux et malade, on le sortit de sa prison londonienne pour qu’il allât chercher en Guyane les mines d’or qu’il disait avoir découvertes. Son fils trouva la mort dans cette aventure frauduleuse. Le père, pour sauver sa réputation, pour ne pas désavouer ses mensonges, avait envoyé son fils à la mort. Ensuite, plein de chagrin, sans plus aucune raison de vivre, Raleigh retourna à Londres se faire exécuter.
L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais les Espagnols avaient la mémoire longue – sans doute parce que leur correspondance impériale était si lente : il fallait parfois deux ans pour qu’une lettre de Trinidad soit lue en Espagne. Huit ans après, les Espagnols de Trinidad et de Guyane réglaient encore leurs comptes avec les Indiens du Golfe. En témoigne cette lettre du roi d’Espagne au gouverneur de Trinidad, datée du 12 octobre 1625, que j’ai lue au British Museum : “Je vous ai demandé”, écrivait le roi, “de m’éclairer sur certaine nation d’Indiens appelés Chaguanes, dont le nombre, disiez-vous, dépasse le millier, et qui sont en si mauvaises dispositions que c’étaient eux qui conduisaient les Anglais lorsque ceux-ci s’emparèrent de la ville. Leur crime n’a pas été puni parce qu’il n’y avait pas de forces disponibles à cet effet et parce que les Indiens ne connaissent d’autre maître que leur propre volonté. Vous avez décidé de les châtier. Suivez les règles que je vous ai tracées et faites-moi connaître le résultat de vos démarches.”
Ce que fit le gouverneur, je l’ignore. Je n’ai pu trouver d’autre référence aux Chaguanes dans les dossiers du musée. Peut-être existait-il dans la montagne de papier conservée aux Archives de Séville d’autres documents sur les Chaguanes, que les doctes envoyés du gouvernement britannique laissèrent échapper ou ne jugèrent pas dignes de transcrire. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que la petite tribu de plus d’un millier d’Indiens – qui devait vivre sur les deux rives du golfe de Paria – disparut si totalement que nul dans la ville de Chaguanas ou de Chauhan ne savait quoi que ce fût à son propos. Et je me suis dit, ce jour-là au British Museum, que j’étais la première personne depuis 1625 pour qui cette lettre du roi d’Espagne signifiait réellement quelque chose. Et celle-ci n’avait été exhumée des archives qu’en 1896 ou 1897. Une disparition, puis des siècles de silence.
Nous vivions sur les terres des Chaguanes. Tous les jours de l’année scolaire – je commençais tout juste à fréquenter l’école –, je quittais la maison de ma grand-mère et longeais les deux ou trois magasins de la Grand-rue, la buvette chinoise, le théâtre du Jubilé et la petite usine portugaise aux puissantes odeurs qui fabriquait du savon bleu et jaune à bon marché, longues barres mises le matin dehors à sécher et à durcir dès le matin. Chaque jour je passais devant ces choses qui me paraissaient éternelles pour me rendre à l’école publique de Chaguanas. Par delà l’école, des plantations de canne à sucre s’étendaient jusqu’au golfe de Paria. Les Indiens dépossédés avaient leur propre genre d’agriculture, leur calendrier, leurs codes et leurs lieux sacrés. Ils comprenaient intimement les courants que trace l’Orénoque dans le golfe de Paria. Or toutes leurs connaissances et tout ce qui les concernait avait été anéanti.
Le monde est toujours en mouvement. Partout, à un moment ou à un autre, des gens sont spoliés. J’ai été bouleversé en 1967 par cette découverte à propos de ma ville natale parce que j’en ignorais tout. Mais c’était ainsi que la plupart d’entre nous vivions dans la colonie agricole : aveuglément. Non que les autorités aient médité de nous maintenir dans nos ténèbres. Je crois tout simplement que les connaissances mêmes étaient absentes. Ce genre d’information sur les Chaguanes n’aurait pas été jugé important et n’aurait pas été facile à exhumer. Ils formaient une petite tribu, et c’étaient des aborigènes. Nous avions entendu parler de leurs semblables sur le continent, dans ce qu’on appelait B.G., British Guiana, la Guyane britannique, et ils faisaient l’objet de plaisanteries. À Trinidad, et je crois dans toutes les communautés, on qualifiait de warrahoons les mauvais sujets tapageurs. Je croyais que c’était un mot forgé exprès, pour suggérer la sauvagerie. C’est seulement quand j’ai commencé à voyager au Venezuela, la quarantaine venue, que j’ai découvert que c’était le nom d’une tribu autochtone assez importante de l’endroit.
Quand j’étais enfant, il y avait une vague histoire – et c’est une histoire qui me bouleverse terriblement aujourd’hui – d’indigènes qui venaient parfois du continent en canot à certains moments, s’enfonçaient dans la forêt du sud de l’île et, à un endroit donné, cueillaient un fruit particulier ou faisaient une sorte d’offrande, puis retraversaient le golfe de Paria pour regagner l’estuaire détrempé de l’Orénoque. Ce rite devait avoir une énorme importance pour avoir survécu aux bouleversements de quatre siècles et à l’extinction des indigènes à Trinidad. Ou peut-être – bien que Trinidad et le Venezuela aient une flore commune – venaient-ils seulement cueillir un fruit particulier. Je ne sais pas. Personne ne s’en souciait, pour autant que je me le rappelle. Et maintenant le souvenir est entièrement perdu ; et ce lieu sacré, s’il existait, est désormais un terrain vague.
Le passé était passé. Je suppose que c’était l’attitude générale. Et nous autres Indiens, immigrés de l’Inde, nous avions cette attitude envers l’île. Nous menions pour l’essentiel des vies ritualisées et n’étions pas encore capables de l’auto-évaluation nécessaire pour commencer à apprendre. La moitié d’entre nous sur cette terre des Chaguanes prétendait – ou peut-être ne prétendait pas, mais sentait, sans jamais en formuler l’idée – que nous avions apporté une sorte d’Inde avec nous, que nous pouvions, pour ainsi dire, dérouler comme un tapis sur la plaine.
La maison de ma grand-mère à Chaguanes se divisait en deux parties. Celle de devant, en brique et en plâtre, était peinte en blanc. C’était une sorte de maison indienne, avec une grande terrasse à balustrade au premier et une salle de prière à l’étage au-dessus. La décoration se voulait ambitieuse : colonnes aux chapiteaux en fleur de lotus et sculptures de divinités indiennes, toutes réalisées par des gens pour qui l’Inde n’était plus qu’un souvenir. À Trinidad, c’était une bizarrerie architecturale. À l’arrière de cette demeure, et reliée à celle-ci par une galerie supérieure, s’élevait une construction en bois de style français des Antilles. L’entrée était sur le côté, entre les deux maisons. Son haut portail de tôle ondulée aux montants de bois signifiait une intimité farouche.
Enfant, j’avais donc ce sentiment de deux mondes, le monde à l’extérieur du haut portail de tôle ondulée, et le monde de chez moi – ou du moins de chez ma grand-mère. C’était un reste de notre sentiment de caste, la chose qui excluait et isolait. À Trinidad, où, nouveaux arrivants, nous formions une communauté désavantagée, cette idée d’exclusion était une sorte de protection, qui nous permettait – pour un moment seulement – de vivre à notre manière et selon nos propres règles, de vivre dans notre propre Inde en train de s’effacer. D’où un extraordinaire égocentrisme. Nous regardions vers l’intérieur ; nous accomplissions nos journées ; le monde extérieur existait dans une sorte d’obscurité ; nous ne nous interrogions sur rien.
Il y avait une échoppe musulmane juste à côté. La petite loggia de la boutique de ma grand-mère butait contre son mur aveugle. L’homme s’appelait Mian. C’était tout ce que je savais de lui et de sa famille. J’imagine que nous devions le voir, mais il ne me reste de lui aucune image mentale. Nous ne savions rien des musulmans. Cette idée de l’étranger, de ce qu’il faut contenir à l’extérieur, s’étendait même aux autres hindous. Par exemple, nous mangions du riz au milieu de la journée et du blé le soir. Or il existait des gens très bizarres qui inversaient cet ordre naturel et mangeaient du riz le soir. Pour moi ces gens étaient des étrangers – il faut m’imaginer, gamin de moins de sept ans, parce que j’avais sept ans lorsque cette vie dans la maison de ma grand-mère à Chaguanas prit fin pour moi. Nous avons déménagé dans la capitale, puis dans les collines au nord-ouest.
Mais les habitudes mentales engendrées par cette existence de confinement et d’exclusion ont longtemps persisté. Sans les nouvelles qu’écrivait mon père, je n’aurais pratiquement rien su de la vie générale de notre communauté indienne. Ces histoires m’ont donné plus que des connaissances, une sorte de solidité : un point d’appui dans le monde. Je ne peux imaginer ce que mon univers mental aurait été sans ces nouvelles.
Le monde extérieur existait dans une sorte d’obscurité ; et nous ne nous interrogions sur rien. J’étais juste assez grand pour connaître un peu les épopées indiennes, le Ramayana en particulier. Les enfants arrivés quelque cinq ans après nous dans notre famille élargie n’ont pas eu cette chance. Personne ne nous enseignait l’hindi. Parfois quelqu’un écrivait l’alphabet pour que nous l’apprenions, et c’était tout ; nous étions censés faire le reste tout seuls. Aussi, à mesure que s’infiltrait l’anglais, nous avons commencé à perdre notre langue. La maison de ma grand-mère était pleine de religion ; il y avait toute sorte de cérémonies et de lectures, certaines se prolongeant des jours entiers. Mais personne n’expliquait ou ne traduisait pour nous, qui ne pouvions plus suivre la langue. Notre foi ancestrale s’est donc dissoute, est devenue mystérieuse, sans écho dans notre vie quotidienne.
Nous ne cherchions pas à nous renseigner sur l’Inde ou sur les familles que les gens avaient laissées là-bas. Quand notre manière de penser eut changé et que nous avons voulu le savoir, il était trop tard. Je ne sais rien de ma branche paternelle ; je sais seulement que quelques-uns venaient du Népal. Il y a deux ans, un aimable Népalais, à qui mon nom plaisait, m’a envoyé quelques pages recopiées dans un répertoire géographique anglais de 1872 sur l’Inde, Castes et tribus hindoues à Bénarès. On y trouvait, parmi une multitude d’autres noms, une liste de Népalais résidant dans la ville sainte de Bénarès qui portaient le nom de Naipal. C’est tout ce que j’ai.
Loin de ce côté de chez ma grand-mère, où nous mangions du riz au milieu de la journée et du blé le soir, s’étendait le vaste inconnu – dans cette île de seulement 400 000 habitants. Il y avait les Africains et les métis d’Africains, qui formaient la majorité. Ils étaient policiers, maîtres d’école. Telle ma première institutrice à l’école publique de Chaguanas ; je me suis souvenu d’elle avec adoration des années durant. Il y avait la capitale, où très bientôt nous allions tous devoir aller pour faire nos études et trouver du travail, et où nous nous installerions définitivement, parmi des étrangers. Il y avait les Blancs, pas tous anglais ; et les Portugais, et les Chinois, immigrés autrefois comme nous. Et, les plus mystérieux de tous, ceux que nous appelions les ‘pagnols, gens mélangés au teint chaud et brun venus du temps de l’Espagne, avant que l’île fût détachée du Venezuela et de l’Empire espagnol – un genre d’histoire qui dépassait totalement ma compréhension d’enfant.
Pour vous donner cette idée de mes racines, j’ai dû faire appel à un savoir et à des idées qui me sont venus bien après, et d’abord de l’écriture. Enfant, je ne savais presque rien, rien au-delà de ce que j’avais appris chez ma grand-mère. Tous les enfants, j’imagine, viennent au monde comme ça, sans savoir qui ils sont. Mais le petit Français, par exemple, ce savoir l’attend. Il est tout autour de lui. Il lui vient indirectement de la conversation des adultes. Il se trouve dans les journaux et à la radio. Et à l’école, les travaux de générations de savants, simplifiés pour les manuels scolaires, vont lui donner une certaine idée de la France et des Français.
À Trinidad, si brillant sujet que je fusse, j’étais environné de zones d’obscurité. L’école n’élucidait rien pour moi. J’étais gavé de faits et de formules. Tout devait être appris par cœur ; tout était abstrait pour moi. Là encore, je ne crois pas qu’il y avait un plan ou un complot pour rendre nos cours semblables. Ce que nous recevions, c’était le savoir scolaire standard. Dans un autre cadre, il aurait eu un sens. Et du moins une partie de l’échec m’eût été imputable. Avec mon expérience sociale limitée, il m’était difficile d’entrer par l’imagination dans d’autres sociétés, proches ou lointaines. J’adorais l’idée des livres, mais j’avais du mal à les lire. J’étais le plus à l’aise avec des choses comme Andersen et Ésope, hors du temps, hors de l’espace, sans exclusive. Et quand enfin en terminale j’ai fini par aimer certains de nos textes littéraires – Molière, Cyrano de Bergerac –, j’imagine que c’est parce qu’ils avaient quelque chose du conte de fée.
Quand je suis devenu écrivain, ces zones de ténèbres qui m’environnaient enfant sont devenus mes sujets. Le pays, les aborigènes, le Nouveau Monde, la colonie, l’histoire, l’Inde, le monde musulman – auquel je me sentais aussi lié –, l’Afrique, puis l’Angleterre, où j’écrivais mes livres. C’est ce que j’avais à l’esprit en disant que mes livres se dressent l’un sur l’autre et que je suis la somme de mes livres. Et en disant que mes origines, source et aiguillon de mon œuvre, étaient à la fois extrêmement simples et extrêmement compliquées. Vous avez vu à quel point tout était simple dans la petite ville de Chaguanas. Et je crois que vous comprendrez combien ce fut compliqué pour l’écrivain. Surtout au début, quand les modèles littéraires dont je disposais – les modèles donnés par ce que je ne peux qu’appeler mon faux savoir – traitaient de sociétés entièrement différentes. Peut-être aurez-vous néanmoins l’impression que le matériau était si riche qu’il n’y avait aucune difficulté à commencer et à continuer. Mais ce que j’ai dit de mes origines vient du savoir que j’ai acquis en écrivant. Et vous devez me croire quand je dis que la structure de mon œuvre ne m’apparaît clairement que depuis deux ou trois mois. On m’a lu des passages de mes premiers livres et j’ai vu les connexions. Jusqu’alors, le plus difficile pour moi était de décrire mon travail aux gens, d’expliquer ce que j’avais fait.
J’ai dit que j’étais un écrivain d’intuition. C’était le cas, et il en va encore ainsi aujourd’hui que je suis si près de la fin. Je n’ai jamais eu de plan. Je n’ai suivi aucun système. J’ai travaillé intuitivement. Mon but à chaque fois était de faire un livre, de créer quelque chose de facile et d’intéressant à lire. À chaque étape, il me fallait travailler dans les limites de mes connaissances, de ma sensibilité, de mon talent et de ma vision du monde. Tout cela s’est développé livre après livre. Et il me fallait écrire ces livres, parce qu’il n’en existait aucun sur ces sujets qui me donnât ce que je voulais. Je devais défricher mon univers, l’élucider, pour moi-même.
J’ai dû aller consulter les documents au British Museum et ailleurs, pour trouver la sensation juste de l’histoire de la colonie. Il m’a fallu aller en Inde, parce qu’il n’y avait personne pour me dire à quoi ressemblait l’Inde dont mes grands-parents étaient venus. Il y avait certes les textes de Nehru et de Gandhi ; et curieusement, ce fut Gandhi, et son expérience sud-africaine, qui m’a apporté le plus, mais pas suffisamment. Il y avait Kipling ; et des auteurs anglo-indiens comme John Masters (très en vogue dans les années 1950, et qui annonçait, projet abandonné par la suite, je le crains, une fresque en trente-cinq romans sur l’Inde britannique) ; il y avait les romancières. Les rares auteurs indiens qui avaient percé à l’époque étaient des gens des classes moyennes, des citadins ; ils ne connaissaient pas l’Inde dont nous venions.
Et quand ce besoin indien fut satisfait, d’autres devinrent apparents : l’Afrique, l’Amérique du Sud, le monde musulman. Le but a toujours été d’étoffer mon image du monde, et la raison en vient de mon enfance : me rendre plus à l’aise avec moi-même. On me demande parfois d’aller en Allemagne, par exemple, ou en Chine, pour écrire un livre. Mais il y a beaucoup de bons livres sur ces endroits ; je suis tout à fait disposé à m’en remettre à la littérature existante. D’ailleurs, ce sont des sujets pour d’autres gens. Ce ne sont pas les zones de ténèbres que je sentais autour de moi, enfant. Par conséquent, de même qu’il y a un développement dans mon œuvre, un développement de la technique narrative, du savoir et de la sensibilité, il existe également une sorte d’unité, un point de mire, même si je peux donner l’impression d’aller dans de multiples directions.
Quand j’ai commencé, je ne savais pas du tout où j’allais. Je voulais seulement faire un livre. J’essayais d’écrire en Angleterre, où j’étais resté après mes années d’université, et j’avais l’impression que mon expérience était très mince, n’était pas vraiment de l’étoffe des livres. Dans aucun livre je ne pouvais trouver quoi que ce fût qui approchât ce que j’avais connu enfant. Le jeune Français ou le jeune Anglais qui avait envie d’écrire aurait trouvé d’innombrables modèles pour le mettre sur la voie. Je n’en avais aucun. Les histoires de mon père sur notre communauté indienne appartenaient au passé. Mon univers était très différent. Plus urbain, plus mélangé. Les détails physiques de l’existence chaotique de notre famille élargie – chambres à coucher ou emplacements pour dormir, heures des repas, le nombre même des gens – semblaient impossibles à manier. Il y avait trop de choses à expliquer, à la fois sur ma vie familiale et sur le monde extérieur. Et en même temps il y avait aussi trop de choses sur nous – comme nos propres ancêtres et notre propre histoire – que j’ignorais.
Enfin j’eus un jour l’idée de commencer par la rue de Port of Spain où nous avions emménagé après Chaguanas. Pas de grand portail en tôle ondulée pour exclure le monde. La vie de la rue m’était ouverte. C’était pour moi un plaisir intense que de l’observer depuis la véranda. C’est cette vie de la rue que j’ai commencé à raconter. Je voulais écrire vite, pour éviter trop d’introspection, et j’ai donc simplifié. J’ai supprimé l’histoire personnelle du jeune narrateur, j’ai ignoré les complexités raciales et sociales de la rue. Je n’ai rien expliqué. Je suis resté au ras du sol, pour ainsi dire. Je ne présentais les gens que tels qu’il apparaissaient dans la rue. J’écrivais une nouvelle par jour. Les cinq premières étaient très courtes, et je commençais à me demander si j’aurais suffisamment de matière. Puis la magie de l’écriture a opéré. Les matériaux ont commencé à affluer de tous côtés. Les histoires sont devenues plus longues ; impossible de les écrire en une seule journée. Enfin l’inspiration, qui un moment avait paru très facile, m’emportant sur sa vague, s’est tarie. Mais un livre avait été écrit, et j’étais devenu, pour moi en tout cas, un écrivain.
La distance entre l’écrivain et son matériau s’est creusée dans les deux livres suivants ; la vision était plus large. Puis l’intuition m’a conduit à entreprendre un gros volume sur notre vie familiale. Mon ambition d’écrivain grandissait. Mais quand il a été terminé, j’ai eu le sentiment que j’avais tiré tout ce que je pouvais de mon île. J’avais beau réfléchir, aucune autre histoire ne me venait.
Le hasard, alors, est venu à mon secours. Je suis devenu voyageur. J’ai voyagé aux Antilles et j’ai bien mieux compris le mécanisme colonial dont j’avais fait partie. Je suis allé en Inde, la patrie de mes ancêtres, pendant un an ; ce voyage a brisé ma vie en deux. Les livres que j’ai écrits sur ces deux voyages m’ont hissé vers de nouveaux domaines d’émotion, m’ont donné une vision du monde que je n’avais jamais eue, m’ont élargi techniquement. Le roman qui m’est venu ensuite m’a permis de cerner l’Angleterre en même temps que les Antilles – et que ce fut difficile ! J’y suis également parvenu à appréhender tous les groupes raciaux de l’île, ce que je n’avais jamais encore pu faire.
Ce nouveau roman parlait de la culpabilité et des phantasmes coloniaux, de la façon, en fait, dont les faibles mentent sur eux-mêmes et se mentent à eux-mêmes, puisque c’est leur seule ressource. Intitulé The Mimic Men (“Les Imitateurs”), ce livre évoquait les hommes des colonies qui singent la condition d’adultes, ces hommes qui ont fini par n’avoir plus confiance en rien qui les concerne. On m’a lu quelques pages de ce livre l’autre jour – je ne l’avais pas ouvert depuis plus de trente ans – et j’ai compris que j’avais écrit de la schizophrénie coloniale. Mais je ne m’en étais pas rendu compte alors. Je ne me suis jamais servi de mots abstraits pour décrire aucun de mes projets littéraires. Sinon, je ne serais jamais arrivé à faire ce livre. Il a été écrit intuitivement, et seulement à partir de l’observation la plus minutieuse.
J’ai présenté cette brève description de mes débuts littéraires pour essayer de montrer par quelles étapes, en tout juste dix ans, le lieu de ma naissance s’est transformé ou développé dans mon écriture : de la comédie de la vie de la rue à une étude d’une sorte de schizophrénie générale. Ce qui était simple était devenu compliqué.
Ce sont la fiction et le récit de voyage qui m’ont donné ma manière de voir ; et vous ne vous étonnerez pas que pour moi toutes les formes littéraires aient valeur égale. J’ai compris, par exemple, en entreprenant mon troisième livre sur l’Inde – vingt-six ans après le premier – que le plus important dans un récit de voyage ce sont les gens parmi lesquels se promène l’écrivain. Il faut que les gens se définissent eux-mêmes. Idée fort simple, mais qui exigeait une nouvelle forme de livre, une nouvelle manière de voyager. Et c’est la même méthode dont je me suis servi ensuite, lorsque je suis allé, pour la deuxième fois, dans le monde musulman.
Je suis toujours mû par la seule intuition. Je n’ai pas de système, littéraire ou politique. Je n’ai pas de principe politique directeur. Sans doute à cause de mon ascendance. L’écrivain indien R. K. Narayan, mort cette année, n’avait pas d’idées politiques. Mon père, qui écrivait ses histoires à une époque très sombre, et sans la moindre récompense, non plus. Peut-être parce que nous sommes restés loin de l’autorité pendant des siècles. Cela nous donne un point de vue particulier. J’ai le sentiment que nous sommes plus enclins à voir l’humour et la pitié des choses.
Il y a près de trente ans, je suis allé en Argentine. C’était l’époque de la guerilla. Les gens attendaient le retour d’exil de l’ancien dictateur Perón. Le pays débordait de haine. Les péronistes attendaient de régler de vieux comptes. L’un d’eux m’a dit : “Il y a une bonne torture et une mauvaise torture.” La bonne torture était ce que vous faisiez aux ennemis du peuple. La mauvaise ce que vous faisaient les ennemis du peuple. Les gens de l’autre côté disaient la même chose. Aucun débat véritable sur quoi que ce soit. Il n’y avait que la passion et le jargon politique emprunté à l’Europe. “Là où”, écrivais-je, “le jargon transforme les problèmes vivants en abstractions, et où les jargons finissent par s’affronter, les gens n’ont pas de causes. Ils n’ont que des ennemis.” Et les passions continuent de se donner libre cours en Argentine, anéantissant toute raison et détruisant des vies. Aucune solution n’est en vue.
J’approche maintenant de la fin de mon travail. Je suis heureux d’avoir fait ce que j’ai fait, heureux de m’être avancé dans la création aussi loin que j’ai pu. Grâce à la manière intuitive dont j’écris, et aussi à la nature déconcertante de mon matériau, chaque livre s’est révélé une bénédiction. Chaque livre m’a éberlué ; jusqu’au moment d’écrire je ne savais jamais qu’il était là. Mais le plus grand miracle pour moi c’était de commencer. J’ai le sentiment – et l’angoisse est toujours présente pour moi – que j’aurais aisément pu échouer avant d’avoir commencé.
Je vais finir comme j’ai débuté, par l’un de ces merveilleux essais de Proust dans Contre Sainte-Beuve : “Les belles choses que nous écrirons si nous avons du talent sont en nous, indistinctes, comme le souvenir d’un air, qui nous charme sans que nous puissions en retrouver le contour […]. Ceux qui sont hantés de ce souvenir confus des vérités qu’ils n’ont jamais connues sont les hommes qui sont doués. […] Le talent est comme une sorte de mémoire qui leur permettra de finir par rapprocher d’eux cette musique confuse, de l’entendre clairement, de la noter […].”
Le talent, dit Proust. Je dirais la chance, et beaucoup de travail.
Traduction: Philippe Delamare
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 12 laureates' work and discoveries range from proteins' structures and machine learning to fighting for a world free of nuclear weapons.
See them all presented here.