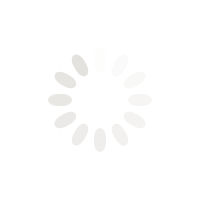Kazuo Ishiguro – Conférence Nobel
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Spanish
Spanish [pdf]
Le 7 décembre 2017
Ma soirée du XXe siècle – et autres petites incursions
Si vous m’aviez croisé à l’automne 1979, vous auriez sans doute eu quelques difficultés à définir mon milieu social ou même, mes origines. J’étais alors âgé de 24 ans. J’avais les traits d’un Japonais, mais au contraire de la plupart des hommes japonais qu’on voyait en Grande Bretagne à l’époque, j’avais des cheveux longs jusqu’aux épaules, et une moustache tombante de gangster. Le seul accent perceptible dans ma voix était celui d’un garçon qui avait grandi dans les comtés du sud de l’Angleterre, avec parfois l’intonation langoureuse, déjà datée, du jargon de l’ère hippie. Si nous avions engagé la conversation, nous aurions peut-être discuté du Football Total de Hollande, du dernier album de Bob Dylan, ou de l’année que je venais de passer en compagnie des sans-abri de Londres. Si vous aviez mentionné le Japon, me posant des questions sur sa culture, vous auriez pu déceler une trace d’impatience dans ma réaction alors que j’avouais mon ignorance, l’imputant au fait que je n’étais jamais retourné dans ce pays – même pour des vacances – depuis que je l’avais quitté à cinq ans.
Cet automne-là, je suis arrivé avec un sac à dos, une guitare et une machine à écrire portative à Buxton, dans le Norfolk – un petit village anglais avec un vieux moulin à eau et tout autour, une étendue plate de terres agricoles. J’étais venu dans cet endroit parce que j’avais été accepté pour une année dans un programme postdoctoral en création littéraire à l’université d’East Anglia. Elle se trouvait à Norwich, la capitale, à seize kilomètres de là, mais je n’avais pas de voiture et mon seul moyen d’y parvenir était un service de bus qui ne fonctionnait que trois fois par jour, le matin, à midi et le soir. Je découvris bientôt que ce n’était pas vraiment un problème: ma présence à l’université était rarement requise plus de deux fois par semaine. J’avais loué une chambre dans une petite maison appartenant à un homme d’une trentaine d’années dont la femme venait de le quitter. Pour lui, cette demeure était sans doute remplie des fantômes de ses rêves détruits – ou peut-être voulait-il juste m’éviter; en tout cas, je passais des jours d’affilée sans le voir. En d’autres termes, après la vie frénétique que j’avais menée à Londres, je me retrouvais ici, disposant, pour me transformer en écrivain, d’une tranquillité et d’une solitude peu habituelles.
En fait, ma petite chambre n’était pas sans rappeler la mansarde d’un auteur classique. La pente des plafonds vous rendait claustrophobe – mais si je me dressais sur la pointe des pieds, je voyais, par mon unique fenêtre, les champs labourés se déployant à perte de vue. Il y avait une petite table, dont ma machine à écrire et une lampe de bureau occupaient presque toute la surface. Sur le sol, en guise de lit, un grand rectangle de mousse industrielle qui me faisait transpirer dans mon sommeil, même durant les nuits glaciales de Norfolk.
Dans cette pièce, j’étudiai avec soin les deux nouvelles que j’avais écrites pendant l’été, me demandant si elles étaient assez bonnes pour être soumises à mes nouveaux camarades de classe. (Je savais que nous étions un groupe de six, qui se réunissait tous les quinze jours.) À ce stade de ma vie je n’avais pas écrit grand-chose d’intéressant en matière de fiction, et c’était grâce à une pièce radiophonique refusée par la BBC que j’avais été admis dans ce cours. En réalité, ayant fait auparavant de solides projets pour devenir une rock star dès l’âge de vingt ans, mes ambitions littéraires ne m’étaient apparues que récemment. Les deux nouvelles que j’examinais avaient été écrites dans un état de panique, en réponse à la lettre m’apprenant mon inscription au programme de l’université. Un pacte de suicide macabre était le sujet de l’une, et le thème de l’autre, les combats de rue en Écosse, où j’avais passé quelque temps comme travailleur social. Elles n’étaient pas très bonnes. J’en commençai une sur un adolescent qui empoisonne son chat, située elle aussi dans la Grande Bretagne d’aujourd’hui. Puis un soir, pendant ma troisième ou quatrième semaine dans cette petite chambre, je me retrouvai en train d’écrire sur le Japon, avec un sentiment d’urgence d’une force inédite – sur Nagasaki, la ville de ma naissance, aux derniers jours de la Seconde Guerre Mondiale.
Ce fut, je dois le souligner, une surprise pour moi. Aujourd’hui, la tendance dominante pousse un jeune auteur débutant au bagage culturel métissé à explorer ses racines d’instinct, pour ainsi dire. Mais c’était loin d’être le cas alors. L’explosion de la littérature “multiculturelle” n’aurait lieu que quelques années plus tard en Grande-Bretagne. Salman Rushdie était un inconnu dont le seul roman publié était épuisé. Si on leur avait demandé de citer le jeune romancier britannique le plus renommé, les gens auraient peut-être répondu Margaret Drabble; et parmi les auteurs plus âgés, Iris Murdoch, Kingsley Amis, William Golding, Anthony Burgess, John Fowles. Les étrangers comme Gabriel Garcia Marquez, Milan Kundera ou Borges restaient des auteurs confidentiels, leurs noms n’évoquaient rien, même aux lecteurs passionnés.
Tel était le climat littéraire en ce temps-là, au point que lorsque j’achevai cette première nouvelle japonaise, malgré ma certitude d’avoir découvert une direction essentielle, je me demandai aussitôt s’il ne fallait pas considérer ce début comme une œuvre complaisante; je devrais peut-être revenir sans tarder à un sujet plus “normal”. Je ne commençai à la montrer qu’après beaucoup d’hésitations, et jusqu’à aujourd’hui, je suis profondément reconnaissant à mes camarades étudiants, à mes professeurs Malcolm Bradbury et Angela Carter, et au romancier Paul Bailey – écrivain résident de l’université cette année-là – pour leur réaction résolument encourageante. S’ils avaient eu un avis moins positif, je n’aurais sans doute jamais plus écrit sur le Japon. En tout état de cause, je suis retourné dans ma chambre pour écrire et écrire encore. Pendant l’hiver 1979-80, et une bonne partie du printemps, je n’ai parlé à presque personne, à l’exception des cinq autres étudiants de ma classe, de l’épicier du village auquel j’achetais les céréales du petit déjeuner et les rognons d’agneau qui me permettaient de subsister, et de ma petite amie Lorna (devenue aujourd’hui ma femme) qui me rendait visite un week-end sur deux. Ce n’était pas une vie équilibrée, mais au cours de ces quatre ou cinq mois je réussis à achever une moitié de mon premier livre, Lumière pâle sur les collines – situé aussi à Nagasaki, pendant les années de reconstruction après le largage de la bombe atomique. Je me rappelle avoir parfois joué avec des idées de nouvelles situées ailleurs qu’au Japon, mais mon intérêt déclinait rapidement.
Ces mois furent décisifs pour moi, dans la mesure où sans eux, je ne serais jamais devenu écrivain. Depuis, j’y ai souvent repensé et je me suis demandé: qu’est-ce qui m’avait pris ? D’où venait cette curieuse énergie ? J’en ai conclu qu’à ce point précis de mon existence, je m’étais engagé dans un acte de préservation d’une urgence extrême. Pour l’expliquer, je dois revenir un peu en arrière.
*
En avril 1960, à l’âge de cinq ans, j’étais arrivé en Angleterre avec mes parents et ma sœur, dans la ville de Guildford, comté de Surrey, riche banlieue cossue à cinquante kilomètres au sud de Londres. Mon père était un chercheur, spécialiste de l’océanographie, venu travailler pour le gouvernement britannique. La machine qu’il inventa par la suite, soit dit en passant, fait aujourd’hui partie de la collection permanente du musée des Sciences de Londres.
Les photographies prises peu après notre arrivée montrent une Angleterre d’une époque disparue. Les hommes portent des pullovers avec un col en V et une cravate, les voitures ont encore des marchepieds et une roue de secours à l’arrière. Les Beatles, la révolution sexuelle, les manifestations d’étudiants, le “multiculturalisme” étaient au coin de la rue, mais il est difficile d’imaginer que l’Angleterre s’en soit seulement doutée lorsque ma famille a découvert le pays. Rencontrer un étranger de France ou d’Italie était déjà extraordinaire – sans parler d’un Japonais.
Notre famille habitait dans une impasse de douze maisons, à l’endroit précis où les rues pavées finissaient et où la campagne commençait. À moins de cinq minutes à pied de la ferme locale et du chemin entre les champs que des rangées de vaches arpentaient péniblement dans les deux sens. Une charrette tirée par un cheval livrait le lait. J’ai gardé de mes premiers jours dans ce pays le souvenir vivace du spectacle des hérissons – les mignonnes créatures nocturnes à piquants, alors nombreuses dans cette région – écrasés par des roues de voiture pendant la nuit, abandonnés dans la rosée du matin, déposés avec soin au bord de la route, attendant d’être ramassés par les éboueurs.
Tous nos voisins fréquentaient l’église, et quand je venais jouer avec leurs enfants, je remarquais qu’ils disaient une petite prière avant de manger. Je suivais les cours de catéchisme, et bientôt je chantai dans la chorale, devenant, à l’âge de dix ans, le premier chef de chœur japonais jamais vu à Guildford. J’allais à l’école primaire locale – j’étais sans nul doute le seul enfant non-anglais de toute l’histoire de cet établissement – et dès mes onze ans, je pris le train pour me rendre au lycée d’une ville voisine, partageant chaque matin le wagon avec des rangées d’hommes en costume à rayures et chapeau melon, qui se rendaient à Londres pour travailler dans les bureaux.
À ce stade, j’avais appris à maîtriser à la perfection les bonnes manières exigées des garçons anglais de la classe moyenne. Lorsque je rendais visite à un ami, je savais que je devais me mettre au garde-à-vous dès qu’un adulte entrait dans la pièce; pendant un repas, je devais demander la permission avant de sortir de table. Seul garçon étranger du quartier, une sorte de gloire locale me précédait partout. D’autres enfants savaient qui j’étais avant de me rencontrer. Des adultes que je ne connaissais absolument pas m’appelaient par mon nom dans la rue ou le magasin du quartier.
Lorsque je repense à cette période, je me rappelle que cela se passait moins de vingt ans après la fin d’une guerre mondiale pendant laquelle les Japonais avaient été les pires ennemis des Anglais, et je suis stupéfait par l’ouverture d’esprit et la générosité spontanée dont cette communauté anglaise ordinaire fit preuve en nous acceptant. L’affection, le respect et la curiosité que je conserve jusqu’à ce jour pour cette génération de Britanniques qui avaient réchappé de la Seconde Guerre Mondiale, et bâti un remarquable État-providence dans son sillage, proviennent largement de mes expériences personnelles pendant ces années.
Mais en même temps, je menais une autre vie à la maison avec mes parents japonais. Sous notre toit il y avait des règles différentes, des espoirs différents, une langue différente. À l’origine mes parents avaient eu l’intention de rentrer au Japon au bout d’un an, deux peut-être. En fait, durant nos onze premières années en Angleterre, nous vivions dans l’attente perpétuelle du retour “l’an prochain”. Par conséquent, le point de vue de mes parents restait celui de visiteurs, et non d’immigrants. Ils échangeaient souvent des remarques sur les étranges coutumes des autochtones, sans ressentir la moindre obligation de les adopter. Pendant longtemps demeura l’hypothèse que je rentrerais au Japon pour y passer ma vie adulte, et ils s’efforcèrent de maintenir l’aspect japonais de mon éducation. Chaque mois arrivait du Japon un colis contenant les bandes dessinées, les magazines et les publications scolaires du mois précédent, que je m’empressais de dévorer. Ces colis cessèrent d’arriver pendant mon adolescence – peut-être après la mort de mon grand-père – mais les conversations de mes parents sur leurs vieux amis et les membres de leur famille, le récit des épisodes de leur vie au Japon, maintenaient un flux régulier d’images et d’impressions. Pour ma part, j’avais toujours ma propre réserve de souvenirs – étonnamment vaste et limpide: de mes grands-parents, de jouets préférés que j’avais laissés, de la maison japonaise traditionnelle où nous habitions (je peux aujourd’hui encore la reconstituer pièce par pièce dans mon esprit),de mon école maternelle, de l’arrêt local du tram, du chien féroce qui vivait près du pont, du fauteuil du coiffeur spécialement adapté pour les petits garçons avec un volant de voiture fixé devant la grande glace.
Par conséquent, pendant toute mon enfance, bien avant de songer à créer des mondes fictionnels en prose, je m’affairais à construire dans mon esprit un lieu riche en détails qui s’appelait “le Japon” – un lieu auquel j’appartenais en quelque sorte, où je puisais un certain sens de mon identité, et ma confiance en moi. Le fait que je n’étais jamais retourné physiquement au Japon pendant cette période ne servait qu’à rendre ma propre vision du pays plus vivace et personnelle.
D’où le besoin de préservation. Car à partir de l’âge de vingt-cinq ans – bien que je ne l’aie jamais clairement exprimé alors – j’ai pris conscience de certains éléments clés. Je commençais à accepter le fait que “mon” Japon ne correspondait peut-être guère à l’endroit où je pouvais me rendre en avion; que le mode de vie dont parlaient mes parents, et dont le souvenir me venait de ma petite enfance, avait en grande partie disparu pendant les années soixante et soixante-dix; que de toute manière, le Japon qui existait dans ma tête avait peut-être toujours été une construction émotionnelle élaborée par un enfant grâce à la mémoire, l’imagination et la réflexion. Et peut-être plus important encore, je me rendais compte qu’année après année, à mesure que je vieillissais, ce Japon inventé – ce lieu précieux qui m’avait accompagné jusqu’à ce jour – devenait de plus en plus flou.
Je suis aujourd’hui certain que ce fut le sentiment que “mon” Japon était unique et en même temps terriblement fragile – inaccessible à une vérification de l’extérieur – qui me poussa à travailler dans cette petite chambre à Norfolk. Je couchais sur le papier les nuances particulières de ce monde, ses coutumes, ses règles de savoir-vivre, sa dignité, ses lacunes, toutes les pensées que m’avait inspiré cet endroit, avant qu’elles s’effacent de mon esprit. J’avais le souhait de recréer mon Japon dans une fiction, de le garder à l’abri, afin de pouvoir ensuite désigner un livre et dire: “Oui, mon Japon se trouve dans ces pages.”
*
Au printemps 1983, trois ans et demi plus tard, Lorna et moi vivions désormais à Londres dans un logement de deux pièces, sous les combles d’une maison haute et étroite qui se dressait au sommet d’une colline, l’un des points les plus élevés de la ville. Il y avait une antenne de télévision tout près et quand nous essayions d’écouter des disques sur notre platine, des voix fantomatiques retransmises envahissaient nos hauts-parleurs. Notre séjour n’avait ni canapé ni fauteuil, mais deux matelas recouverts de coussins, posés à même le sol. Il y avait aussi une grande table sur laquelle j’écrivais pendant la journée, et où nous dînions le soir. Ce n’était pas luxueux, mais nous aimions vivre là. J’avais publié mon premier roman l’année précédente, et le court-métrage dont j’avais écrit le scénario serait bientôt diffusé par la télévision britannique.
Pendant quelque temps j’avais été assez fier de mon livre, mais ce printemps-là, un sentiment d’insatisfaction me taraudait. Il y avait un problème. Mon premier roman et mon premier scénario pour la télévision avaient trop de similitudes. Il ne s’agissait pas du sujet, mais de la méthode et du style. Plus j’y réfléchissais, et plus mon roman ressemblait à un scénario – dialogue plus indications. Rien de grave, jusqu’à un certain point, mais je souhaitais à présent écrire une fiction qui ne soit efficace que sur la page. À quoi bon écrire un roman qui ne procure rien de plus au lecteur que ce qu’il peut éprouver en allumant son poste de télévision ? Comment la fiction écrite pouvait-elle espérer de survivre face à la puissance du cinéma et de la télévision si elle n’offrait pas quelque chose d’unique, une œuvre que les autres formes de création n’étaient pas capables de réaliser ?
Vers cette époque, j’attrapai un virus et je dus m’aliter quelques jours. Lorsque je commençai à me sentir mieux, et que l’envie de dormir sans arrêt se dissipa, je découvris que le lourd objet dont la présence dans mes draps m’incommodait depuis quelque temps, était en réalité un exemplaire du premier volume d’À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. J’entamai donc sa lecture. Mon état encore fiévreux fut peut-être un facteur, mais la première partie, Combray, me captiva totalement. Je la lus et la relus encore. Mise à part la beauté pure de ces passages, je fus fasciné par la manière dont Proust enchaînait les épisodes. L’ordre des événements et des scènes ne respectait pas les exigences habituelles de la chronologie, ni celles d’une intrigue linéaire. Au lieu de cela, les associations de pensée décousues, ou les caprices de la mémoire, semblaient entraîner le récit d’un épisode à l’autre. Parfois je me surprenais à me demander : pourquoi ces deux moments sans lien apparent étaient-ils placés côte à côte dans l’esprit du narrateur ? Je vis soudain comment composer mon second roman d’une façon plus libre, très intéressante; cela créerait une richesse sur la page, et introduirait des mouvements internes impossibles à capter sur un écran. Si je pouvais évoluer d’un passage à l’autre en fonction des associations de pensée du narrateur et de la fluctuation des souvenirs, je réussirais à composer une œuvre à la façon d’un peintre abstrait qui choisit l’emplacement des formes et des couleurs sur une toile. Je pouvais juxtaposer une scène survenue deux jours auparavant à une séquence remontant à vingt ans, et demander au lecteur de méditer le rapport entre les deux. De cette manière, pensais-je, il me serait possible de laisser entrevoir les multiples strates du déni et de l’aveuglement qui brouillaient la perception que chacun de nous a de son moi et de son passé.
*
Mars 1988. J’avais 33 ans. Nous possédions désormais un canapé et j’y étais allongé, écoutant un album de Tom Waits. L’année précédente, Lorna et moi avions acheté notre propre maison dans un quartier au sud de Londres, peu à la mode mais agréable, et dans cette demeure, pour la première fois, je disposais d’un bureau. Il était petit, n’avait pas de porte, mais j’étais enchanté de pouvoir étaler mes papiers sans avoir besoin de les ranger à la fin de la journée. Dans ce même bureau, je venais – du moins je le croyais – d’achever mon troisième roman. Le premier dont le cadre n’était pas japonais – mon Japon personnel ayant perdu de sa fragilité grâce à l’écriture de mes livres précédents. En réalité mon roman suivant, qui devait s’appeler Les vestiges du jour, paraissait anglais à un point extrême – mais, espérais-je, pas dans le style de nombreux écrivains britanniques de l’ancienne génération. Au contraire de la plupart d’entre eux, supposais-je, je ne partais pas du principe que mes lecteurs étaient tous anglais, dotés d’une connaissance innée des subtilités et des préoccupations anglaises. À présent, des écrivains tels que Salman Rushdie et V.S. Naipaul avaient ouvert la voie à une littérature plus internationale, tournée vers l’extérieur, qui ne revendiquait pas la centralité de la Grande-Bretagne, ni son importance systématique. Leur œuvre était post-coloniale dans le sens le plus large du terme. Je voulais, comme eux, créer une fiction “internationale” qui franchirait aisément les frontières linguistiques et culturelles, même en écrivant une histoire située dans un monde qui paraissait typiquement anglais. Ma version de l’Angleterre serait en quelque sorte une version mythique dont les contours, j’en étais persuadé, étaient déjà présents dans l’imagination de beaucoup de gens dans le monde, même si certains n’avaient jamais visité le pays.
Le personnage principal du roman que je venais de terminer était un majordome anglais qui se rend compte trop tard qu’il s’est trompé de valeurs morales pendant toute sa vie; et qu’il a consacré ses meilleures années à servir un sympathisant nazi; qu’en évitant d’assumer une responsabilité morale et politique dans son existence, il a gâché cette vie au sens le plus profond du terme. Plus encore: dans son désir de devenir le domestique parfait, il s’est interdit d’aimer la seule femme qui lui tient à cœur, et d’être aimé par elle.
J’avais relu mon manuscrit à plusieurs reprises, et j’étais assez satisfait. Mais le sentiment lancinant qu’il manquait quelque chose persistait.
Je me trouvais donc un soir dans notre maison, ainsi que je l’ai dit, allongé sur le canapé, en train d’écouter Tom Waits. Et Tom Waits entonna une chanson intitulée “Ruby’s arms”. Peut-être que certains d’entre vous la connaissent. (J’ai même envisagé de vous la chanter maintenant, mais j’ai changé d’avis.) C’est une ballade sur un homme, sans doute un soldat, qui part en laissant son amante endormie. C’est le petit matin, il descend la rue, prend un train. Rien d’anormal. Mais la voix qui interprète la chanson est celle d’un clochard américain bourru fort peu habitué à révéler ce qu’il ressent au fond de lui. Puis vient un moment, au milieu de la chanson, où l’homme nous dit qu’il a le cœur brisé. L’émotion de cet instant est presque insupportable, à cause de la tension entre le sentiment lui-même et l’énorme résistance que le soldat doit visiblement surmonter pour l’exprimer. Tom Waits chante le vers avec une magnificence cathartique, alors que sous le poids d’une tristesse extrême, s’écroule le stoïcisme de toute une vie de dur à cuire.
En écoutant Tom Waits, je compris que ma tâche n’était pas terminée. Quelque temps auparavant, j’avais décidé sans réfléchir que mon majordome anglais conserverait ses défenses émotionnelles, qu’il parviendrait, grâce à ce bouclier, à se cacher de lui-même et de son lecteur jusqu’au bout. Je comprenais à présent que je devais revenir sur cette décision. Juste un moment, vers la fin de mon livre, un moment que je devrais choisir avec soin, je devrais percer son armure. Faire entrevoir un désir immense et tragique.
Je dois préciser qu’en de multiples occasions, les voix des chanteurs m’ont enseigné des leçons essentielles. Ici, je me réfère moins aux paroles qu’au chant lui-même. Nous le savons, une voix humaine qui chante est capable d’exprimer un mélange d’émotions d’une complexité insondable. Au cours des années, divers aspects de mon écriture ont été influencés par Bob Dylan, Nina Simone, Emmylou Harris, Ray Charles, Bruce Springsteen, Gillian Welch et mon amie et collaboratrice Stacey Kent. Je percevais quelque chose dans leurs voix, et je me disais: “Ah oui, c’est ça. C’est ce que je dois saisir dans cette scène. Une sensation très proche de cela.” Souvent, c’est une émotion que je ne peux formuler avec des mots, mais elle est là, dans la voix du chanteur, et je sais dans quel sens je dois aller.
*
En octobre 1999 je fus invité par le poète allemand Christoph Heubner, au nom de la Commission internationale d’Auschwitz, à consacrer quelques jours à la visite de l’ancien camp de concentration. J’étais logé au Centre de jeunesse situé sur la route qui part du premier camp d’Auschwitz et aboutit au camp de la mort de Birkenau, trois kilomètres plus loin. On me conduisit sur ces sites et je rencontrai trois survivants de manière informelle. Je sentis que j’étais proche, géographiquement du moins, du cœur de la force obscure à l’ombre de laquelle ma génération avait grandi. À Birkenau, un après-midi pluvieux, je m’arrêtai devant les décombres des chambres à gaz – aujourd’hui étrangement abandonnés sans surveillance – dans l’état où les Allemands les avaient laissés après avoir dynamité les bâtiments et s’être enfuis devant l’armée rouge. Maintenant c’étaient juste des plaques de béton armé brisées et humides, exposées au rude climat polonais, se détériorant d’année en année. Mes hôtes parlaient de leur dilemme. Fallait-il protéger ces vestiges ? Construire des dômes en perspex pour les recouvrir, afin de les préserver à l’intention des générations futures ? Ou bien valait-il mieux les laisser se désagréger peu à peu, de façon naturelle, et disparaître ? Cela me parut être la puissante métaphore d’un dilemme plus vaste. Comment de tels souvenirs seraient-ils préservés ? Les dômes de verre transformeraient-ils ces reliques du mal et de la souffrance en de fades expositions muséales ? Comment choisir ce que nous devions garder en mémoire ? Ne vaut-il pas mieux oublier et aller de l’avant ?
J’avais 44 ans. Jusqu’à maintenant j’avais considéré que la Seconde Guerre Mondiale, avec ses horreurs et ses triomphes, appartenait à la génération de mes parents. Il m’apparut qu’avant longtemps, beaucoup de ceux qui avaient été les témoins directs de ces événements historiques ne seraient plus en vie. Et ensuite ? Le fardeau de la mémoire incombait-il à ma génération ? Nous n’avions pas vécu les années de la guerre, mais elles avaient façonné la vie de nos parents de manière indélébile. Avais-je désormais, en ma qualité de conteur, un devoir dont je n’avais pas eu conscience jusqu’à ce jour ? Le devoir de transmettre, du mieux que je pouvais, les souvenirs et les leçons de la génération de nos parents à celle qui suivrait la nôtre ?
Quelque temps plus tard, je donnais une conférence à Tokyo, et une auditrice de la salle demanda, comme cela arrive souvent, sur quoi je comptais travailler ensuite. Plus précisément, elle souligna que mes livres décrivaient souvent des individus qui avaient traversé des époques de grand bouleversement social et politique, et se retournaient ensuite vers le passé, s’efforçant de se réconcilier avec leurs souvenirs les plus sombres et les plus honteux. Mes livres futurs, demanda-t-elle, continueraient-ils de couvrir le même territoire ?
Je me surpris à lui donner une réponse tout à fait improvisée. Oui, j’avais souvent écrit sur ce genre d’individus, qui se débattaient entre le désir d’oublier et le besoin de se souvenir. Mais à l’avenir, je souhaitais en réalité écrire sur la manière dont une nation ou une communauté affrontait les mêmes questions. Une nation se souvient-elle et oublie-t-elle de la même façon qu’un individu ? Ou bien existe-t-il des différences importantes ? Quels sont exactement les souvenirs d’une nation ? Où sont-ils conservés ? Comment sont-ils façonnés et contrôlés ? Y a-t-il des époques où l’oubli est la seule solution pour mettre fin à des cycles de violence, ou pour empêcher une société de se désintégrer dans le chaos ou la guerre ? D’un autre côté, des nations libres, stables, peuvent-elles réellement se construire sur les fondations d’une amnésie volontaire et d’une justice frustrée ? Je m’entendis annoncer à l’auditrice que je voulais trouver un moyen d’écrire sur ces sujets, mais que pour l’instant, malheureusement, je ne voyais pas comment procéder.
*
Un soir, au début 2001, dans le salon obscur de notre maison au nord de Londres (où nous habitions désormais), Lorna et moi commençâmes à regarder, sur une cassette VHS de qualité raisonnable, un film d’Howard Hawks sorti en 1934, qui s’appelait Twentieth Century (Train de luxe). Nous découvrîmes bientôt que le titre ne se référait pas au XXe siècle que nous venions de quitter, mais au célèbre train de luxe de cette époque, qui reliait New York à Chicago. Comme le savent certains d’entre vous, ce film est une comédie au rythme soutenu, qui se déroule en grande partie dans le train, et décrit un producteur de Broadway de plus en plus désespéré, qui essaie d’empêcher son actrice principale de se rendre à Hollywood pour devenir une vedette de cinéma. Le film est construit autour de l’extraordinaire performance comique de John Barrymore, l’un des grands acteurs de son temps. Ses expressions de visage, ses gestes, presque chacune de ses répliques sont chargés de l’ironie, des contradictions et des extravagances grotesques d’un homme qui se noie dans l’égocentrisme et la théâtralité. C’est sous beaucoup d’aspects une performance brillante. Pourtant, alors que le film continuait de se dérouler, je me sentis curieusement détaché. Cela m’intrigua au début. D’habitude j’aimais bien Barrymore, et j’étais un grand amateur des autres films tournés par Howard Hawks à cette période – comme La dame du vendredi et Seuls les anges ont des ailes. Puis, au bout d’une heure environ, une idée simple, évidente, me traversa l’esprit. Si tant de personnages captivants, indéniablement crédibles dans les romans, les films et les pièces de théâtre, me laissaient si souvent indifférent, c’était parce que la relation humaine établie par les échanges avec leurs partenaires ne présentait pas d’intérêt. Aussitôt me vint la réflexion suivante sur mon propre travail: Et si je cessais de me préoccuper de mes personnages pour me soucier du rapport qui existait entre eux ?
Tandis que le train cliquetait en direction de l’ouest et que John Barrymore devenait de plus en plus hystérique, je songeai à la célèbre distinction établie par E.M. Forster entre les personnages en deux dimensions et en trois dimensions. Un personnage de roman était en trois dimensions, disait-il, dans le sens où “il nous surprenait de manière convaincante”. Il devenait ainsi un personnage “rond”. Et que se passait-il, me demandai-je alors, si un personnage était en trois dimensions, à la différence des hommes ou des femmes qu’il fréquentait ? À un autre moment de cette même série de conférences, Forster avait eu recours à une image humoristique, l’extraction aux forceps de l’intrigue d’un roman, brandie en l’air tel un ver qui se tortille, afin d’être examinée à la lumière. Je pourrais peut-être tenter un exercice similaire et étudier au grand jour les diverses relations humaines qui se tissent dans un récit ? Faire la même chose avec mon propre travail – pour des récits achevés et d’autres que je prévoyais d’écrire ? Par exemple, me pencher sur cette relation entre un mentor et son élève. Cela apporte-t-il quelque chose de neuf, de pertinent ? Ou bien, à présent que je l’étudie, ne devient-il pas évident que c’est un stéréotype usé, identique à ceux qu’on trouve dans des centaines de romans médiocres ? Ou encore, cette relation entre deux amis en concurrence: est-elle dynamique ? A-t-elle une résonance émotionnelle ? Évolue-t-elle ? Est-elle en trois dimensions ? J’eus brusquement l’impression de mieux comprendre pourquoi divers aspects de mon travail avaient échoué dans le passé, malgré les remèdes désespérés auxquels j’avais eu recours. L’idée me vint – alors que je continuais de regarder John Barrymore – que tous les bons romans, quel que fût le parti pris radical ou traditionnel du mode de récit, devaient contenir des relations essentielles à nos yeux; des relations émouvantes, amusantes, irritantes, surprenantes. Peut-être qu’à l’avenir, si je soignais mieux leurs relations, mes personnages prendraient soin d’eux-mêmes.
Il me vient à l’esprit en vous disant cela que j’affirme peut-être quelque chose qui vous a toujours paru évident. Mais tout ce que je peux dire, c’est que cette idée m’est venue étonnamment tard dans ma vie d’écrivain, et que je la perçois aujourd’hui comme un tournant comparable à ceux que je vous ai décrits aujourd’hui. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à construire autrement mes livres. Lorsque j’écrivis Auprès de moi toujours (Never Let Me Go), par exemple, je me concentrai dès le début sur le triangle central de relations, et ensuite sur les autres relations qui en émanaient.
*
Les tournants décisifs de la carrière d’un écrivain – et peut-être de toutes sortes de carrières – se produisent ainsi. Ce sont souvent de petits moments échevelés. Des étincelles de révélation, silencieuses et secrètes. Ils surviennent rarement, et quand ils le font, c’est sans fanfare, sans l’accord des mentors ou des collègues. Ils doivent souvent se battre pour attirer l’attention, avec des exigences plus tapageuses, plus urgentes en apparence. Parfois ce qu’ils révèlent peut aller à l’encontre de l’opinion prédominante. Mais quand ils surgissent, il est important d’être capable de les reconnaître pour ce qu’ils sont. Sinon ils vous glissent entre les mains.
J’ai insisté ici sur l’aspect petit et secret, car c’est le fond même de mon travail. Une personne écrivant dans une pièce tranquille, s’efforçant d’entrer en contact avec une autre personne qui lit dans un lieu paisible – enfin, peut-être pas si paisible que ça. Les histoires peuvent distraire, et parfois vous instruire ou défendre un point de vue. Mais pour moi, l’essentiel est qu’elles communiquent des émotions. Qu’elles en appellent à ce que nous partageons en tant qu’êtres humains par delà nos frontières et nos dissensions. De grandes industries glamour se bousculent autour d’elles; l’industrie du livre, l’industrie du cinéma, l’industrie de la télévision. Mais à la fin, il s’agit d’une personne qui dit à une autre: Voici ce que je ressens. Vous comprenez ce que je dis ? Est-ce que vous éprouvez la même chose vous aussi ?
<
*
Nous arrivons donc au présent. J’ai compris depuis peu que j’avais vécu dans une bulle depuis des années. Que je n’avais pas remarqué la frustration et l’inquiétude de beaucoup de gens autour de moi. Je me suis rendu compte que mon univers – un lieu civilisé, stimulant, rempli de personnes à l’esprit ouvert, ironique – était en réalité beaucoup plus réduit que je ne l’avais imaginé. 2016, une année d’événements politiques surprenants – et déprimants pour moi – en Europe et en Amérique, et d’actes terroristes ignobles à travers tout le globe, m’a forcé à reconnaître que le progrès irréversible des valeurs humanistes-libérales que j’avais considéré comme acquis depuis l’enfance avait peut-être été une illusion.
Je fais partie d’une génération encline à l’optimisme, et pourquoi pas ? Nous avons vu nos aînés transformer avec succès l’Europe, un continent de régimes totalitaires, de génocide, où a été perpétré un massacre sans précédent dans l’Histoire, en une région très enviée de démocraties libérales vivant dans une amitié presque dénuée de frontières. Nous avons regardé les anciens empires coloniaux s’écrouler à travers le monde avec les théories répréhensibles sur lesquelles ils s’appuyaient. Nous avons été témoins des progrès significatifs du féminisme, des droits homosexuels et des combats sur plusieurs fronts contre le racisme. Nous avons grandi dans le contexte de l’affrontement – idéologique et militaire – entre le capitalisme et le communisme, et nous avons assisté à ce que beaucoup d’entre nous ont cru être une fin heureuse.
Mais aujourd’hui, si on regarde en arrière, la période qui a suivi la chute du mur de Berlin semble avoir été minée par la complaisance et les occasions manquées. On a laissé se développer d’énormes inégalités – de richesse et d’opportunités – entre les nations et à l’intérieur des nations. En particulier, la désastreuse invasion de l’Iraq en 2003, et les longues années d’austérité imposées aux gens ordinaires à la suite de la crise économique scandaleuse de 2008, nous ont conduits aujourd’hui à une situation où prolifèrent les idéologies d’extrême droite et les nationalismes tribaux. Le racisme, sous ses formes traditionnelles et dans ses versions post-modernes, mieux promues, est de nouveau en hausse, il frémit sous nos rues civilisées tel un monstre enfoui qui s’éveille. Pour l’instant, il semble que nous fasse défaut une cause progressiste susceptible de nous unir. Au lieu de cela, même dans les riches démocraties de l’Occident, nous nous divisons en camps adverses pour nous disputer âprement le pouvoir ou les ressources.
Et au coin de la rue – à moins que nous ayons déjà franchi cette limite ? – guettent les défis posés par les percées stupéfiantes dans le domaine de la science, de la technologie et de la médecine. De nouvelles technologies génétiques – ainsi la technique CRISPR de manipulation des gènes – et les progrès de l’intelligence artificielle et de la robotique nous seront incroyablement profitables et permettront de sauver des vies, mais risquent aussi de créer des méritocraties sauvages qui ressemblent à l’apartheid, et un chômage massif, y compris parmi les élites professionnelles actuelles.
Me voici donc, à soixante ans passés, en train de me frotter les yeux et d’essayer de discerner dans la brume les contours de ce monde dont je ne soupçonnais pas l’existence jusqu’à hier. Trouverai-je l’énergie d’observer ce lieu inconnu, moi qui suis un auteur harassé, d’une génération intellectuellement à bout de forces ? Me reste-t-il quelque chose qui puisse aider à proposer une perspective, à introduire des strates d’émotions dans les querelles, les conflits et les guerres qui surviendront alors que les sociétés luttent pour s’adapter à ces énormes changements ?
Je devrai m’acquitter de cette tâche du mieux que je peux. Parce que je crois encore que la littérature est importante, et le sera d’autant plus lorsque nous franchirons ce terrain accidenté. Mais je compte sur les écrivains des jeunes générations pour nous inspirer et nous guider. C’est leur époque, et ils en auront l’instinct et la connaissance qui me manquent. Dans le monde des livres, du cinéma, de la télévision et du théâtre je vois aujourd’hui des talents exaltants, audacieux: des femmes et des hommes de vingt, trente et quarante ans. Donc je suis optimiste. Pourquoi ne devrais-je pas l’être ?
Mais permettez-moi de conclure en lançant un appel – si vous voulez, mon appel du Nobel ! Il est difficile de refaire le monde, mais réfléchissons du moins à la manière de préparer notre coin de l’édifice, ce coin de “littérature”, où nous lisons, écrivons, publions, dénonçons, et décernons des prix aux livres. Si nous devons jouer un rôle important dans cet avenir incertain, si nous devons tirer le meilleur parti des écrivains d’aujourd’hui et de demain, je crois qu’il nous faut devenir plus divers. Cela peut se faire en deux façons.
D’abord, nous devons élargir notre univers littéraire habituel pour inclure beaucoup d’autres voix au-delà des zones de confort des cultures d’élite des pays riches. Nous devons chercher avec plus d’énergie les joyaux de cultures littéraires qui demeurent inconnues à ce jour, que les auteurs vivent dans des contrées lointaines ou au sein de nos propres communautés. Ensuite: nous devons prendre grand soin de ne pas définir ce qui constitue une bonne littérature à nos yeux en des termes trop étriqués ou trop classiques. Les écrivains de la génération à venir vont inventer toutes sortes de manières nouvelles, parfois déroutantes de raconter des histoires essentielles et merveilleuses. Nous devons nous montrer ouverts à leur égard, en particulier en ce qui concerne le genre et la forme, afin de les stimuler et de rendre hommage aux meilleurs d’entre eux. En un temps où s’accélère dangereusement la division, nous devons écouter. Des écrits et des lectures de qualité briseront les barrières. Nous trouverons peut-être même une idée neuve, une grande vision humaine, autour de laquelle nous rassembler.
À l’Académie suédoise, la Fondation du Nobel, et au peuple de Suède qui au fil des années ont fait du prix Nobel un lumineux symbole du bien auquel aspirent les êtres humains – j’adresse mes remerciements.
Traduction: Anne Rabinovitch
Copyright © The Nobel Foundation 2017
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 12 laureates' work and discoveries range from proteins' structures and machine learning to fighting for a world free of nuclear weapons.
See them all presented here.